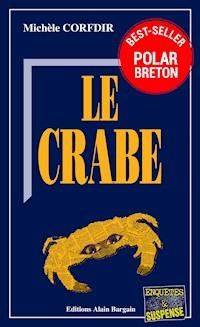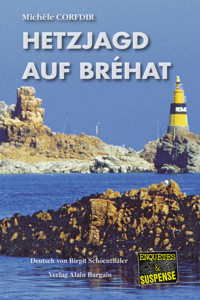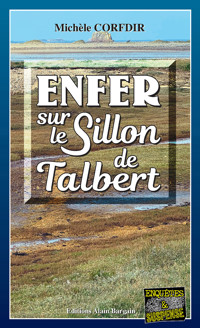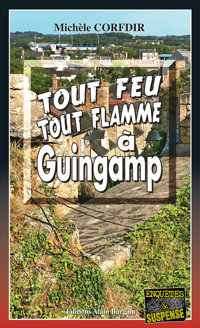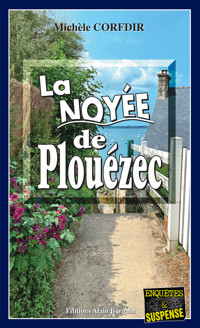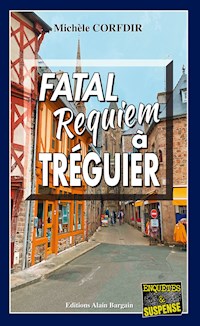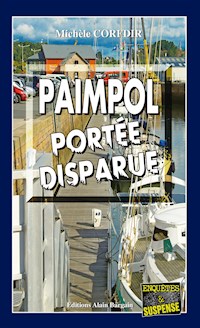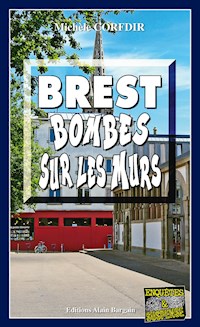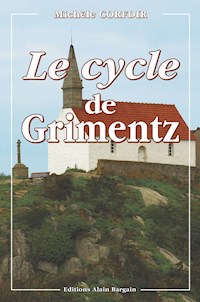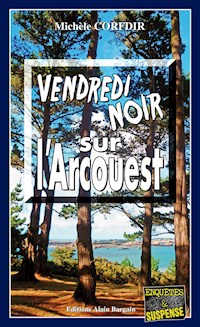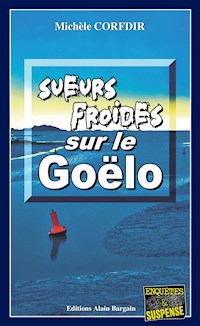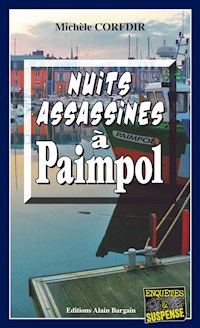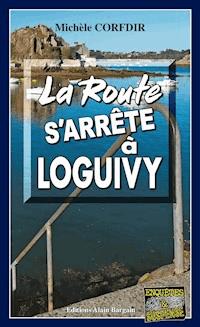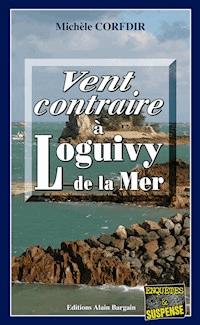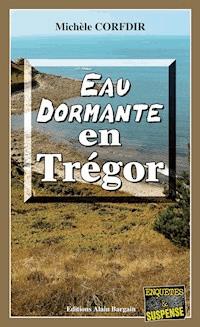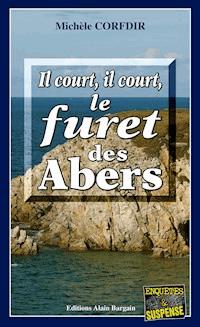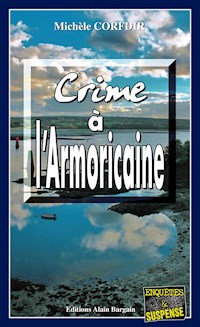
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un engrenage infernal s'ébranle...
Paimpol, décembre 2010.
Quand, à l'issue d'une réunion d'anciens élèves, deux participantes disparaissent mystérieusement, personne ne s'en inquiète vraiment. On le devrait pourtant…
En effet, quelques semaines auparavant, elles ont été l'objet d'un étrange harcèlement. Ignorant que c'était là le prélude d'un plan diabolique dont elles allaient faire les frais, elles tombent dans le piège et deviennent les victimes d'actes de barbarie incompréhensibles.
De quel pervers sont-elles les proies et quel but poursuit celui-ci en les tourmentant ?
Découvrez la réponse à cette question au fil de ce thriller qui vous tiendra en haleine jusqu'à la dernière ligne !
EXTRAIT
Au milieu de la page blanche figurait la photo d’un visage pas plus grand qu’une pièce de monnaie. Rien d’autre.
« Qu’est-ce que c’est que ce truc ? » marmonna Annie en cherchant le message publicitaire qu’il pouvait cacher.
Comme elle ne le trouvait pas, elle examina le portrait de plus près et constata qu’il avait été découpé dans une autre photo, car on distinguait la trace des ciseaux le long du front, des joues et du menton. Ensuite, il avait dû être posé sur une feuille vierge et reproduit grâce à une imprimante. Intriguée, elle s’approcha de la fenêtre. À la lumière, elle nota que le visage était celui de quelqu’un de très jeune, certainement un enfant. Ses traits étaient quelconques et totalement inexpressifs. Des paupières un peu gonflées, une moue un peu boudeuse… Le seul sentiment qu’il éveillait en elle était une pitié vaguement écœurante.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Editions Bargain, le succès du polar breton. –
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Michèle Corfdir est née et a grandi en Suisse. Elle y a fait ses études et a enseigné quelques années dans le Jura et à Bienne. Elle a publié alors un recueil de poèmes couronné par le Prix des Poètes Suisses de Langue Française, ainsi que des contes pour enfants qui obtiennent le prix de l'Office Suisse de la Lecture pour la Jeunesse. Après son mariage avec un marin pêcheur breton, elle s'établit à Loguivy de la Mer. Elle collabore comme nouvelliste à diverses revues et met sa plume au service des marins pêcheurs, au cours de la crise qu'a connue cette profession au début des années 90. En 1998, elle publie aux Éditions Alain Bargain, son premier roman,
Le Crabe, un thriller maritime très bien accueilli tant par la critique que par le public. Face à ce succès, elle édite d'autres ouvrages dans la collection Enquêtes et Suspense.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 352
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles,Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. »
Arthur Rimbaud
I
Debout sur le seuil de sa maison, Annie Bruhel se disait que l’automne était bel et bien arrivé. L’été qui avait résisté tout le mois de septembre, était en train de se défaire sous les coups de boutoir du vent d’ouest. Il était temps de cueillir les pommes tardives et de les mettre en clayettes, il fallait tondre le gazon tant qu’il était encore sec, brûler les fanes des haricots, couper les tiges des framboisiers, ratisser et ramasser les feuilles déjà mortes… « A faire sans tarder », songea Annie. Aujourd’hui, l’après-midi étant trop avancé, elle se contenterait de tailler les massifs à l’aide de son sécateur.
Elle quitta la maison et gagna l’appentis où elle remisait ses outils puis, un cageot sous le bras, elle traversa la pelouse en direction d’un rosier dont il fallait couper les fleurs fanées. Un peu plus loin, des touffes de topinambours chahutaient dans le vent. Quel jaune merveilleux et si délicieusement optimiste ! Elle en ferait un bouquet pour égayer le renfoncement du vestibule et elle en apporterait une brassée à chacun de ses patients. Cette couleur lumineuse leur ferait du bien.
Elle enfila ses gants et se mit au travail. Les plantes, les arbres, l’odeur de la terre, le chat du voisin qui s’approchait et s’asseyait dans l’herbe non loin d’elle… Malgré les rafales, un calme profond envahit la jeune femme. Elle n’avait besoin de rien d’autre pour se vider l’esprit.
En allant vider son cageot sur le tas de mauvaises herbes, près du portail, elle s’aperçut qu’elle avait négligé de prendre son courrier dans sa boîte aux lettres. Comme elle était en congé le dimanche et le lundi, elle n’y avait pas pensé. Ces jours-là en effet, elle tâchait d’oublier complètement tout ce qui se rapportait à sa vie professionnelle. Elle avait expliqué une fois pour toutes à ses patients que l’aide à la personne avait ses limites et qu’il était inutile de vouloir la joindre quand elle n’était pas de service. S’ils voulaient bénéficier d’une “auxiliaire de vie” efficace, patiente et gaie le restant de la semaine, ils devaient en passer par là.
Chacun l’avait compris et Annie Bruhel passait ainsi tranquillement tous ses week-ends à Lesgwen, une petite propriété qu’elle possédait dans la Presqu’île Sauvage, à une vingtaine de kilomètres de Paimpol. Jamais personne ne se permettait de la déranger.
Elle allait s’attaquer aux framboisiers lorsqu’un nuage plus gros et plus sombre que les autres masqua le soleil. Les couleurs se fanèrent. Au fond du jardin, les grands sapins noircirent brusquement. Les feuilles grenat du prunus s’envolèrent dans le vent. Le chat s’étira longuement puis se dirigea vers le garage. De l’autre côté du portail, Anne vit passer son voisin qui partait faire ses dix kilomètres quotidiens à vélo.
Comme le soleil demeurait caché et que l’air s’était rafraîchi, elle rangea ses outils, lava ses mains et ses bottes au robinet de la cour, cueillit une brassée de fleurs de topinambours, vida sa boîte aux lettres et rentra dans la maison.
Jetant un coup d’œil à l’horloge, elle constata qu’il était trop tard pour se faire une tasse de thé et trop tôt pour boire l’apéro qu’elle s’accordait, le soir, lorsqu’elle se trouvait à Lesgwen. Elle n’aimait pas ces moments intermédiaires qui lui donnaient l’impression d’être entre parenthèses, ce qui déclenchait en elle une anxiété irraisonnée. Un instant, elle fut tentée de ressortir, mais le temps s’était encore assombri et le vent avait forci.
Pour s’en assurer, elle monta à sa chambre d’où l’on apercevait la mer. Elle ne s’était pas trompée. Venant du nord-ouest, un grain approchait, masquant déjà une partie de l’horizon. Elle vérifia que toutes les fenêtres de l’étage étaient fermées puis redescendit. Sur l’évier, les fleurs attendaient d’être mises dans l’eau. Elle effeuilla leurs tiges, en fit quelques bouquets à l’intention de ses patients et déposa le reste dans un pot de grès qu’elle plaça près de l’entrée. Puis elle s’occupa du courrier. Quelques factures, un avis de remboursement, une invitation à un don du sang et la pub habituelle. En passant celle-ci en revue, elle tomba sur une feuille volante pliée en quatre, qu’elle ouvrit machinalement. Au milieu de la page blanche figurait la photo d’un visage pas plus grand qu’une pièce de monnaie. Rien d’autre.
« Qu’est-ce que c’est que ce truc ? » marmonna Annie en cherchant le message publicitaire qu’il pouvait cacher.
Comme elle ne le trouvait pas, elle examina le portrait de plus près et constata qu’il avait été découpé dans une autre photo, car on distinguait la trace des ciseaux le long du front, des joues et du menton. Ensuite, il avait dû être posé sur une feuille vierge et reproduit grâce à une imprimante. Intriguée, elle s’approcha de la fenêtre. À la lumière, elle nota que le visage était celui de quelqu’un de très jeune, certainement un enfant. Ses traits étaient quelconques et totalement inexpressifs. Des paupières un peu gonflées, une moue un peu boudeuse… Le seul sentiment qu’il éveillait en elle était une pitié vaguement écœurante.
À cet instant, le grain s’abattit brutalement sur la maison. Les rafales cravachèrent les arbres, les branches se tordirent, des rameaux arrachés s’envolèrent. Les asters et les reinesmarguerites se couchèrent sous les trombes d’eau, une multitude de pétales et de feuilles s’éparpillèrent en tous sens, tandis que les têtes des dahlias pendaient lamentablement au bout de leurs tiges cassées.
Catastrophée, Annie regardait son jardin saccagé lorsqu’elle entrevit, à travers les rideaux de pluie, la silhouette de son voisin qui rentrait chez lui.
La jeune femme savait que ce genre de coup de chien ne durait généralement pas longtemps et que d’ici une demi-heure, le soleil brillerait peut-être à nouveau. Mais, en attendant, la maison baignait dans un crépuscule verdâtre et la pluie, poussée par le vent, s’infiltrait sous la porte. Une flaque se formait dans le couloir. Elle courut chercher des serpillières en se promettant, comme chaque fois que cela arrivait, de faire venir un maçon pour modifier le seuil de son entrée.
C’était le genre de démarche qu’elle remettait sans cesse. Avant son divorce, Gérard s’en chargeait toujours. Leur séparation datait maintenant de deux ans et les effets de sa négligence commençaient à se faire sérieusement sentir. Les portes grinçaient, les fenêtres s’ajustaient de plus en plus mal, les robinets gouttaient, la chaudière faisait des caprices et, après chaque tempête, des ardoises toujours plus nombreuses jonchaient le pourtour de la maison.
Annie soupira. Dans le couloir, les serpillières saturées laissaient passer l’eau. Un ruisselet approchait dangereusement le kilim étalé entre la salle et la cuisine. Mais la lumière s’éclaircissait et dehors, l’affolement des arbres se calmait. Le grain s’éloignait.
Annie prit une cuvette et se mit à éponger le sol. Dans un moment, elle ouvrirait la porte et les courants d’air finiraient de sécher le carrelage.
Les dégâts du jardin seraient plus difficiles à réparer. Elle pourrait éventuellement tuteurer les massifs, couper, élaguer, ramasser les branches mortes. Mais l’automne était là, la nature s’étiolait et ces rafistolages ne serviraient pas à grand-chose.
Par la fenêtre, un rayon de soleil pénétra soudain dans la pièce. Les nuages se déchiraient, le vent avait molli. Annie eut l’impression qu’il ne s’était rien passé.
Lorsqu’elle sortit, elle se rendit compte que tout était détrempé et qu’il n’y avait pas moyen de jardiner. Alors elle saisit sa vareuse bleu marine, enfila une paire de mocassins et partit se promener sur le chemin qui menait à la mer.
Derrière elle, les trois maisons qui formaient le hameau de Lesgwen disparurent dans un repli de terrain.
II
« …Ainsi, ce sont nos hésitations, nos fourvoiements, nos faux pas qui nous font progresser. Car nos erreurs sont les pavés dont sont couvertes nos routes. Nous les commettons, puis nous marchons dessus. Et c’est comme ça que nous avançons. »
Nina Benkowski cessa de pianoter sur le clavier de son ordinateur. Qu’est-ce qu’elle racontait là ? C’était beaucoup trop littéraire, trop poétique… et pas du tout adapté au public à qui elle le destinait.
Les responsables de l’Académie du Temps Libre de Lausanne qui l’avaient sollicitée pour une causerie sur la création artistique, n’attendaient pas qu’elle s’embarque dans des considérations philosophiques, mais qu’elle parle concrètement de son métier de plasticienne.
« Reviens sur terre, ma petite », se dit-elle en songeant à la cinquantaine de personnes qui assisteraient à sa conférence, la semaine suivante. L’assemblée se composerait, en majorité, de retraités qui l’écouteraient respectueusement et à qui l’idée ne viendrait pas de la contredire. Tout au plus lui poseraient-ils quelques questions polies auxquelles elle répondrait par des banalités, un exercice aussi oiseux pour elle que pour ses auditeurs. Mais eux auraient du moins l’impression d’avoir occupé intelligemment leur après-midi. Elle n’aurait pas cette satisfaction. Par contre, elle repartirait, une enveloppe contenant sa rémunération dans sa poche, et l’assurance d’avoir son nom et son portrait dans le journal du lendemain. « Les écrivains ont leurs ateliers d’écriture, les musiciens leurs leçons particulières, les plasticiens les conférences et les stages en atelier. À chacun ses àcôtés… »
Nina haussa les épaules. Il est vrai que son mari, Georges Sifert, gagnait confortablement sa vie et subvenait aux besoins du ménage. Mais elle avait sa fierté et tenait à garder une certaine indépendance financière.
« Basez-vous sur vos expériences personnelles, lui avait recommandé au téléphone la présidente de l’Académie du Temps Libre. Parlez de vos sources d’inspiration, de la façon dont vous composez vos œuvres et de tout ce qui touche à la technique des tissus appliqués… Où vous procurez-vous les étoffes ? Utilisez-vous la couture ou le collage ? Quelles différences avec le patchwork ? Des sujets qui vous paraissent peut-être terre à terre mais qui, je vous l’assure, passionneront votre auditoire. Vous pourrez également évoquer le chapitre de la commercialisation : les intermédiaires, le monde des galeries et des salons, le prix des œuvres, qui le fixe et selon quels critères…»
Il ne faisait aucun doute que si elle se contentait d’aborder ce genre de questions, il était tout à fait inutile de préparer un texte. Il suffirait d’ébaucher une introduction, pour le reste, elle s’en tiendrait au verbiage habituel.
Nina n’en était pas à sa première conférence, loin de là, mais son souci de bien faire ne l’avait jamais vraiment quittée. Elle était restée l’étudiante exigeante et méticuleuse, à qui un de ses professeurs avait dit un jour que le diable était dans le détail et qu’il arrivait un moment où il fallait savoir s’arrêter et décider qu’une œuvre était terminée.
À trente ans, elle avait appris à dissimuler ses doutes et ses incertitudes. L’image de la femme épanouie et pleine d’assurance qu’elle donnait d’elle-même, n’était qu’un glacis protecteur auquel se heurtaient ceux qui voulaient l’approcher de trop près. C’était un rôle qu’elle jouait très bien mais qui n’avait rien à voir avec celle qu’elle était dans l’intimité, anxieuse, pessimiste, pointilleuse jusqu’à la maniaquerie.
Seul Georges le savait. Et, bien sûr, c’était quelque chose qu’elle n’avouait jamais au cours de ses causeries !
Jetant un coup d’œil à l’heure indiquée par son ordinateur, Nina décida que cela suffisait. Elle ferma son traitement de texte et se brancha sur Internet afin de consulter ses e-mails. Elle avait un message de Guillaume Lecomte, son agent artistique, qui l’informait de l’état de ses ventes pour les deux mois écoulés, et le courriel d’un inconnu, probablement une publicité masquée, qu’elle ouvrit néanmoins. Il n’y avait pas de texte, uniquement une pièce jointe qu’elle téléchargea par curiosité.
Un visage apparut. Un visage en noir et blanc, pas plus grand qu’un timbre-poste.
Les traits étaient enfantins, un peu lunaires, avec des joues rondes et des yeux à demi fermés. Le portrait ne comportait ni cou ni épaules et se détachait comme un médaillon, au milieu de l’écran.
« Qu’est-ce que c’est que ça ? » grogna-t-elle à voix basse.
L’adresse de l’expéditeur ne lui disait rien, pas plus que le visage d’ailleurs. Mais sur Internet, il fallait s’attendre à tout ! Elle allait éteindre son ordinateur lorsqu’elle entendit la porte de la maison s’ouvrir puis claquer. C’était Georges qui rentrait de Lausanne. Elle ne l’avait pas vu arriver. Les baies vitrées de son atelier donnaient au nord, sur les contreforts boisés du Jura.
La lumière y était excellente, par contre, elle ne voyait pas la petite route mal goudronnée qui montait au Chalet.
Elle entendit son mari aller et venir, puis celui-ci apparut à la porte de l’atelier.
— Encore au boulot ?
— Pas vraiment, j’étais sur Internet. Viens voir le courrier que j’ai reçu !
Georges s’approcha, déposa un baiser au creux de son cou, puis regarda l’écran.
— C’est quoi ça ?
— Voilà justement ce que je me demande.
— Tu connais ce visage ?
— Pas du tout ! Si c’est une pub, je ne vois pas à quoi elle rime.
— Laisse tomber ! Viens plutôt avec moi au jardin, on va boire un verre en regardant le soleil se coucher.
Ce que Nina appréciait particulièrement chez son mari, c’était sa façon d’aller toujours à l’essentiel. Selon lui, la vie était trop courte pour qu’on se perde dans les détails et qu’on se laisse perturber par des broutilles.
Le couple s’installa sur le terre-plein qui faisait suite au séjour. Cette fin septembre était exquise. Chaude, agrémentée d’un léger vent du sud qui vous donnait l’impression d’être dans le Midi. Nina adorait ça, tout en reconnaissant que ce temps-là n’était pas propice au travail.
Il fallait pourtant qu’elle s’y astreigne, car elle avait plusieurs commandes à honorer d’ici la fin de l’année.
Pour éviter d’être dérangée, Georges lui avait conseillé de déconnecter son téléphone fixe et de mettre son portable en absence quand elle travaillait. Comme le Chalet était assez isolé, il lui avait aussi recommandé de verrouiller la porte d’entrée et de fermer toutes les fenêtres donnant sur le devant. Les risques d’intrusion étaient minimes, mais il valait mieux se montrer prudent.
Vers vingt-deux heures, Georges, fatigué, monta se coucher. À l’EPFL - École Polytechnique Fédérale de Lausanne - ses journées étaient chargées, partagées entre les heures de cours et les recherches en laboratoire qu’il menait avec ses thésards. En outre, il avait l’habitude de se lever tôt pour parcourir tranquillement la vingtaine de kilomètres qui le séparaient de l’école et éviter les embouteillages aux abords de la ville. Il estimait que c’était là un inconvénient mineur et ne regrettait jamais de s’être installé dans la campagne vaudoise, au moment de son mariage avec Nina, dix ans auparavant. L’achat du “Chalet”, une ancienne ferme située au pied du Jura, s’était avéré une excellente affaire. Son coût était raisonnable et l’état de la maison n’avait pas nécessité d’importantes rénovations. Étant donné la hausse des prix de l’immobilier, sa valeur atteignait aujourd’hui des sommets invraisemblables.
Durant la première année de leur mariage, Nina s’était chargée de l’aménagement intérieur et de la décoration. Elle s’y était attelée avec enthousiasme et Georges jugeait le résultat absolument parfait. Chaque soir, il rentrait chez lui avec d’autant plus de plaisir que le cadre de son lieu de travail, à l’EPFL, était pour le moins spartiate. Labos purement fonctionnels, murs en ciment brut, escaliers et couloirs crépusculaires avec, pour seul élément décoratif, une tuyauterie omniprésente et ostensiblement exhibée.
Béton et tubulure conféraient à l’ensemble une atmosphère de cave ou d’abri antiaérien que Georges n’appréciait pas et qu’il quittait avec plaisir, à la fin de la journée.
Lorsque son mari eut rejoint sa chambre, Nina retourna dans son atelier. Une grande pièce de toile grège s’étalait sur le sol, elle servirait de fond à l’œuvre qu’elle avait en chantier : un couple d’oiseaux aux ailes déployées, dressés l’un en face de l’autre. Le dessin était réalisé et les différentes pièces qui le composaient découpées dans du papier kraft. Nina en était maintenant au choix des différents tissus, travail essentiel qu’il était impossible d’effectuer à la lumière artificielle car celle-ci dénaturait les nuances et faussait l’assortiment des coloris. Il faudrait attendre demain matin.
Tournant le dos à sa composition, elle gagna l’autre bout de l’atelier où l’ordinateur était toujours en veille.
Elle avait envie de revoir l’étrange portrait d’enfant. Quelques secondes plus tard, celui-ci réapparut au centre de l’écran. Elle le regarda longuement, s’efforçant de reconnaître quelque chose dans ses traits hébétés. Mais elle eut beau faire, ils ne lui disaient rien.
Oubliant le conseil de Georges, elle cliqua sur « réponse » et tapa : « Qui êtes-vous ? Qui est l’enfant du portrait ? »
*
Ces deux questions demeurèrent sans réponse. Nina y pensa quelques jours puis les oublia pour s’absorber dans son travail.
Le temps avait viré à la pluie, un vent froid balayait les versants du Jura et rien ne l’attirait plus à l’extérieur. Elle termina rapidement la composition des oiseaux. Le camaïeu de rouges qui composait leur plumage acquit un éclat flamboyant lorsqu’elle éparpilla, en bordure, une multitude de chutes de tissu vert sombre. Quand elle jugea l’œuvre finie, elle la suspendit à une tringle, devant le mur blanchi à la chaux, au fond de l’atelier, puis elle recula et la regarda sans indulgence, durant de longues minutes.
L’ensemble n’avait pas de défauts majeurs, elle le trouvait même particulièrement réussi. Bien sûr, en l’examinant, elle y découvrit plusieurs imperfections, un arrondi approximatif, une erreur de découpage, des fils qui pendaient et qu’elle sectionna immédiatement, mais cela ne tirait pas à conséquence. Elle laisserait la tenture en l’état quelques jours, puis téléphonerait à son agent afin qu’il procède à la livraison et à la vente proprement dite.
Le soir, quand Georges rentra de l’EPFL, elle lui demanda ce qu’il en pensait. Il répondit par un hochement de tête approbateur : « Magnifique, ma chérie, vraiment splendide ! » Éloge qui ne signifiait rien pour elle car elle savait depuis longtemps que son mari ne possédait aucun goût en matière artistique. Il en avait conscience, aussi limitait-il toujours sa critique à quelques mots de félicitation.
Le lendemain, elle décida de s’attaquer à une composition de deux mètres sur trois qu’elle avait promis pour la mi-décembre. Elle s’y attela dès le matin, mangea un morceau sur le pouce à midi et elle était toujours assise à sa table à dessin, un cahier rempli de croquis devant elle, lorsque le téléphone sonna. C’était Georges qui lui rappelait gentiment la conférence qu’elle devait donner l’après-midi même, à l’Académie du Temps Libre. Si elle voulait arriver à Lausanne à l’heure, il fallait qu’elle se prépare. Elle le remercia puis alla se changer.
Elle savait exactement quelle tenue porter à ce genre de manifestation. Un jean bien coupé, sa veste de cuir bordeaux, des bottines à petits talons. Pour le haut, un corsage en fil d’Écosse gris argent largement décolleté sur un tee-shirt noir. Une décontraction de bon aloi qui plairait à son public. Dans le vestibule, elle saisit un grand sac de cuir dont elle se servait en toutes circonstances. Comme il pleuvait, elle attrapa un parapluie et un foulard de coton qu’elle enroula autour de son cou. Puis, tête baissée, elle fonça jusqu’à sa Clio garée devant le portail du jardin.
Une demi-heure plus tard, elle était à Lausanne et descendait la rampe du parking de la Riponne. La pluie avait cessé et un rayon de soleil perçait les nuages alors qu’elle franchissait le seuil de l’Espace Culturel où se tenaient les conférences mensuelles organisées par l’Académie du Temps Libre.
Comme d’habitude, elle arrivait avec quelques minutes de retard afin d’échapper aux inévitables importuns. Le hall d’entrée était désert, mais elle entendait le brouhaha du public rassemblé dans l’auditorium. À cet instant, la présidente de l’association surgit derrière elle et l’appela à voix basse.
— Selon un usage bien ancré, je prendrai la parole la première, dit-elle après que les deux femmes se furent serré la main. Je résumerai brièvement les activités de notre académie, donnerai quelques nouvelles la concernant, puis j’annoncerai l’invité du mois prochain. Cela ne durera que quelques minutes. Ensuite, je vous présenterai mais de façon très succincte, car je pense que c’est à vous de nous dévoiler votre parcours…
Elle laissa sa phrase en suspens et, la tête légèrement penchée, sembla attendre une approbation.
— Bien sûr, fit Nina, quoique je n’aie pas pour habitude de m’étendre trop longuement sur ma vie.
— Vous êtes seul juge, mais n’oubliez pas que vos auditeurs seront curieux de connaître ce qui a pu vous pousser à entreprendre une carrière telle que la vôtre. Ah ! Une dernière chose…
Elle ouvrit sa sacoche et en tira deux enveloppes.
— Je préfère vous les remettre dès maintenant. À la sortie, vous serez assaillie par le public et ce sera plus difficile. Voici d’abord votre rémunération. Et voilà un courrier qui vous est destiné. Quelqu’un l’a déposé chez le concierge, à votre intention. Sans doute le témoignage d’un admirateur…
Annie les rangea dans son sac puis elles pénétrèrent ensemble dans la salle de conférence.
Deux heures plus tard, Nina quitta l’Espace Culturel, tout à fait satisfaite de sa prestation. La causerie s’était bien passée. Les gens avaient d’autant mieux compris ses explications que plusieurs reproductions agrandies de ses œuvres étaient placardées sur des panneaux bien visibles du public. Puis il y avait eu le jeu des questions-réponses suivi d’un pot offert par l’association. Tout cela dans une atmosphère amicale et détendue.
Mais maintenant que c’était terminé, elle se sentait soudain épuisée. Pour se remettre, elle entra dans un café de la place de la Riponne où elle commanda un croissant et un thé.
Tout en le sirotant, elle ouvrit l’enveloppe contenant sa rétribution et s’assura que le compte y était. Puis elle décacheta la deuxième, s’attendant à lire quelques banalités flatteuses sur ses œuvres ou son génie créatif.
Mais quand elle déplia la lettre, un hoquet la secoua et elle renversa le fond de sa tasse sur son jean. Sur la page blanche, il y avait un dessin à la plume. Il représentait deux enfants. Le premier était debout. D’une main, il brandissait une hache, de l’autre, il tenait son camarade par les cheveux et s’apprêtait à lui couper la tête.
Des larmes, ajoutées au stylo-feutre bleu, coulaient sur les joues de la victime.
Cette caricature sécrétait une cruauté primitive et implacable. Elle s’apparentait au graffiti et à certaines peintures précolombiennes. Mais ce qui chavirait Nina, ce qui lui serrait la gorge, c’était autre chose : le visage de l’enfant qui tenait la hache était la réplique du portrait apparu, quelques jours auparavant, sur l’écran de son ordinateur. Quant à celui de la victime, c’était le sien.
III
20 octobre 2010
« INVITATION
C’est à Paimpol que vous avez fait vos classes d’école primaire.
En 1990-1991, vous étiez en CM2, l’élève de madame Gouaut. Vous êtes donc des nôtres !
À ce titre, vous êtes cordialement invité(e) à la réunion des anciens élèves qui se déroulera le samedi 4 décembre prochain.
La rencontre aura lieu à 18 heures, dans l’arrière-salle du restaurant l’Armor, situé sur le port de Paimpol.
Vingt ans se sont écoulés depuis le temps où nous étions en CM2. Ces retrouvailles promettent donc d’être intéressantes, sympathiques et pleines de surprises.
Nous comptons sur votre présence. Plus nous serons nombreux, plus la rencontre sera réussie.
À bientôt.
P.-S. Si vous possédez des photos, des documents ou du matériel scolaire datant de cette époque, apportez-les, ils agrémenteront la soirée. »
« Non, je n’irai pas, certainement pas ! » se dit Annie Bruhel après avoir lu la carte d’invitation. Revoir des camarades de l’école primaire était une idée ridicule. Que l’on commémore le bac ou même la sortie du collège, passe encore… mais retrouver des condisciples du CM2, ça n’avait pas de sens, c’était beaucoup trop ancien.
Mais quand elle en parla à Émeline Doux, la vieille dame dont elle s’occupait cet après-midi-là, celle-ci ne partagea pas du tout son point de vue.
— Les souvenirs les plus lointains sont souvent les plus nets. Vous ne reconnaîtrez peut-être pas les visages, mais je suis sûre que vous vous rappellerez les noms, les prénoms, les quelques faits marquants de cette année-là. Je suis persuadée que vous avez davantage de souvenirs de votre CM2 que de la seconde ou de la terminale. Allez à cette réunion, croyez-moi, vous ne le regretterez pas.
Devant tant de conviction, Annie se dit qu’elle n’avait peut-être pas tort.
— À propos, poursuivit celle-ci, qui était votre institutrice ?
— Madame Gouaut. À l’époque, elle était déjà très âgée… elle doit être morte aujourd’hui.
— Pas du tout ! Je la connais de vue et je sais qu’elle va sur ses soixante-quinze ans. Une jeunesse comparée à moi qui en ai quatre-vingt-six ! Mais dites-moi, en quelle année avez-vous été son élève ?
— 1990-1991.
— Tiens, comme c’est curieux ! Ma petite-fille Marianne était dans cette classe-là, je m’en souviens très bien. Elle a donc dû recevoir une invitation à cette réunion, elle aussi.
Annie sourit. Elle aimait beaucoup Émeline Doux auprès de laquelle elle passait deux heures chaque mercredi, vendredi et samedi, et qui gardait toute sa vivacité d’esprit malgré la maladie de Parkinson dont elle était atteinte. Une aide-soignante et une femme de ménage venaient quotidiennement à son domicile de l’Arcouest, aussi le travail d’Annie consistait-il essentiellement à lui tenir compagnie. Elle se chargeait du courrier, des papiers et lui servait de chauffeur.
— Eh bien, d’ici décembre, j’ai tout le temps d’y réfléchir, répondit-elle.
— L’invitation ne comporte pas de coupon-réponse à renvoyer ?
— Non.
— D’habitude, les organisateurs aiment connaître le nombre de participants sur lesquels ils peuvent compter.
— Oui, quand il y a un repas, ce qui ne semble pas être le cas. La lettre ne précise même pas si un pot est prévu.
— Ça ne fait aucun doute ! On n’a jamais vu une réunion de ce genre sans qu’une tournée ne soit offerte. Ce serait contraire à tous les usages. D’ailleurs, un ou deux verres d’alcool sont indispensables pour délier les langues et détendre l’atmosphère. Vous êtes d’accord ?
— Oh moi, vous savez, l’alcool… Je ne suis pas très portée là-dessus.
— Et sur quoi êtes-vous portée, si je puis me permettre ?
— Sur pas grand-chose, je l’admets.
— Quel dommage ! Écoutez, Annie, je vais vous dire franchement ce que je pense, mon grand âge et notre amitié me le permettent. Je suis la première à reconnaître toutes vos qualités, seulement, excusez-moi, mais je trouve votre façon de vivre carrément calamiteuse. Vous avez trente ans et vous vivez comme une vieille fille de soixante-dix ans !
— J’ai été mariée ! protesta Annie, plus amusée que vexée.
— Oui, je sais… et divorcée. Cela n’empêche rien. On dirait que vous avez peur d’exister. Vous êtes comme une ombre grise sur un mur gris. Personne ne vous remarque.
— Ça ne me dérange pas.
— Ah ! Ma pauvre fille, ne dites pas ça !
— Si ! Si ! Je vous assure. La vie que je mène me convient parfaitement.
— Ce n’est pas possible ! On ne peut pas être heureux et s’éclater, en ne côtoyant que des vieillards, des handicapés, des faibles d’esprit.
— C’est mon métier.
— D’accord, mais ce n’est pas une raison pour vous comporter comme une bonne sœur. Bon sang ! « Vivez si m’en croyez, n’attendez à demain, cueillez dès aujourd’hui les roses de la vie. »
— Ah ! Ah ! Voilà la prof de lettres qui pointe son nez !
— Exactement. Et la prof de lettres va vous dire une dernière chose. Si je supporte à peu près stoïquement l’état détestable dans lequel je me trouve aujourd’hui, c’est parce que j’ai la mémoire pleine de souvenirs que je me repasse à longueur de journée. Et je me dis que j’ai bien rempli mon temps.
— J’en suis contente pour vous.
— Bon, voilà que vous me sortez une de vos banalités lénifiantes ! Si vous croyez calmer ainsi mon mouvement de colère, vous vous trompez !
— Je ne crois rien du tout. Ou plutôt si… Je pense qu’une promenade nous ferait du bien. Il fait beau et doux pour la saison.
— Vous avez raison ! décréta la vieille dame. Emmenez-moi à la Pointe de Bilfot.
Toute sa vie, Émeline Doux avait adoré la mer. Aussi, quand le temps le permettait, demandait-elle à Annie de la conduire sur les falaises ou les caps qui dominaient la Baie de Saint-Brieuc. Là, elle faisait quelques pas puis s’installait dans le fauteuil de toile qu’elles emportaient toujours avec elles, et contemplait longuement l’eau et le ciel.
Annie ne troublait jamais sa méditation. Elle avait l’impression que ces espaces infinis et somme toute immobiles, apaisaient les tremblements incessants qui torturaient la malade. La solitude en pleine nature, dans un lieu ouvert à tous les vents, devait lui apporter une sorte de libération.
Lorsque les deux femmes arrivèrent à quelques centaines de mètres de la Pointe de Bilfot, des voitures stationnaient sur le petit parking d’où partait le sentier qui menait à la grève de Notoret. Annie roula jusqu’à l’extrémité du promontoire. Elles croisèrent deux ou trois gamins qui faisaient des allées et venues à vélo.
Après avoir installé Émeline dans son fauteuil de toile, la jeune femme lui enveloppa les jambes d’un plaid puis lui dit qu’elle avait envie de descendre jusqu’à la plage.
— Bien sûr, ma chère, allez-y ! Il fait si beau, profitez-en !
Lorsqu’elle arriva sur le rivage, la marée basse découvrait une large bande de sable lisse et compact. L’endroit était désert et elle longea le bord de l’eau, en direction de l’avancée rocheuse qui se profilait au loin. Dans la douceur bleutée d’octobre, la mer ronronnait comme une chatte. Les reflets y posaient d’étranges flaques violettes et un léger ressac poussait un liséré d’écume sur le sable.
Annie retira ses chaussures et marcha les pieds dans l’eau, sans penser à rien. Quand elle finit par atteindre l’extrémité de la plage, elle découvrit que la couleur indigo du granit était due au banc de moules sauvages qui s’y accrochaient. Il y en avait tant qu’elle regretta de ne pas avoir de sac pour pouvoir en ramasser. C’est alors que, brusquement, le paysage fut plongé dans l’ombre. Elle se retourna, le soleil venait de disparaître derrière la falaise. Elle avait complètement oublié l’heure ainsi qu’Émeline, clouée dans son fauteuil. Aussitôt, elle rebroussa chemin et courut jusqu’au pied du sentier qu’elle remonta en vitesse. En haut, le petit parking était vide et il n’y avait plus aucun cycliste sur la route. Essoufflée, elle reprit sa course vers l’extrémité du cap et poussa un soupir de soulagement quand elle distingua le fauteuil et une tête qui dépassait du dossier.
— Mon Dieu ! Émeline… Je suis désolée. Vous deviez vous demander où j’étais restée…
Puis les mots lui manquèrent, visiblement, sa vieille amie n’était pas dans son état normal. Son visage avait blêmi, son menton tremblait si fort qu’elle était incapable de parler. Des secousses agitaient ses mains alors que le reste de son corps semblait pris dans une gangue de glace.
— Oh ! Émeline ! Qu’est-ce qui vous est arrivé ?
Deux yeux écarquillés se fixèrent sur Annie tandis que les lèvres s’efforçaient de prononcer quelques mots. En vain.
— Ne vous énervez pas ! Je vais vous installer dans la voiture puis nous rentrerons à la maison.
À cet instant, la jeune femme aperçut un rectangle de papier à demi dissimulé sous le plaid. Elle le saisit et le déplia.
— Quelle horreur ! s’exclama-t-elle en découvrant la photo d’un crâne humain décoré de minuscules plaques turquoise et noires.
Le cartilage du nez avait été remplacé par trois lamelles rougeâtres. Les orbites étaient entourées d’un anneau de pierre blanche. La mâchoire inférieure qui pendait laissait voir les dents, ce qui donnait l’impression que le masque riait ou hurlait.
En lieu et place des cavités oculaires, il y avait deux minuscules visages : le sien et celui de l’enfant inconnu dont elle avait reçu le portrait par la poste, quinze jours auparavant.
— Qui vous a donné ça ? s’enquit-elle en s’efforçant de dominer la peur qui la gagnait.
Un hochement de tête tremblotant lui répondit.
— Bon, ne vous affolez pas. Ce n’est qu’une image, rien de plus. Maintenant, il est temps de rentrer.
Le soleil avait disparu. La mer avait pris une teinte ardoise, sans coque blanche ni oiseau. Le vide. Le silence. La Pointe de Bilfot était déserte, face à la nuit qui venait.
Annie frissonna. Celui qui avait déposé cet affreux montage photographique sur les genoux d’Émeline était-il tapi derrière un rocher, en train de les observer ? Allait-il surgir de la lande et avancer vers elles ?
— Bon ! Ne nous attardons pas, dit-elle en soutenant la vieille dame jusqu’à la Clio.
Puis elle se mit au volant et démarra en trombe.
De retour dans sa jolie maison de l’Arcouest, Émeline Doux avait recouvré assez de calme pour raconter à Annie ce qui s’était passé. La feuille de papier pliée en quatre lui avait été apportée par un des gamins à vélo. Il la lui avait tendue en disant que c’était quelqu’un assis au volant d’une des voitures garées sur le parking, qui lui avait demandé de la lui remettre. Il avait reçu cinq euros pour sa peine. Puis le gosse était reparti sans qu’elle ait le temps d’en apprendre davantage. Elle avait alors déplié la page et découvert son contenu. Pour que les courants d’air ne l’emportent pas, elle l’avait glissée sous le plaid.
— Si c’est une plaisanterie, je la trouve de mauvais goût, conclut-elle alors que les deux femmes se réconfortaient autour d’une tasse de thé accompagnée d’un cake aux raisins. Une plaisanterie dont vous comprenez peut-être le fin mot puisque votre visage apparaît dans le montage…
— Non, pas vraiment. Mais ça doit avoir une relation avec l’étrange courrier que j’ai reçu récemment, un portrait d’enfant imprimé au milieu d’une feuille blanche, sans un mot d’explication. C’est ce portrait qui est collé sur l’orbite gauche du masque.
— Vous m’en direz tant ! s’exclama Émeline. On dirait une devinette… morbide et assez effrayante, je vous l’accorde, mais dont il doit être possible d’en découvrir le sens. D’abord ce masque, je suis presque sûre de l’avoir déjà vu quelque part.
La vieille dame se mit à réfléchir à haute voix, oubliant son goûter et le choc qu’elle avait éprouvé à la Pointe de Bilfot.
— C’est de l’art premier, provenant d’une société non occidentale. Il est une effigie de la mort. Mais de la mort esthétisée, destinée à impressionner le spectateur. Souvenons-nous de ce que nous avons ressenti : la surprise, le dégoût, la peur…
— Vous pensez à une civilisation où prédomine le culte de la mort ? L’Égypte peut-être…
— Non. Le travail est trop grossier. Les techniques égyptiennes étaient beaucoup plus sophistiquées. Ici, les fragments d’obsidienne et de turquoise ont été directement collés sur les os de la face. L’ensemble est barbare, primitif, d’une rare violence, et n’a rien à voir avec l’art égyptien. Cherchons un peu… Dans quels endroits du monde le culte de la mort s’est-il développé ? On peut dire, de façon générale, que les Africains s’attachaient plutôt à la fécondité et à l’animisme… les Asiatiques à l’érotisme et aux rituels d’une société policée… les Océaniens ne donnaient pas dans le morbide…
— Les Amérindiens ?
— Exact. Plusieurs civilisations précolombiennes pratiquaient les sacrifices humains. Les tortures qu’on peut voir sur certaines fresques sont franchement insoutenables. Oui, ce masque doit appartenir à une de ces cultures. De prime abord, je pencherais pour les civilisations d’Amérique Centrale, Olmèques, Toltèques, Mayas, Aztèques…
Plongée dans son sujet, Émeline parlait d’une voix ferme, son menton ne tremblait plus et ses mains étaient sagement posées sur ses genoux. Immobiles.
— Dans ma bibliothèque, j’ai plusieurs ouvrages sur ces civilisations. Je suis à peu près sûre d’y trouver une reproduction de ce masque. Il faudrait que nous cherchions ensemble…
— Nous le ferons, mais à ma prochaine visite, répondit Annie. Ce soir, il est trop tard. Étienne Renouard m’attend et vous devez être fatiguée.
— Non ! Je me sens au contraire étonnamment en forme. Je vais réfléchir à tout ça. Laissez-moi ce photomontage, si ça ne vous dérange pas.
— Gardez-le tant que vous voulez, mais ne faites pas de cauchemars à cause de lui !
— Ne craignez rien. Je suis un peu honteuse d’avoir été à ce point bouleversée, tout à l’heure. Autrefois, je n’étais pas aussi impressionnable, croyez-moi !
— Je n’en doute pas. Je n’en menais pas large, moi non plus.
— Pour résoudre cette énigme, le plus important serait de découvrir qui est l’enfant du portrait. Le masque n’était destiné qu’à nous effrayer. Trouver son origine ne nous avancera probablement pas à grand-chose, déclara la vieille dame.
— Sait-on jamais ? Pour l’instant, si ce montage contient un message, je suis incapable de le déchiffrer.
— Cela vaudrait mieux pourtant, répondit Émeline d’un air soucieux, car celui qui vous l’a adressé ne vous veut certainement pas du bien.
*
Après avoir quitté Émeline Doux, Annie se rendit rue des Islandais, à Paimpol, chez Étienne Renouard, avec qui elle passait quatre soirées par semaine. Lorsqu’elle arriva, vers dix-huit heures trente, le vieillard était couché, il avait mangé et regardait la télévision. La grande salle de séjour de l’appartement avait été transformée en lieu de vie où tout était à portée de sa main. Transistor, chaîne hi-fi, magnétoscope, ordinateur… À sa gauche, sur une table, l’aide-soignante avait disposé une bouteille d’eau, des fruits, des gâteaux, ses cigarettes, plusieurs journaux et quelques livres. En dehors des aides à domicile dont il bénéficiait, Étienne Renouard passait ses journées dans la plus complète solitude, ce qui ne le dérangeait nullement. Il prétendait, au contraire, apprécier au plus haut point une telle tranquillité, après la vie trépidante qu’il avait menée.
Seulement, à la tombée de la nuit, il était saisi de crises d’angoisse irrépressibles que seule la présence d’Annie Bruhel pouvait atténuer. Son fils Yves qui vivait à Lannion, passait le voir durant le week-end.
— C’est un homme de devoir, il s’y sent moralement obligé, bougonnait Étienne. Mais il ferait mieux de rester chez lui, pour le plaisir que ses visites m’apportent ! Nous ne nous aimons pas et ça ne date pas d’hier. On ne s’est jamais entendus malgré les efforts de sa mère pour nous rapprocher. La pauvre femme y a usé ses nerfs, mais que voulez-vous, ce gamin m’a toujours hérissé, avec son regard fuyant, sa mine boudeuse et ses cheveux roux… Quant au son de sa voix, je ne l’ai pas entendu souvent ! Je pensais qu’il était un peu attardé, mais apparemment non, puisque ses résultats scolaires étaient bons, voire même excellents. Ses profs le disaient timide et réservé, mais réfléchi et mûr pour son âge… Sans doute avait-il peur de moi, ce qui n’était pas justifié car je ne levais jamais la main sur lui ni ne le punissais. C’était sa mère qui s’en chargeait parce que je pensais que ce n’était pas là le rôle d’un beau-père. Quoi ? Je ne vous l’ai jamais dit ? Yves avait quatre ans quand j’ai épousé Jacqueline qui était veuve. C’est peut-être pour ça que le gamin m’a toujours tenu à distance. Je me disais que lorsqu’il grandirait, nous nous rapprocherions. Mais pas du tout ! Il s’est allongé, il a un peu forci, seulement son caractère n’a pas changé. Toujours aussi fade, aussi impénétrable. Il a fait quelques études et obtenu un diplôme de commerce, gestion, comptabilité, je ne sais pas quoi au juste. Bref, un papier qui lui permet de gagner sa vie… Figurez-vous qu’à trente ans, il n’a pas encore réussi à se trouver une femme ! C’est là que je me dis que je n’avais pas complètement tort quand j’affirmais à Jacqueline que son gamin avait quelque chose qui clochait. Bien sûr, rien n’est encore perdu, il peut se marier sur le tard. Seulement moi, si j’étais une nana, ce n’est pas un type comme lui que je choisirais. Notez qu’il n’a pas l’air d’avoir de défauts notoires, en dehors de son insignifiance. Je vous garantis que moi qui suis cloué dans mon fauteuil ou dans mon lit, je me montre plus actif, plus entreprenant, bref, plus vivant que lui ! Vous ne me croyez pas, mais c’est la stricte vérité. Un fruit sec, un zombie, un pétochard qui, même aujourd’hui, n’ose jamais me contredire ! C’est pourquoi je me passerais volontiers de ses visites du week-end, pour ce qu’elles m’apportent ! Sa conversation se limite aux nouvelles de la météo et aux activités sportives… comme si les résultats des équipes locales pouvaient m’intéresser !
— Vous êtes injuste et vous poussez le bouchon trop loin, rétorqua Annie qui avait entendu dire que le fils en question occupait un poste à responsabilités dans une banque de Lannion. J’ai l’impression que votre personnalité a écrasé celle de votre fils…
— Mon beau-fils.
— Oui, d’accord. Mais il était si petit quand il est venu vivre sous votre toit qu’à ses yeux, vous étiez son père.
— Et j’ai toujours assumé cette responsabilité. Il a été bien élevé et n’a jamais manqué de rien.
— Ça, c’est vous qui le dites ! Maintenant, vous devriez faire un effort et vous montrer plus aimable avec lui. C’est certainement quelqu’un de très timide.
— À d’autres ! Je vous répète que c’est un faux jeton. J’aimerais savoir à quel jeu il joue et pourquoi il tient à venir me voir si souvent.
— Peut-être simplement parce qu’il vous aime bien…
— Ne me prenez pas pour un cave. À moi, on ne me la fait pas ! Bon, assez discuté de ce nul. J’ai envie de regarder les infos télévisées.
Annie ne le contraria pas et lorsque, une demi-heure plus tard, il éteignit le poste et souhaita faire une partie d’échecs, elle alla prendre le jeu dans un tiroir et s’apprêta à perdre une fois de plus, car elle était loin d’être à la hauteur du vieux monsieur.
Vers vingt et une heures, elle quitta la rue des Islandais et prit la route de la Presqu’île Sauvage. Au volant de sa Clio, elle sentit la fatigue l’envahir. Elle venait de passer près de sept heures auprès de ses patients et si, pour les profanes, cet emploi ne ressemblait pas à un vrai travail, il n’en était pas moins usant.
Après avoir franchi le pont de Lézardrieux, il lui restait une vingtaine de minutes de trajet sur une route étroite et déserte qui serpentait entre les talus et les boqueteaux. De temps en temps, elle croisait une voiture ou traversait une minuscule agglomération éclairée par quelques lampadaires orange, puis elle s’immergeait à nouveau dans l’obscurité. Le ciel couvert cachait la lune, mais Annie connaissait le parcours par cœur. Elle sortait d’un petit bois lorsqu’un nuage se déchira. Elle distingua les fougères fanées des talus qui s’agitaient dans le vent, puis, comme elle jetait un coup d’œil à son rétroviseur, elle y surprit un miroitement. Regardant mieux, elle comprit que c’était la lune qui se reflétait dans un pare-brise. Le pare-brise d’une auto qui la suivait, tous feux éteints.