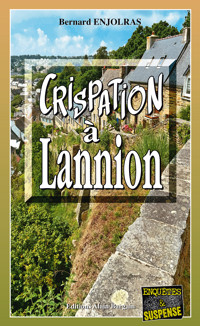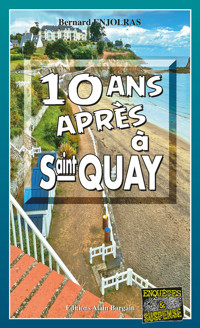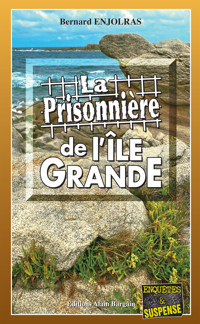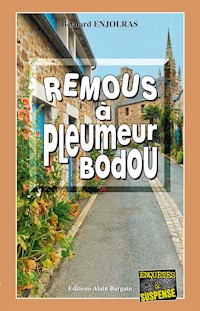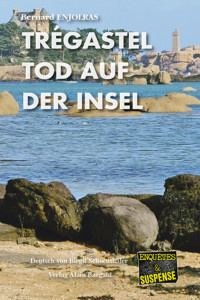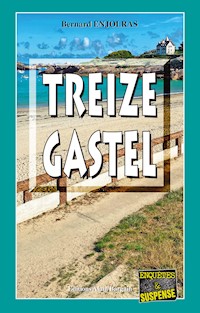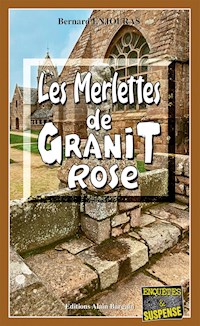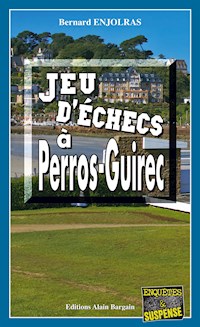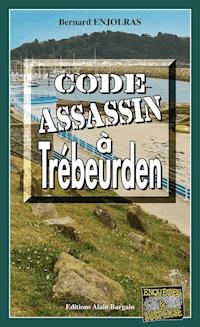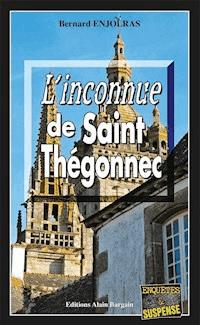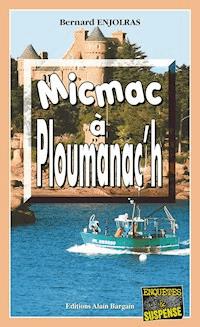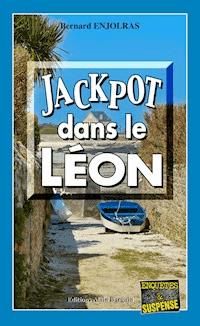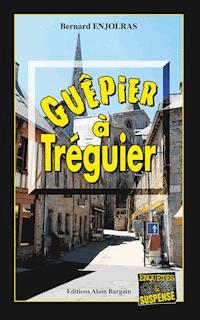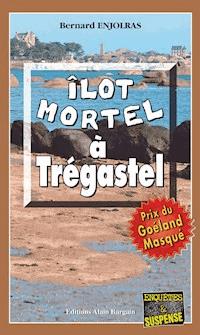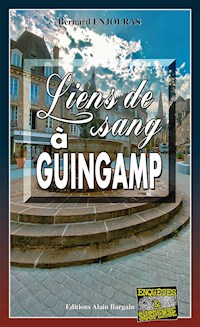
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Les enquêtes de Bernie Andrew
- Sprache: Französisch
Nos deux détectives amateurs nous entrainent à nouveau dans une enquête passionnante
Klaus Lachenbayer a-t-il fait partie des troupes allemandes ayant occupé Guingamp pendant la Seconde Guerre mondiale ? C’est en tout cas ce que prétend Hans Egerhard, son compatriote, dont le père, Rudolf, installé dans cette ville depuis plusieurs
années vient tout juste de mourir. Et c’est moi, Jean-Paul Keravial, que Dieter Klein, le petit-fils de Klaus, a choisi pour tirer cela au clair au motif que, en tant que professeur d’allemand, je maîtrise parfaitement la langue de Goethe. Les choses commencent à se compliquer lorsque Hans disparaît soudainement. Heureusement pour moi, je peux compter sur le soutien d’un historien et de deux détectives amateurs, qu’un heureux hasard a placés sur mon chemin.
Découvrez sans plus attendre le 13e volet des enquêtes mouvementées de Bernie Andrew !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né à Lyon,
Bernard Enjolras vit depuis de nombreuses années à Trégastel. C'est là qu'il écrit, au cœur de la magnifique Côte de Granit rose. Son quatorzième
roman nous entraîne à Guingamp, à la recherche d’un passé pas si oublié que l’on pourrait le penser.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À Peter Hutchinson « Oh, crickey ! »
REMERCIEMENTS
À Éric Rondel, Roger Le Doaré, Michèle Jacques, Jean-Yves Le Fichous et Yvon Bossis.
À toute l’équipe des Éditions Alain Bargain.
PRINCIPAUX PERSONNAGES
JEAN-PAUL KERAVIAL, le narrateur quadragénaire. Sa femme Christine vient de le quitter, emmenant leurs deux filles, Morgane et Salomé.
Son groupe d’amis proches est composé de Xavier, patron de bar, Stéphane, médecin, Cédric, agriculteur et Arnaud, garagiste.
HANS EGERHARD, Allemand, sexagénaire et retraité. Il est marié à Gudrun. Son père Rudolf, résidant à Guingamp, vient de mourir.
DIETER KLEIN, Allemand, quinquagénaire, petit-fils de Klaus Lachenbayer, décédé il y a vingt ans à l’âge de 79 ans. Il est marié à Angela et ils ont deux fils d’une vingtaine d’années, Hermann et Otto.
HECTOR BUDOC, 75 ans, marié à Fanchon. Ils ont trois filles et plusieurs petits-enfants, dont Manon, 22 ans.
MARCEL LEDOUX, érudit et historien amateur, ami des parents de Jean-Paul.
MAJOR ALAIN ROBERT, responsable de la brigade de gendarmerie de Guingamp et son adjoint, l’adjudant Albert Guernandes.
BERNIE ANDREW, auteur de romans policiers et détective amateur, accompagné de son fidèle acolyte, Jean-Jacques Bordier, professeur agrégé en retraite.
PROLOGUE
Été 2019
C’est un gamin qui mit au jour le corps.
Sa découverte résulta du plus grand des hasards, le ballon avec lequel il jouait ayant roulé bien au-delà de l’endroit où il avait souhaité l’envoyer.
Le plus étrange était que le cadavre gisait, à peine dissimulé, sous des branchages et que de nombreux autres passants auraient pu l’apercevoir.
Le corps était recroquevillé, presque en position fœtale, et le gamin, lorsqu’il l’aperçut pour la première fois, pensa tout d’abord qu’il ne s’agissait que d’un vieux tas de chiffons abandonnés. C’est l’odeur pestilentielle qui en émanait qui attira son attention. Il avait récupéré sa balle et commençait déjà à s’éloigner quand sa curiosité l’incita à revenir sur ses pas.
Il pensa qu’il s’agissait d’un animal crevé et qu’il y aurait là, très certainement, matière à raconter à ses copains et, par la même occasion, se donner pour une fois le beau rôle. Cela ne lui arrivait pas si souvent.
Il s’avança donc prudemment vers la source de la puanteur. Du bout du pied, il essaya de déplacer cet amas informe qui empestait comme cela n’était pas possible.
Ce n’est qu’au bout de plusieurs tentatives qu’il réussit à faire basculer la chose.
Et c’est en apercevant ce visage d’épouvante qui le regardait de ses yeux morts qu’il comprit qu’il avait affaire à un corps humain !
Il en avait déjà vu des milliers à la télévision, il avait lui-même occis des centaines d’ennemis, par écran interposé, mais là…
C’était une première pour lui.
Son premier cadavre humain !
Sa gorge se serra et son sang se glaça dans ses veines. Il se trouvait seul sur ce bout de terrain et la peur lui noua soudain les tripes. Il regarda autour de lui dans l’espoir d’apercevoir un adulte auprès duquel il aurait pu se réfugier. Mais le lieu était désert, désespérément vide de tout être humain à l’exception de ce corps ratatiné à ses pieds.
Mais le gamin avait du cran et ne paniqua pas. Il comprit que crier ne servirait à rien. Il s’efforça, malgré sa frayeur, de garder son calme et de réfléchir aux différentes options qui s’offraient à lui. Il pensa un moment aller frapper à la porte de la maison la plus proche mais il n’osa pas le faire. Il se dit ensuite que le plus simple était de rentrer chez lui et de signaler la présence de ce cadavre à une personne qu’il connaissait déjà.
Il recula précautionneusement sans quitter le corps des yeux. Quand il arriva sur le sentier qui traversait le terrain en diagonale, il pivota sur lui-même et partit comme un dératé en direction de la route.
Il tenait toujours son ballon serré contre sa poitrine alors qu’il franchissait l’arcade de pierre et s’élançait dans un sprint effréné sur l’asphalte.
I
Quatre jours plus tôt…
Le corbillard se rangea devant l’entrée principale, rue Jean-Le-Moal, à quatorze heures précises, répondant parfaitement aux exigences de ponctualité du vieux Rudolf. Il devait être content que tout se déroulât selon l’horaire prévu. Pour ma part, et compte tenu de ce que je connaissais de lui, j’avais toujours été persuadé que sa devise devait ressembler à quelque chose comme : « L’heure, c’est l’heure, avant l’heure, ce n’est pas l’heure et après l’heure ce n’est plus l’heure. »
Une solennité plus lourde sembla soudainement saisir la foule pas assez nombreuse pour remplir les bancs de l’immense basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours et le silence se fit plus profond quand les employés des pompes funèbres apparurent dans les travées, portant le cercueil sur leurs épaules.
Une réelle émotion s’empara de moi, ce qui m’étonna car, après tout, il ne s’agissait pas d’un membre de ma famille ni même d’une relation très proche.
La proximité de la mort peut-être qui nous étreint tous à divers degrés, le décès d’un tiers pouvant être perçu comme une énième répétition de ce qui ne manquera pas de nous arriver un jour plus ou moins lointain sans que l’on sache à quelle date cela se produira.
À moins que cela ne soit dû aux problèmes personnels que je traversais et que j’éprouvais beaucoup de mal à affronter.
Je regardai autour de moi, tous ces visages fermés et recueillis. Je connaissais la plupart d’entre eux, certains depuis des années, d’autres depuis moins longtemps. Quelques-uns m’étaient totalement inconnus, certainement des parents ou des proches d’Allemagne, voire des personnalités, venus rendre un dernier hommage à leur ami disparu. Le vieux Rudolf avait en effet été, pendant des années, un capitaine d’industrie important et influent avant de prendre sa retraite en France.
Comme cela m’arrive parfois, et de plus en plus fréquemment ces derniers temps, j’essayai de me remémorer les pérégrinations complexes qui m’avaient conduit en ces lieux, avec tous ces gens, pour assister à un tel événement.
Le vieux Rudolf avait toujours été un sacré costaud et il devait encore peser son poids car les porteurs du cercueil paraissaient peiner sous la charge. Ils le déposèrent avec précaution sur les tréteaux installés au pied de l’autel et regroupèrent tout autour de lui les nombreuses fleurs et couronnes offertes à sa mémoire. Je comptai machinalement que, au moins pour la moitié d’entre eux, les textes inscrits sur les rubans étaient rédigés en allemand.
Les employés se retirèrent discrètement et la cérémonie religieuse commença.
Le recteur débita les formules habituelles de réconfort, qui malheureusement n’ont aucun effet sur moi, pas plus que sur beaucoup d’autres, j’imagine.
Mais a-t-on vraiment besoin de paroles de consolation au décès naturel d’une personne âgée de 90 ans ?
Je n’en suis pas persuadé même si je ne prétends pas être une référence en la matière. Malgré tous mes efforts, je ne peux croire que le défunt est toujours à nos côtés et que nous le retrouverons un beau jour, dans un ailleurs idyllique que je n’imagine pas.
Le prêtre fit appel à plusieurs reprises à des membres de l’assistance qui se déplacèrent jusqu’au micro pour lire les textes choisis pour la cérémonie. Ambiance étrange, sonorités gutturales et rauques, inattendues dans cette basilique bretonne peu habituée à accueillir des étrangers pour de telles circonstances.
Je ne crois pas que beaucoup des Français présents aient compris la langue de Goethe mais cela importait vraiment très peu. Les choses que l’on peut dire dans de tels instants sont très certainement universelles et, que ce soit en français, en allemand ou en chinois, les messages à destination des morts doivent tous avoir plus ou moins le même contenu.
Dehors la pluie qui menaçait depuis le matin s’était mise à tomber et l’on devinait, plus qu’on ne l’entendait vraiment, l’eau ruisseler contre les vitraux.
J’avais annoncé que je suivrais le cercueil jusqu’au cimetière et je regrettais à présent ma décision. Il me semblait que j’aurais été mieux avisé, en raison de la météo notamment, de rentrer chez moi sitôt la cérémonie religieuse terminée.
Le temps de la communion passé arriva celui du défilé devant le cercueil. Je suivis la procession qui descendit à pas lents les allées latérales tandis que résonnait, un peu trop vive à mon goût, la musique baroque du Concerto pour deux violons de Bach. Mon tour venu, je dessinai devant moi, au-dessus du cercueil, un vague signe de croix à l’aide du goupillon que me tendit mon prédécesseur et que je passai ensuite à la personne qui me suivait.
La pluie accéléra le mouvement au cimetière. L’affaire fut expédiée rondement par un ordonnateur des pompes funèbres dégoulinant de pluie qui resta malgré tout stoïque face aux éléments.
À l’invitation de la famille, tout le monde se retrouva dans le bistrot que je connaissais bien et que fréquentait également Rudolf de son vivant.
L’arrière-salle, connue seulement des habitués, avait été privatisée par la famille. J’y pénétrai à la suite du troupeau qui, après un séjour prolongé sous la pluie, exhalait une désagréable odeur de chien mouillé.
La pièce plutôt grande était chichement éclairée. Une seule fenêtre, dans le fond, ne laissait passer qu’une infime partie de la lumière de ce jour pluvieux. La décoration, si l’on peut employer ce terme, se limitait à la triste couche de peinture, aux couleurs ternies par les ans, qui recouvrait les murs. Dans un coin, un vieux piano hors d’âge faisait office de mobilier. Une table revêtue d’une nappe blanche était couverte de verres déjà remplis et d’assiettes pleines de cacahuètes et de petits gâteaux secs. Derrière elle, Sonia, la serveuse en chemisier blanc et courte jupe noire, se tenait prête pour assurer le service.
Hans et son épouse, tous deux largement sexagénaires, arrivés en tête du cortège, sacrifiaient à leurs obligations d’accueil, débitant les paroles attendues de remerciement et invitant chacun à se servir un verre déjà préparé ou à commander la boisson de son choix.
Hans me salua d’un signe de tête et me remercia de ma présence. Sans être intimes, nous nous connaissions assez bien. Il s’adressait à moi indifféremment en allemand ou en français.
Il utilisa ce jour-là la langue de Molière, qu’il parlait assez bien, ce que j’interprétai comme une marque de courtoisie à l’égard des locaux ayant assisté aux obsèques de son père.
En jouant des coudes, je parvins à saisir un verre qui avait échappé aux rapaces et glaner quelques cacahuètes dans une soucoupe déjà aux trois quarts vide. Je me dandinai d’un pied sur l’autre ne sachant pas trop vers qui me diriger. Tout naturellement, les Français s’étaient regroupés entre eux et les Allemands avaient fait de même.
L’obstacle de la langue… excuse bien connue pour ne pas faire l’effort de se mélanger.
J’étais un petit peu déboussolé en raison de mes problèmes personnels et je me tenais là, gauche et hésitant, quand j’aperçus Hector, seul avec son verre à la main, légèrement en retrait. Je pensai qu’il devait se sentir aussi isolé que moi et je m’approchai de lui pour ne pas rester comme un pauvre agneau abandonné et me plantai à ses côtés.
Je le connaissais depuis longtemps : il était un ami de mon père et de la même génération. Bien qu’il eût déjà dépassé les 70 ans, on ne le voyait habituellement qu’en habit de travail car il était toujours actif. Il avait, ce jour-là, fait un effort vestimentaire particulier ; il portait un costume en velours côtelé sur une épaisse chemise de laine. Cet habillement convenait parfaitement à son allure de vieux paysan madré, aux traits taillés à la serpe, à ses yeux noirs enfoncés dans leurs orbites et à son épaisse toison blanchie sous le harnais.
Il ne prononça aucune parole quand je vins près de lui mais je l’entendais soupirer lourdement par intermittence tandis qu’il secouait la tête de gauche à droite avec un regard désolé comme s’il portait sur ses épaules toute la misère du monde.
Il connaissait très bien le défunt et je comprenais aisément sa peine. Il s’occupait du jardin de Rudolf depuis que ce dernier s’était installé à Guingamp il y avait plus de vingt ans et, malgré les années, qui auraient dû le conduire à arrêter, il continuait à tondre les pelouses, tailler les haies, désherber les allées et exécuter d’autres tâches de cet acabit. Je restai planté là, en silence, content malgré tout de donner le change et d’avoir l’air d’être en compagnie de quelqu’un. Même si Hector ne manifestait aucun désir de parler avec moi, sa simple présence valait sur le moment un long discours.
Autour de nous, les boissons aidant, les discussions s’animaient, les voix se faisaient plus fortes, échauffées par l’alcool, quelques rires fusaient même çà et là.
Je commençai à balayer d’un coup d’œil circulaire l’ensemble de la pièce avec le projet d’arrêter mon regard sur toutes les personnes présentes. Je débutai naturellement par les Français, que je connaissais tous très bien. Il y avait notamment le patron du bar qui nous accueillait et le médecin traitant de Rudolf, qui étaient des amis proches. Nous nous connaissions depuis l’enfance et, même si nos chemins, professionnels notamment, s’étaient écartés, nous étions tous demeurés fidèles à nos racines guingampaises.
Comme de vieux complices, quelques Français s’étaient regroupés en un cercle fermé à tout étranger et discutaient, leur boisson à la main. À un moment donné, ils se mirent à trinquer et leurs verres s’entrechoquèrent en tintant. Alors que je me demandais à qui leur toast était destiné, Stéphane, le médecin, tourna la tête et son regard croisa le mien. Il parut surpris de me voir isolé dans un coin et fronça les sourcils. Ma place était avec eux, même si je n’en étais plus très sûr, et il me fit signe de les rejoindre.
Je saluai Hector et commençai doucement à me diriger vers le groupe où se trouvait mon vieux copain.
Je pris conscience que mon verre était vide et je décidai de faire un passage au bar et réitérer ma commande auprès de Sonia. Je levai mon godet devant moi et le tapotai du doigt pour expliquer à mon ami ce que je m’apprêtais à faire avant de le rejoindre. Stéphane, d’un sourire, me signifia qu’il m’avait compris et se retourna vers son équipe.
Je me frayai de nouveau un chemin vers la table où se trouvait la serveuse et, comme précédemment, réussis à renouveler ma consommation.
Une voix m’interpella en allemand. Je me retournai et fis face à un inconnu qui me demanda si j’étais bien le professeur d’allemand. Je répondis par l’affirmative et me retrouvai coincé par ce gêneur, qui se mit à me raconter par le menu des histoires qui ne m’intéressaient absolument pas. Je jetai un regard désemparé à ceux que je devais rejoindre en maudissant ce type qui me cassait les pieds. Politesse oblige, je dus subir son discours pendant plusieurs minutes avant de réussir à m’esquiver. Je prétendis que Hans venait de m’appeler et je dirigeai donc mes pas dans sa direction. Il était en pleine discussion avec l’un de ses compatriotes que je connaissais vaguement pour l’avoir croisé quelques fois à Guingamp. Je connaissais son nom, Dieter Klein, et savais qu’il possédait une propriété non loin de celle de Rudolf. Mon intention était de simplement les saluer tous les deux pour donner le change et de bifurquer pour rejoindre les Français.
Alors que je m’approchais, je fus surpris par l’attitude des deux hommes. Les yeux de Dieter lançaient des éclairs et Hans avait l’air gêné. Je résolus de ne pas les déranger et choisis de les contourner. Je me trouvai malencontreusement bloqué par un amas de personnes qui me barraient le passage et, bien malgré moi, je ne pus m’empêcher d’entendre la conversation entre les deux Allemands. Ils échangeaient dans leur langue mais, vous l’avez compris, je maîtrise cet idiome presque aussi bien que le français.
Je suis une personne plutôt réservée et je me sentais très mal à l’aise d’être le témoin involontaire de ce qui semblait bel et bien être une vraie dispute. Dieter, manifestement, se dominait pour ne pas crier mais je sentais dans sa voix une réelle colère qu’il s’efforçait de contrôler.
Je dois avouer qu’après les premiers instants de surprise, je ne pus m’empêcher d’écouter ce que disaient les deux hommes. J’avais, au tout début, surpris malencontreusement une conversation et j’avoue, à ma grande honte, que je tendais désormais l’oreille, sans vergogne, pour me convaincre que j’avais bien compris la teneur de leur échange.
Ce que je venais d’apprendre sans l’avoir désiré était tellement inattendu que j’en restai abasourdi et presque chancelant.
Hans, maintenant, essayait de calmer le jeu ainsi que son interlocuteur mais il était manifestement secoué par cette scène à laquelle, de toute évidence, il ne s’attendait pas. Il s’excusait et s’excusait encore et je fus pris au piège une fois de plus car, pour mettre un terme à sa discussion plus que houleuse avec Dieter, il opéra un repli en forme de : « Tiens, Jean-Paul, tu es là, je ne t’avais pas vu. »
Il se comporta avec moi comme si de rien n’était et Dieter, certainement soucieux également de ne pas étaler leur différend en pleine lumière, battit en retraite rapidement, s’excusa et s’éloigna.
J’échangeai quelques banalités avec Hans qui, je le sentais bien, n’était manifestement pas dans son assiette. Très vite, il chercha un motif valable pour s’éclipser et je pus enfin rejoindre le groupe où se trouvait Stéphane.
II
J’étais rentré chez moi harassé et désemparé. Le mauvais temps, les funérailles, l’alcool… et je m’étais senti si loin de mes amis, si différent.
Malgré leurs efforts pour se montrer chaleureux envers moi, un gouffre s’était installé entre nous.
J’étais affalé sur mon canapé, dans ma maison vide, aux lumières éteintes et où ne régnait aucun bruit. J’habitais à proximité du Trieux et j’apercevais, à travers les baies sans rideau de mon salon, une portion des passerelles qui s’élançaient, pour le bonheur des promeneurs, à l’assaut du cours d’eau.
Ma femme avait décidé de me quitter et elle était partie, emmenant dans ses bagages nos deux filles, c’est-à-dire une partie de moi-même, une partie de ma vie.
Les relations n’étaient pas au beau fixe entre nous depuis des années. Nous nous disputions assez souvent et notre dernier affrontement avait été très violent. Mais je n’aurais jamais pensé qu’elle franchirait le pas comme cela, qu’elle occulterait aussi rapidement et avec autant de détermination vingt ans de notre vie et de notre famille.
Avait-elle rencontré un autre homme, entrevu une autre existence ?
Je n’en avais aucune certitude mais cette hypothèse me tordait les boyaux. Je l’imaginais, gémissante, sous le corps d’un autre, le dos perlé d’une moiteur brûlante témoignant de sa jouissance.
Le décès du vieux Rudolf n’était rien en comparaison de ce manque. J’aurais donné la vie de dix comme lui en contrepartie du retour à la maison de ma femme et de mes filles.
Mais hélas, les choses ne se passent pas comme cela dans la vie. Un rêve fou ne peut se substituer à une triste réalité.
Je restais planté là, dans le noir, engoncé dans mon malheur, empêtré dans mes idées noires. Je ne dînerai pas ce soir encore. De toute façon, je n’aurais pu avaler la moindre bouchée et cela tombait bien car je n’avais ni le goût ni la force de me lever pour préparer quoi que ce soit.
Mon esprit était encombré par l’image de ma femme et de mes filles. Je ne savais pas où elles avaient trouvé refuge, quel traître infâme leur avait donné l’asile. Je n’osais même pas espérer que je manquais à mes princesses. Elles se trouvaient toutes deux dans cette tranche d’âge qui voit les petites filles se transformer en femmes, cette période maudite de l’adolescence ou même les enfants les plus charmants deviennent des personnes boudeuses et impossibles à vivre.
J’avais passé des heures et fait probablement plusieurs centaines de tentatives pour les contacter sur leurs portables. Jour après jour, j’avais appelé, appelé encore, à en user les batteries de mon téléphone, mais sans aucun succès. Ni ma femme ni aucune de mes filles ne répondaient jamais à mes efforts désespérés pour entrer en relation avec elles.
Et puis, un beau jour, j’avais accepté le fait que cela ne servirait à rien et j’avais renoncé. Renoncé à entendre la voix de mon épouse, celle de mes enfants, renoncé à lutter contre des forces hostiles qui m’étaient bien supérieures.
Je me sentais au bout de ma vie, sans force, sans volonté…
À quoi bon continuer désormais à faire semblant, à me lever le matin, à me traîner comme un misérable dans ce lycée pourri pour enseigner à des gosses effrontés une langue étrangère dont ils se moquaient comme de l’an quarante ?
J’avais été sauvé par les vacances qui, arrivées fort opportunément, m’avaient permis pendant plusieurs jours de vivre en reclus.
Les funérailles de Rudolf avaient été ma première sortie depuis longtemps. Je n’aspirais plus qu’à une chose : me retirer comme un ermite, seul au monde et pleurer, pleurer jusqu’à vider mon corps de toute sa peine, de le purger de toute cette misère qui le remplissait, de mourir… oui, de mourir !
Mourir, le mot était lâché !
C’est vrai, je pensais à la mort, j’aspirais à l’au-delà, au néant, je rêvais de la fin, de la dissolution de mon être dans le grand rien, de l’effacement du monde…
En finir… pour de bon.
Les larmes se mirent à couler malgré moi et je ne fis aucun effort pour les retenir ou les arrêter. Je les sentais ruisseler tout doucement sur mes joues en me brûlant la peau.
J’étais, à ce moment, au plus profond du malheur et je n’envisageais aucune issue à mes tourments. La souffrance était mon destin, je n’avais d’autre choix que de vivre avec elle.
Pourrai-je un jour me réveiller, comme d’un cauchemar, sans ressentir cette barre douloureuse qui me déchirait le ventre ?
Pourrai-je un jour de nouveau dormir d’un sommeil profond sans être extirpé du néant bienfaiteur par cette angoisse qui m’étreignait bien avant que les premières lueurs de l’aube n’aient commencé à poindre ?
J’étais noyé dans ces pensées moroses quand la sonnerie de la porte d’entrée déchira le silence morbide de ma maison.
Je sursautai.
Était-ce Christine qui revenait avec Morgane et Salomé ?
Mon sang ne fit qu’un tour et, le cœur battant, je bondis de mon canapé comme un diable hors de sa boîte. Je me précipitai dans le noir jusque dans l’entrée. Un poing impérieux cognait à présent contre la porte. Je me mis à crier :
— Voilà, voilà, j’arrive !
La clé ne se trouvait pas sur la serrure. Où avais-je bien pu la laisser ? Je trouvai l’interrupteur et la lumière inonda le hall.
Mais où avais-je bien pu fourrer ces foutues clés ? Je commençais à m’affoler et je hurlai de nouveau :
— J’arrive ! Je vais chercher les clés et je reviens tout de suite !
Je me précipitai dans la cuisine ou j’avais jeté ma veste et mes affaires au retour des obsèques de Rudolf. Je fouillai nerveusement ma pochette et trouvai heureusement ce que je cherchai.
Je retournai en courant dans l’entrée et fis jouer la clé dans la serrure. La porte s’ouvrit en grand et ma déception fut immense. La silhouette qui remplissait le cadre vide n’était ni ma femme ni aucune de mes filles.
Mon visiteur dut avoir une conscience immédiate de ma déconvenue car ses premières paroles furent des mots d’excuse. Il s’adressa à moi en allemand :
— Je suis désolé de vous déranger à une heure aussi tardive, mais il fallait absolument que je vous voie.
Le temps de retomber sur terre, de faire commuter mon cerveau engourdi du français à l’allemand, je dus lui présenter un visage tellement ahuri qu’il me demanda aussitôt d’un air soucieux :
— Vous me comprenez, n’est-ce pas ?
— Oui, oui, lui répondis-je vivement. Ne vous inquiétez pas, je vous comprends très bien, mais comment avez-vous eu mon adresse ?
Ces paroles semblèrent le rassurer sur la normalité de mon état, car un pâle sourire éclaira son visage. Il me jeta un regard soulagé mais en même temps gêné et il se mit à se dandiner d’un air emprunté sur le seuil de ma porte.
— Je vous ai trouvé dans l’annuaire du téléphone, m’expliqua-t-il.
De mon côté, je recouvrai peu à peu mes esprits, et, alors même que j’avais envie de lui claquer la porte au nez, la curiosité ou la courtoisie élémentaire l’emportèrent sur ma déception. Je lui demandai en quoi je pouvais lui être utile.
L’évidence m’apparut en même temps que je lui posai la question. Décidément, il m’en avait fallu du temps avant de réagir. C’était la première fois que Dieter Klein frappait à ma porte et cette visite inattendue était forcément liée à l’altercation de cet après-midi avec le fils de Rudolf. Je ne lui accordai pas le temps de me répondre et le laissai entrer. Ma réaction fut purement mécanique car j’avais autant envie de l’accueillir chez moi que de me casser une jambe. Mais je me sentis obligé de le faire. Il ne souhaitait certainement pas se confier à moi entre deux portes.
Je le précédai dans mon salon, fis jouer les interrupteurs et remis en forme à la hâte les coussins du canapé sur lesquels je m’étais morfondu. Il s’installa dans le fauteuil que je lui montrai du doigt et je m’assis en face de lui.
— Que puis-je pour vous ? lui réitérai-je.
Mon air sombre ne devait pas être très encourageant car il me regarda au fond des yeux et me dit, toujours en allemand :
— Je suis vraiment désolé de m’immiscer chez vous à cette heure mais vous êtes certainement la seule personne à qui je puisse me confier. Nous avons déjà eu l’occasion de faire connaissance et je sais que vous parlez l’allemand à la perfection…
Je levai modestement la main. Je parlais couramment cette langue, mais de là à utiliser le mot perfection, il y avait certainement un pas important qu’on ne pouvait franchir aussi aisément. Mais il était clair que l’essentiel ne se trouvait pas dans ces querelles sémantiques. Je le laissai continuer :
— Je voulais vous parler du différend que j’ai eu cet après-midi avec Hans Egerhard. Vous le connaissez bien, je crois – J’acquiesçai d’un hochement de tête. – Vous avez certainement entendu notre conversation, n’est-ce pas ?
Il m’adressa un regard interrogateur. Sans doute attendait-il de ma part une réponse, un commentaire…
Mais, malheureusement pour lui, je n’avais rien à lui dire si ce n’est que je n’avais rien à faire de ses histoires avec le fils de Rudolf. Seule l’éducation que j’avais reçue m’en empêcha. Je gardai le silence, ce qui le mit manifestement très mal à l’aise. Il se tortilla sur son siège, certainement surpris par mon attitude.
J’écartai les mains devant moi en haussant les épaules pour essayer de lui faire comprendre que je ne lui étais pas hostile mais que, vraiment, j’avais en ce moment d’autres soucis qui me paraissaient bien plus importants que sa dispute avec Hans.
Il resta la tête baissée pendant quelques secondes et revint à la charge.
— Vous avez compris de quoi nous parlions ? demanda-t-il. Cette conversation a dû vous étonner ?
Je repensai à la scène de l’après-midi. Ce que j’avais entendu m’avait bien évidemment surpris mais je ne voyais pas où Dieter voulait en venir. Cela ne me regardait en rien.
Je balbutiai :
— Oui… mais je ne vois pas…
Il me coupa brusquement la parole et enchaîna d’un ton indigné :
— Mais c’est une véritable ignominie. Vous avez compris qu’il insinuait que mon grand-père avait participé à l’occupation allemande de Guingamp pendant la guerre et qu’il ne s’était pas conduit de façon très honorable. Il n’a pas osé dire qu’il était un nazi mais si je ne l’avais pas interrompu, Dieu seul sait jusqu’où il aurait pu aller…
J’avais compris tout cela mais en quoi cela me concernait-il ? Mon grand-père et le sien devaient être de la même génération. Le mien avait défendu son pays comme il avait pu, le sien avait obéi aux ordres et suivi le mouvement. Tout cela me paraissait si loin et si vain par rapport à mes emmerdements du moment.
J’observai Dieter avec attention. Il devait avoir la cinquantaine, c’est-à-dire à peine quelques années de plus que moi, mais sa carrure était beaucoup plus imposante que la mienne. Il dépassait largement le mètre quatre-vingts et devait avoisiner le quintal. Il suffisait de le regarder pour deviner sa nationalité. Ses cheveux, ses yeux, son visage, tout en lui trahissait le Teuton. Malgré son indignation, il se dégageait de sa personne une sorte de force, d’assurance tranquille que j’aurais bien voulu ressentir en moi ces jours derniers.
Je haussai de nouveau les épaules comme pour dire : « Et alors ? »
Il comprit mon interrogation car il se pencha en avant et s’adressa à moi d’un air pénétré :
— Monsieur Keravial, je ne vous connais pas très bien mais j’ai confiance en vous. Vous parlez allemand et vous êtes la seule personne ici à qui je peux me confier…
Je sentais venir les embêtements à vitesse grand V et j’essayai aussitôt de m’échapper de ce piège que je voyais venir gros comme une maison.
— Certes, dis-je, mais je ne vois vraiment pas…
Il ne me laissa pas terminer ma phrase.
— Je vous en supplie, aidez-moi à tirer tout cela au clair. Mon grand-père était en Italie pendant la guerre. Il n’est jamais allé en France ! Je l’aurais su si cela avait été le cas.
Je comprenais son tracas mais je ne voyais pas en quoi je pouvais l’aider. Je parlais certes allemand, mais enfin, je n’étais certainement pas le seul dans la région. Par ailleurs, il devait y avoir de nombreux Allemands dans le coin qui connaissaient fort bien le français. Et puis, j’avais personnellement d’autres soucis qui me semblaient bien plus sérieux que les siens. Ma femme venait de me quitter sans préavis, emmenant dans ses bagages mes deux filles chéries.
Que pouvait-on imaginer de plus dramatique que cela ?
Il insista :
— Aidez-moi avant que je n’aille demander des explications à Hans car là, croyez-moi, je ne réponds plus de rien.
Je soupirai lourdement. Vraiment, il commençait à me gonfler et je ne savais plus comment m’en dépêtrer. Je ne pouvais pas le mettre dehors brutalement, je ne fonctionnais pas de cette façon. Je me dis que la meilleure manière de le faire quitter les lieux était de faire semblant d’accepter de l’aider. Une fois parti, je ferai simplement ce que je voudrai mais au moins je me serai débarrassé de lui.
— Je ne comprends pas ce que vous attendez de moi, lui dis-je. Je ne vois vraiment pas comment je peux vous aider.
— Vous êtes né à Guingamp, je crois. Vos parents sont encore vivants, vous connaissez du monde ici. Aidez-moi à prouver que mon grand-père n’a jamais mis les pieds dans cette ville, que je puisse rabaisser son caquet à ce prétentieux de Hans Egerhard.
— Mais je ne vois pas…
— Je vous le demande comme un service personnel. Aidez-moi à prouver que mon grand-père n’était pas l’homme que Hans prétend qu’il était. Aidez-moi à éviter un malheur, je vous en prie instamment.
III
Hermann ouvrit brusquement les yeux. Il était allongé sur son lit, dans la pénombre, et il venait de sursauter subitement. Une peur inexpliquée enveloppa progressivement tout son être comme un linceul glacé.
L’idée d’un cauchemar effrayant qui n’aurait laissé aucune trace dans sa mémoire lui traversa l’esprit. Mais non, ce n’était pas cela.
Il y avait autre chose, mais quoi ?
Saisi d’angoisse, il resta un instant hébété sans comprendre ce qui était en train de se passer ni même savoir où il se trouvait. De longues secondes lui furent nécessaires pour remettre ses idées en place. La pièce dans laquelle il se réveillait n’était pas sa chambre habituelle. L’obscurité qui l’entourait n’offrait pas l’opacité réconfortante qu’il connaissait.
Il balança un moment mais peu à peu, les choses se remirent en ordre et il recouvra tous ses sens.
Il logeait seul cette nuit-là, dans le pavillon de jardin qui se situait à proximité de la villa principale occupée par ses parents.
Un bruit insolite l’avait tiré d’un sommeil sans doute pas assez profond.
Une légère clarté perçait à travers les rideaux en fin coton et, à l’extérieur, le vent soufflait en rafales brusques, évoquant, malgré la saison, certains soirs d’automne annonciateurs de l’hiver. Il percevait le bruit caractéristique des ramures bruissant devant sa fenêtre.
Mais, il en était certain, ce n’était pas cela qui l’avait réveillé. C’était comme un couinement, une porte qui grince ou un portail qui résiste à une poussée qui se veut discrète.
Hermann tourna la tête en direction de sa table de chevet. Les chiffres lumineux du cadran de son réveil indiquaient deux heures du matin. Il écarta la couverture qui recouvrait son corps et s’assit sur son lit, à l’affût du moindre son. À présent bien réveillé, il s’approcha de la fenêtre et écarta le rideau. La nuit, éclairée par la lune, n’était pas totalement obscure et il distinguait sans peine tous les contours du jardin. Il se trouvait au premier étage et dominait aisément le terrain qui descendait en pente douce en direction de la ville. La végétation agitée par le vent se tordait, se courbait, se vrillait, se transformait et donnait naissance à une multitude de créatures étranges et fantasmagoriques.
Hermann scruta le jardin à la recherche de ce qui l’avait effrayé. Dans l’allée principale, conduisant au lourd portail en fer forgé, une ombre suspecte attira son attention. Il crut tout d’abord que ce n’était qu’une branche agitée par le vent, puis, constatant qu’elle ne bougeait pas de façon synchronisée avec les rafales, il se convainquit qu’il s’agissait d’autre chose.
Sans quitter le jardin des yeux, il rechercha ses vêtements à tâtons et s’habilla dans le noir. Il repéra une dernière fois où se trouvait l’arbre qui l’intriguait et quitta sa chambre en silence. Il descendit les escaliers quatre à quatre et ouvrit délicatement la porte d’entrée. Il manœuvra sans bruit et se glissa à pas de loup hors du pavillon de jardin.
Le vent soufflait de plus belle et la fraîcheur de la température nocturne le fit frissonner.
Il voyait parfaitement à présent l’allée principale qui déroulait devant lui sa surface plus claire que la végétation. L’ombre mystérieuse devait se trouver un peu plus loin, sur la droite. Il fit quelques pas avec précaution. Si un intrus se trouvait là, il entendait bien le débusquer et lui demander de s’expliquer.
La peur qui l’avait tiré du sommeil n’était plus à présent qu’un souvenir et il n’allait certainement pas se laisser impressionner par un indésirable, d’où qu’il vienne. Le fait qu’il soit un étranger dans ce pays n’autorisait aucune intrusion dans une propriété privée.
Il continua à avancer. Il distinguait parfaitement à présent l’arbre qui avait attiré son attention et ce qu’il avait cru, au début, n’être qu’une branche secouée par le vent.
Un rayon de lune éclaira soudainement la scène et il vit cette silhouette qui semblait surveiller la maison. C’était un homme qui, sans doute alerté par le bruit, tourna la tête. Un bonnet recouvrait ses cheveux, et leurs regards se croisèrent sans se voir car ils se trouvaient trop loin l’un de l’autre.
Hermann s’élança en criant :
— Hé ! Vous, là-bas… !
Mais l’individu s’était déjà évanoui dans la pénombre. Hermann devina, plus qu’il ne la vit vraiment, une forme humaine se glisser entre les deux grilles entrouvertes de la propriété et il entendit très distinctement les pas précipités d’une course qui battaient le revêtement de la chaussée.
Il se mit à courir et se retrouva sur la route en quelques enjambées. Une ombre s’enfuyait au loin et avait déjà atteint le prochain croisement. Hermann, piqué au vif, ne voulut pas s’avouer vaincu et prit ses jambes à son cou. Il était jeune, vigoureux et n’avait aucun doute sur sa capacité à rattraper le fugitif, qui lui avait semblé plutôt frêle et qui essayait de lui échapper.
L’inconnu s’engagea dans le chemin de l’Aqueduc et disparut à sa vue. Hermann connaissait bien le quartier. L’homme avait certainement bifurqué dans la rue de l’Hermitage.
Il accéléra et arriva juste à temps pour le voir dévaler la rue Montbareil et s’engager dans la venelle de Castel Pic. La manœuvre du fuyard consistait vraisemblablement à gagner les bois, où il serait presque impossible de lui mettre la main dessus. Hermann décida néanmoins de tenter sa chance et entama l’ascension du terrain herbeux d’où il espérait pouvoir repérer sa cible.
Arrivé à mi-pente, à peine essoufflé, il obliqua à gauche en direction des arbres. Il connaissait assez bien le coin pour s’y être promené à plusieurs reprises et savait que ses chances de réussite étaient maigres désormais. Il s’engagea cependant sous les frondaisons d’un pas prudent car, même si la nuit était claire, les embûches invisibles sur le chemin étaient nombreuses.
Hermann, conscient du lieu où il se trouvait et des possibilités de cachette qu’il offrait, s’arrêta soudain. Il tendit l’oreille pour essayer de se repérer au bruit. Il est illusoire normalement de se déplacer dans un sous-bois sans écraser des brindilles ou piétiner une branche tombée à terre mais, ce soir-là, avec le vent qui jouait dans les branchages et les buissons, il était impossible de déceler quoi que ce soit d’anormal.
La personne qu’il essayait de rattraper devait avoir une connaissance parfaite du terrain et savait se déplacer dans l’obscurité.
Les arbres agités par les rafales donnaient naissance dans la nuit à un bestiaire fantastique et effrayant, et Hermann fut soudainement saisi par le doute. Il se trouvait peut-être à la merci d’un dément, assez fou pour surveiller nuitamment sa maison, qui pouvait fondre sur lui à chaque instant, en brandissant un bras armé du premier rondin venu et lui fracasser le crâne.
Il scruta l’obscurité avec attention mais ne vit que les ombres menaçantes des arbres qui s’agitaient en tous sens. Il avait déjà parcouru une certaine distance et savait qu’il n’était désormais plus très loin de la chapelle Saint-Léonard. Encore quelques mètres et il pourrait retrouver une vraie route avec un éclairage digne de ce nom. Il distingua une table de pique-nique et sut qu’il était proche du but. Il se retrouva bientôt dans une descente au bout de laquelle se trouvait la rue de l’Yser. Il ne courait en principe plus aucun danger et connaissait l’itinéraire pour rentrer chez lui. Il vérifia par-dessus son épaule que personne ne le suivait et se mit en route.
Dans le feu de l’action, il n’avait pas eu le loisir de s’interroger sur la présence d’un inconnu dans la propriété de ses parents. Des tas de questions se posaient à lui maintenant à propos de cet homme qu’il avait surpris en train d’espionner chez eux.
Qui pouvait-il être et que cherchait-il au beau milieu de la nuit ?
Ses parents ne restaient que quelques semaines par an dans cette résidence secondaire et Hermann ne leur connaissait aucun ennemi.
Personne ne pouvait en avoir après eux.
Alors, la présence de l’intrus était-elle en rapport avec lui personnellement ?
Il passait beaucoup plus de temps que ses parents dans cette maison et ses liens avec la France étaient certainement plus resserrés. Depuis qu’il avait fait la connaissance de Manon, il envisageait même de s’y installer à demeure.
Son idylle avec une jeune Française avait-elle suscité des jalousies expliquant sa mise sous surveillance ?
Il eut une pensée pour la jeune femme. Ils s’étaient retrouvés aujourd’hui encore et il l’avait raccompagnée chez elle dans la soirée. Elle n’avait jamais mentionné aucun problème que sa relation avec un Allemand aurait pu créer.
Il se promit d’aborder ce sujet avec elle avec toute la prudence nécessaire. Il ne voulait surtout pas l’inquiéter avec ses histoires d’inconnu pénétrant chez lui sans raison.
Il avançait d’un bon pas dans les rues désertes. Il aperçut au loin deux hommes qui marchaient dans sa direction. Il se prépara mentalement à toute éventualité car il savait, par expérience, que les rencontres nocturnes peuvent parfois s’avérer périlleuses.
Il observait discrètement les deux hommes qui avançaient vers lui et jaugeait leur physique. Il s’agissait de deux jeunes gens, manifestement d’origine africaine, longilignes, qui avaient dû également repérer sa présence. Ils étaient deux mais pas spécialement athlétiques et il s’estima assez costaud pour en venir à bout en cas de difficulté.
Les trois jeunes gens se croisèrent sans dire un mot ni échanger un regard. Hermann avait pris soin de ne pas lever les yeux pour éviter de paraître provocateur et eux firent de même. Il ne regarda pas en arrière quand il les eut dépassés.
Il remonta la rue Montbareil et prit à droite dans la rue de la Brasserie. Il n’était plus très loin de chez lui.
Il se demanda s’il raconterait à ses parents son épopée nocturne.
Il en parlerait à son père très certainement. Il y avait manifestement des précautions à prendre en matière de sécurité et il devait en être informé.
Quant à sa mère, Angela, il valait mieux la tenir éloignée de tout cela. Elle pouvait prendre peur et ne plus vouloir venir dans cette propriété achetée par ses parents mais qui ne l’avait jamais vraiment attirée.
Cette réflexion le conduisit tout naturellement à avoir une pensée émue pour ses grands-parents. C’étaient eux qui avaient décidé, il y avait quelques années, d’acheter une maison dans cette région. Ce choix était surprenant et personne ne l’avait vraiment compris à l’époque.
Pourquoi s’installer à l’intérieur des terres alors que les côtes du nord de la Bretagne sont si belles ?