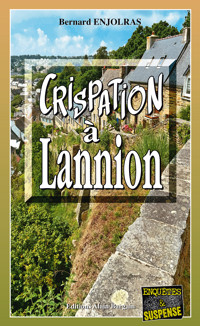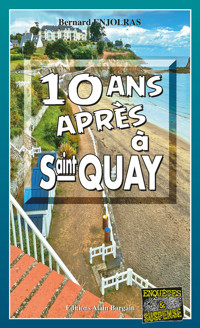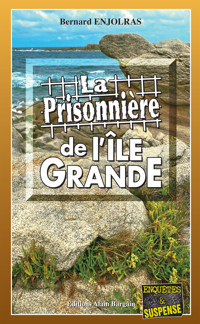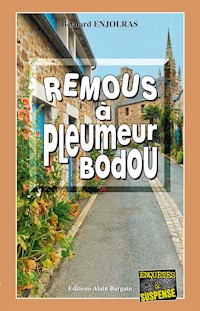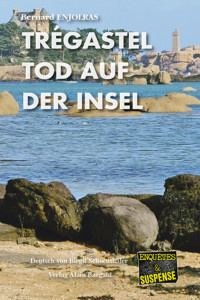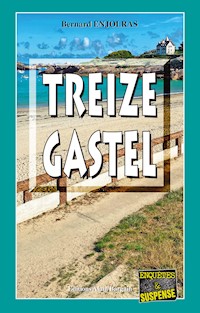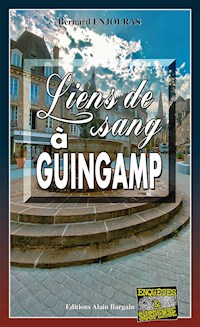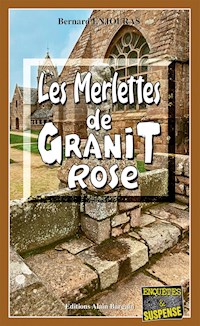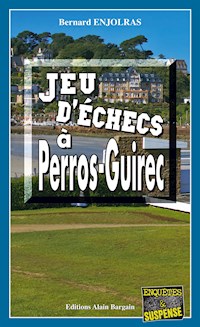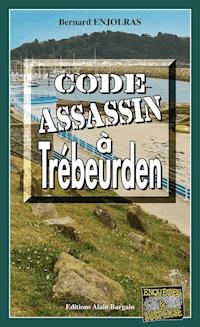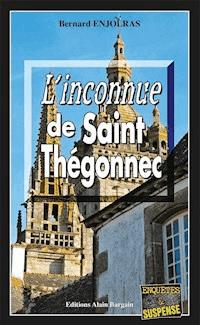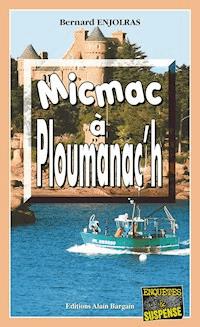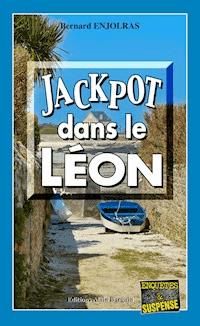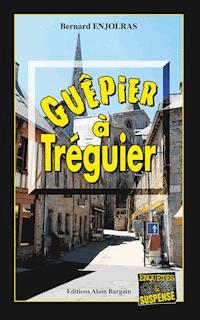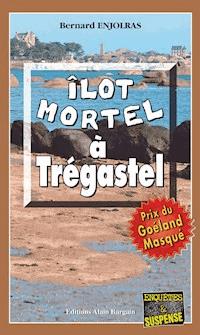
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes de Bernie Andrew
- Sprache: Französisch
Pourquoi diable, Bernie Andrew, célèbre auteur de romans policiers, a-t-il accepté l'invitation de Georges Brauman, chirurgien renommé ?
Ce dernier l'a convié, avec d'autres invités, à passer un week-end dans la petite île privée qu'il possède au fin fond des Côtes d'Armor. Une très forte tempête qui va immanquablement isoler les lieux pendant plus d'une nuit, est annoncée. Et c'est dans une ambiance d'autant plus pesante que le maître de maison s'avère être détesté de tous, que, soudain, les drames vont s'enchaîner.
La partie n'est cependant pas gagnée d'avance pour le ou les criminels, car "l'homme du métier" qu'est Bernie Andrew est témoin de cette nuit tragique.
Mais il en est aussi acteur… Saura-t-il ou voudra-t-il démêler l'écheveau infernal de cette affaire ourdie de façon machiavélique ?
Découvrez la première énigme à laquelle s'est confronté Bernie Andrew, au cœur d'une nuit tragique ! Ce polar régional a obtenu le Prix du Goéland masqué en 2011 !
EXTRAIT
— Alors, Charles, j’imagine que vous avez recherché, sur votre Internet magique des informations sur Trégastel ?
— Tout à fait, lui répondis-je, je me suis connecté sur le site de l’Office du Tourisme pour en savoir un peu plus. À première vue, il s’agit d’une petite cité qui m’a l’air charmante. Dommage que la météo ne soit pas exactement de la partie…
En effet, le ciel qui était très clair quand nous avions quitté Paris était traversé par des nuages qui semblaient se densifier au fil des heures.
— Vous avez raison, dit-il, on annonce une tempête. Vous aurez cette nuit une conjonction de mauvais temps et de fort coefficient de marée qui risque d’être assez passionnante et tout spécialement pour les amateurs de romans policiers…
— Ah bon ? Vous m’intriguez. Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre…
— Mon jeune ami, vous allez passer la nuit dans un vieux manoir, sur une île coupée du monde pendant plusieurs heures, dans un cadre parfait pour un crime comme vous les aimez.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un bon polar que j'ai lu en une après-midi sur la plage et qui a comblé toutes mes attentes. Du suspense, un cadre magnifique et un dénouement surprenant. -
Marie Loves Books
Un très agréable suspense classique. -
Claude Le Nocher,
Action-Suspense
Éditions Bargain, le succès du polar breton.
-
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Bernard Enjolras est né en 1952 à Lyon. Après une carrière professionnelle effectuée à France Télécom, il vit aujourd'hui à Trégastel au cœur même de la côte de Granit Rose. C'est ce cadre magique qui sert de décor aux premières enquêtes de son personnage fétiche : Bernie Andrew.
Îlot mortel à Trégastel a été récompensé par le Prix littéraire du Goéland masqué en 2011.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À mes parents.
I
À travers la fenêtre entrouverte, je vois le ciel bleu s’assombrir et se charger de lourds nuages sombres et menaçants. Le vent qui s’est levé forcit à grande vitesse de façon effrayante. Les arbres se tordent, malmenés par les éléments en colère. Leurs feuilles présentent tour à tour leur face verte et brillante puis leur face un peu grise et triste. Le bruit glacé des rafales qui se répandent en longues vagues sans fin apporte une touche de désolation, un je-ne-sais-quoi de fin du monde.
Un orage se prépare.
Je ressens cette impression bizarre que l’on a quand l’hiver arrive insidieusement, presque par surprise, alors que l’on sait bien pourtant que l’été est déjà loin et que l’automne se meurt tout doucement. On sent confusément qu’une époque s’achève, que quelque chose se termine, qu’il va falloir affronter des temps difficiles avec le froid, la brume, le vent, la nuit qui glace dès qu’elle a ravi la place à la lumière du jour.
Autour de moi, instinctivement, les gens relèvent leur col, se ressaisissent en quelque sorte, comme si chacun se devait de rassembler toute son énergie pour faire face à la soudaine froidure qui, d’un seul coup, nimbe d’une brume invisible la pièce dans laquelle nous nous trouvons.
La tempête qui s’annonce fait naître en moi des impressions diffuses. Tout mon être réagit, tous mes sens s’éveillent. Mon corps, ma peau, mes cheveux me transmettent un sentiment très ambigu, mélange de malaise et de bien-être que l’on éprouve quand la nuit tombe et que l’on sait que, dans quelques instants, on sera à l’abri dans son intérieur douillet et bien chauffé.
Ce brusque changement de temps me ramène plusieurs mois en arrière, loin de mon domicile, de ma famille et de mes amis. C’était à la fin de l’hiver, plus exactement au début du printemps. J’ai vécu alors une succession d’événements incroyables, inimaginables, extraordinaires qui, en l’espace de quelques jours seulement, ont bouleversé ma vie.
Mais permettez-moi de me présenter. Je m’appelle Charles Duquesne, j’ai vingt-sept ans et je suis plutôt ce qu’on a coutume d’appeler un beau garçon. Un mètre quatre-vingt-cinq, brun, les yeux clairs. La pratique régulière du sport depuis mon jeune âge m’a permis d’avoir une belle silhouette élancée et une allure plutôt décontractée. Il est vrai que, dans ma vie, j’ai consacré plus de temps à mon sport favori, le tennis, et aux sorties avec mes amis qu’à mes études. Cela dit, avec peut-être un peu plus de temps que les autres jeunes gens de mon âge, j’ai quand même réussi à décrocher un diplôme d’ingénieur chimiste. Pour être sincère, c’était plus pour faire plaisir à ma grand-mère qui m’a élevé que par intérêt véritable pour la chimie.
Ma passion depuis toujours, en plus du tennis où j’ai un très bon niveau amateur, ce sont les romans policiers. J’en ai lu plusieurs centaines et j’en possède de quoi remplir une bibliothèque assez fournie.
J’accepte et je reconnais totalement, sans la moindre réserve, la suprématie des auteurs anglais de la première moitié du vingtième siècle. Pour moi, ce sont les maîtres du genre – qu’ils soient hommes ou femmes d’ailleurs. Je ne conçois pas un roman policier hors du cadre d’un vieux manoir anglais perdu dans la campagne, avec un maître d’hôtel imperturbable, un crime impossible commis dans une pièce fermée de l’intérieur et, bien entendu, un détective à l’accoutrement désuet, un tantinet ridicule, qui pose des questions improbables et saugrenues, mais dénoue l’intrigue avec une clairvoyance stupéfiante dans les dernières pages du roman.
Depuis plusieurs années, j’étais tombé en admiration devant un auteur au patronyme anglo-saxon : Bernie Andrew qui, selon moi, avait réussi à retrouver le ton et à recréer l’univers des grands anciens. Dans ses romans, je retrouvais l’atmosphère des meilleurs auteurs britanniques, les intrigues les mieux ficelées, les dénouements les plus spectaculaires.
En apprenant que Bernie Andrew était français, de son vrai nom Bernard André tout bêtement, j’avais été, je l’avoue, un peu déçu, comme si j’avais été trompé personnellement. Mais très vite, cette déception s’était transformée en obsession de le rencontrer. Pendant des semaines, j’avais tout mis en œuvre pour savoir qui il était, où il vivait, où j’avais des chances de le croiser. Finalement, par le truchement d’un de mes camarades de promotion dont le père était propriétaire d’une galerie de peinture, j’avais réussi à me faire inviter à un vernissage où Bernie Andrew était attendu.
J’étais arrivé volontairement un peu tard pour lui laisser le temps d’être là. Quand j’entrai dans la salle où les œuvres étaient exposées, une foule déjà assez dense s’agglutinait devant les toiles, chacun discourant, un verre à la main, dans le brouhaha qui accompagne habituellement ce type de manifestation. J’eus un peu de mal à le localiser. J’avais vu sa photographie sur la jaquette d’un de ses romans, mais le monde réel et ses occupants sont souvent très différents du monde un peu virtuel de la représentation sur papier glacé.
Je le repérai enfin. Il était seul, pas aussi grand que moi mais d’assez bonne taille. Le cheveu grisonnant avec une petite moustache, l’air réservé, il contemplait les peintures de très près, les lunettes soulevées, à la manière des personnes qui ont des problèmes de vue. Je savais qu’il était français, mais, d’après son aspect, il aurait pu aussi bien être anglais ou italien ou même sud-américain.
Je l’épiai à distance pendant de longues minutes. Décidément, son air réservé, presque sévère, m’interdisait une approche que j’avais souhaitée hardie et amicale.
Je m’étais bien juré, si jamais un jour je le rencontrais, de m’adresser à lui en l’appelant « Maître », comme témoignage de mon respect à son égard. Au bout d’un moment, je pris sur moi et je me lançai :
— Bonsoir Maître, je suis très content de vous rencontrer.
Il se tourna vers moi, me décrypta en une seconde, repéra le gêneur et, d’un ton pas très engageant, me dit :
— Nous nous connaissons ?
— Non, Maître, je n’ai pas eu cette chance jusque-là. Je suis un de vos fervents admirateurs. Je crois que j’ai lu tous vos ouvrages et, si je puis me qualifier de grand amateur de romans policiers, je dois dire qu’avec vous j’ai retrouvé le genre d’énigme que j’apprécie tout particulièrement.
— Je vous remercie, je suis très content que mes livres vous plaisent.
Il s’éloignait déjà, insensible à la flatterie.
Je devais jouer plus serré et éviter toute flagornerie.
— Maître…
— Oui.
— Permettez-moi de me présenter…
Je me présentai en quelques mots. J’avais bien compris que je devais être concis. Je terminai en lui disant :
— Mon plus grand souhait serait d’écrire moi-même et, si je pouvais bénéficier de votre expérience et de vos conseils, je serais le plus heureux des hommes. Si un jour vous avez besoin d’un assistant, je serais heureux de mettre à votre service mes modestes compétences.
Il me regarda pendant plusieurs secondes, réfléchit un instant et me dit :
— Vous êtes ingénieur chimiste, avez-vous des compétences en matière de poison ?
Un frisson me parcourut l’échine, ça y est, j’avais réussi à percer la cuirasse.
— Maître, durant ma dernière année d’école, j’ai rédigé un mémoire dont le titre était Les poisons dans les grandes affaires criminelles.
— Vous avez une carte de visite ?
Fort heureusement, j’avais pensé à cette éventualité. Très vite, je lui remis ma carte.
— Merci, fut sa réponse.
Et, sans plus de commentaires, il s’éloigna de moi, me signifiant que, d’une part, notre conversation était terminée et que, d’autre part, essayer de la prolonger aurait été fort malvenu.
Je n’insistai pas, je me laissai engloutir par la foule et je rentrai chez moi.
*
Il ne se passa rien pendant plus de trois semaines. Je n’avais pas oublié ma rencontre avec Bernie Andrew, mais je me conditionnais pour ne pas y penser. J’avais tenté ma chance, manifestement sans succès, voilà tout. Il n’y avait pas de quoi fouetter un chat.
J’avais repris le cours de ma vie, enchaînant des CDD de chimiste peu qualifié. Décidément, cette spécialité ne m’attirait guère. Heureusement pour moi et pour mes finances, les leçons de tennis que je dispensais assez largement, me permettaient de tenir mon rang dans la société et de vivre somme toute de façon assez confortable.
J’habitais à cette époque dans le petit pavillon de ma grand-mère, en toute proche banlieue parisienne, à Montrouge. La maison n’était pas grande mais elle comprenait, à l’étage, un studio qui, depuis plusieurs années déjà, me donnait l’illusion d’être chez moi, indépendant, inséré comme tout un chacun dans une vie normale de salarié accomplissant quotidiennement les actes routiniers qui font la vie de la plupart de nos concitoyens.
Ma grand-mère avait toujours été très bonne pour moi, très prévenante, attentive, chaleureuse, maternelle. Je décelais en permanence dans son regard une sourde inquiétude, celle-là même qu’ont les grands-mères lorsque leur petit-fils leur annonce qu’il va remplacer une tuile endommagée sur le toit ou bien qu’il va partir faire du trekking au Népal.
Je me voulais proche d’elle et, chaque fois que cela était possible, je lui rendais visite pour prendre de ses nouvelles et lui montrer que j’allais bien.
Le rituel était bien réglé et son accueil était toujours le même :
— Tu vas bien, mon grand ?
— Mais oui, mamie, je vais bien.
— Tu sors encore, tu as dîné au moins ?
— Pas encore, mamie, je vais justement dîner avec des amis.
— Ah bon ! Tu ne veux rien ? J’ai fait une bonne soupe de légumes…
— Non, merci mamie, il faut que j’y aille là, je vais être en retard. Tu sais, la circulation dans Paris est terrible en ce moment. J’en ai au moins pour une heure avant d’arriver.
— Ah bon ! Eh bien, passe une bonne soirée, mon grand, sois prudent.
— Ne t’inquiète pas, mamie, à plus !
Comme chaque fois, je l’embrassais et je me hâtais vers ma voiture.
Un soir où nous jouions notre rituel, elle m’annonça :
— Charles, mon grand, quelqu’un t’a demandé au téléphone aujourd’hui.
— Ah bon, il a laissé un message ? Tu sais qui c’était ?
— Non, il a dit qu’il rappellerait ce soir à vingt heures.
Il était dix-neuf heures cinquante, je décidai donc d’attendre. À huit heures précises, le téléphone sonnait. Je décrochai sans tarder.
— Bonsoir, Charles Duquesne à l’appareil.
— Allô, je suis Bernie Andrew, comment allez-vous ?
— Je vais très bien, Maître, je vous remercie. Je suis très heureux que vous m’appeliez.
Fort de ma première rencontre avec lui, je restai très en retrait, un peu distant, presque détaché. Je ne voulais surtout pas laisser déborder mon enthousiasme.
— Peut-on se voir ? me proposa-t-il, je pense que je peux avoir besoin de vous.
— Quand vous voulez, Maître…
Le rendez-vous fut pris pour le lendemain en fin d’après-midi. Il habitait dans le quinzième arrondissement, pas très loin de chez moi, Rue Saint-Lambert, une petite rue calme que je ne connaissais pas, mais dans un quartier qui, à l’exception de sa rue, n’avait pas beaucoup de secrets pour moi. J’allais raccrocher quand il toussota :
— Oui, Maître ?
— Oui, justement, si vous pouviez ne pas m’appeler Maître, je crois que nos relations en seraient facilitées…
— Comme vous voulez, Maître, à demain.
Il en est des mots comme des vêtements. La mode en crée sans cesse de nouveaux, en fait revivre d’anciens, disparus depuis longtemps. Un qualificatif très en vogue en ce moment me semble convenir tout à fait à Bernie Andrew. Il s’agit de taiseux. Même si l’on n’en connaît pas le sens, on comprend aisément ce qu’il signifie.
Bernie Andrew était un taiseux. Il parlait peu et me semblait vivre hors du temps. Pour simple preuve, il écrivait tous ses manuscrits à la main. Si ce n’est un téléphone fixe, il ne disposait d’aucun outil moderne tel qu’ordinateur ou téléphone mobile. Lui parler d’accès à Internet équivalait à lui parler hébreu. Son instrument de travail était un crayon à papier dont l’extrémité était munie d’un petit bout de gomme rose qui pointait comme un bourgeon de jeune pousse.
— C’est une très vieille habitude professionnelle, m’avait-il dit un jour sans plus de précision.
Il lisait beaucoup, depuis les romans, les essais, en passant par les journaux jusqu’aux magazines très “people”. Il avait la manie de découper des articles dans tout ce qu’il lisait.
— Pour mes fiches, disait-il.
Mis à part la lecture et, ce que je découvris plus tard, la bonne chère, rien ne semblait l’intéresser vraiment. Il vivait seul, je n’ai jamais pu savoir s’il était célibataire, veuf ou divorcé. Son appartement était cossu, richement meublé. Sa pièce de prédilection était son bureau, encombré de milliers de livres, aménagé comme celui d’un vieil aristocrate anglais et donnant sur un magnifique jardin intérieur privé.
Pour l’avoir vu travailler, je peux témoigner que chaque mot écrit par lui était pesé, travaillé, relu, gommé, modifié, gommé à nouveau jusqu’à ce qu’il soit satisfait de son travail. Je crois même qu’au-delà du texte à proprement parler, il attachait de l’importance à l’aspect général de la page qu’il venait d’écrire.
Au début de notre collaboration, il me chargea d’une étude sur les poisons. Il rédigeait un nouvel ouvrage et il voulait que tous les éléments de son intrigue s’emboîtent au millimètre.
Tout y passa : les poisons violents, les poisons à effet retardé, les barbituriques, les laxatifs… leur aspect, leur couleur, leur conditionnement, leur présentation, les effets qu’ils produisaient sur les gens, comment l’on pouvait déceler qu’une personne en avait ingéré…
Il souhaitait savoir pour chacun d’entre eux où l’on pouvait se le procurer, à quelles conditions et même à quel prix.
Ce travail que je faisais à temps très partiel, me demanda plusieurs semaines. Je fis des recherches sur Internet, à la bibliothèque, je consultai des amis étudiants en médecine, j’allai même jusqu’à me replonger dans mes cours de chimie. Je fis le maximum pour lui remettre un résultat complet et soigné.
Cela dut lui convenir car il me commanda d’autres recherches. Puis il me demanda de lui taper ses manuscrits. Plus tard, il me chargea de lui organiser un premier déplacement, d’abord en province, puis à Londres.
Au fil du temps, je devenais son secrétaire particulier. Ce n’était pas un emploi à plein temps, mais je passais de plus en plus de temps chez lui.
Pourtant, il gardait toujours avec moi une certaine distance. Il m’appelait Charles et m’avait demandé de l’appeler Bernie. Je ne me permettais pas la moindre familiarité avec lui. Le sachant peu causant, je préparais avec soin des sujets de conversation pour chacune de mes visites. Cela m’était assez facile car j’aime bien parler et, dans ce domaine, je dois plutôt me restreindre que me forcer.
J’essayais d’agrémenter mon discours d’anecdotes amusantes que je glissais dans la conversation dès que je le pouvais.
Il n’était pas très bon public et ne riait pas très facilement. Les rares fois où j’arrivais à le dérider, il s’esclaffait pourtant de bon cœur, sans arrière-pensée me semblait-il. Je sentais bien cependant que j’étais encore loin d’avoir gagné avec lui cette espèce de familiarité que l’on réserve aux personnes que l’on considère comme des proches.
Je lui avais donné mon numéro de portable pour le cas, bien improbable, où il aurait besoin de me joindre en urgence.
Alors que j’étais un soir au restaurant avec des amis, je sentis le vibreur de mon mobile trembler contre ma poitrine.
Ce n’est toujours qu’à la quatrième ou cinquième sonnerie que je me rends compte que mon téléphone sonne. Je suis surpris à chaque fois et je me précipite pour prendre la communication en craignant de décrocher trop tard.
— Allô ! fis-je de façon un peu précipitée.
— Allô, Charles ? Bernie à l’appareil.
— Un instant, Bernie, je suis à vous.
Je quittai le brouhaha de la salle de restaurant pour me réfugier dans un endroit moins bruyant.
— Allô, Bernie, vous êtes toujours là ?
— Oui, Charles, dites-moi, êtes-vous libre le week-end prochain ?
Nous étions jeudi soir.
— Oui, Bernie, que se passe-t-il ?
— Rien de grave, me répondit-il, préparez une valise pour deux ou trois jours. Retrouvez-moi à Montparnasse samedi. Nous prenons le train de neuf heures cinq à destination de Brest. Je vous attendrai au début du quai.
— Aucun problème pour moi, Bernie, nous allons donc à Brest ?
— Non, pas à Brest, je vous emmène bien en Bretagne, mais dans les Côtes d’Armor, nous partons à Trégastel !
II
Bernie ne me parla quasiment pas durant la première partie du trajet. Je l’avais retrouvé comme convenu, un peu avant neuf heures, sur le quai de la gare Montparnasse. Il était déjà là. Nous avions deux places en vis-à-vis, en première classe. Il avait fait le plein de journaux et il resta caché derrière sa lecture quasiment jusqu’à Saint-Brieuc. Après que nous eûmes changé de train, il parut s’apercevoir de ma présence.
— Alors, Charles, j’imagine que vous avez recherché, sur votre Internet magique des informations sur Trégastel ?
— Tout à fait, lui répondis-je, je me suis connecté sur le site de l’Office du Tourisme pour en savoir un peu plus. À première vue, il s’agit d’une petite cité qui m’a l’air charmante. Dommage que la météo ne soit pas exactement de la partie…
En effet, le ciel qui était très clair quand nous avions quitté Paris était traversé par des nuages qui semblaient se densifier au fil des heures.
— Vous avez raison, dit-il, on annonce une tempête. Vous aurez cette nuit une conjonction de mauvais temps et de fort coefficient de marée qui risque d’être assez passionnante et tout spécialement pour les amateurs de romans policiers…
— Ah bon ? Vous m’intriguez. Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre…
— Mon jeune ami, vous allez passer la nuit dans un vieux manoir, sur une île coupée du monde pendant plusieurs heures, dans un cadre parfait pour un crime comme vous les aimez.
Je voyais dans ses yeux la petite lueur caractéristique de celui qui mijote un bon coup et qui s’en régale à l’avance. Il me regardait, tout réjoui, à l’affût de mes réactions. Le sachant casanier et guère attiré par les mondanités, je m’étonnai :
— C’est donc pour cela que vous avez accepté cette invitation. Vous voulez goûter personnellement au charme suranné de ces vieilles demeures et peut-être en faire le décor d’un de vos prochains romans…
— Peut-être, mais pas seulement. Il y aura aussi des personnalités fortes qui seront très intéressantes à observer. Je crois sincèrement que ce week-end sera très instructif, pour moi bien entendu, mais également pour vous. D’ailleurs, si vous avez toujours le désir d’écrire vous-même un roman policier je peux vous confier une mission qui vous intéressera.
— Je suis tout ouïe, Bernie, à quoi pensez-vous ?
— Eh bien…
Il se pencha en avant comme pour me confier un secret.
— Nous allons passer deux jours dans un cadre unique, une tempête s’annonce, nous serons quasiment coupés du monde, avec un peu de chance nous n’aurons plus d’électricité, si vous êtes d’accord, je souhaiterais que vous soyez le narrateur…
— Le narrateur ?
— Oui, à partir de maintenant, je vous demande de vous mettre en situation de témoin des quelques jours à venir. Vous notez tout ce qui se passe, vous vous imprégnez de l’environnement, bref, vous vous positionnez comme un écrivain qui prépare son prochain ouvrage.
Je n’eus pas le temps de répondre, nous arrivions en gare de Lannion, il était précisément treize heures et neuf minutes.
Bernie semblait bien connaître les lieux. Il se dirigea sans hésiter vers une brasserie en face de la gare.
— Nous avons une heure et demie pour déjeuner, m’informa-t-il. Cela sera bien suffisant. On vient nous chercher à quatorze heures trente.
De fait, à l’heure dite, nous étions à nouveau devant la gare avec nos valises.
« On vient nous chercher », avait dit Bernie sans plus de précision. Nous étions invités dans un manoir sur une île, je m’attendais donc à voir arriver une belle voiture ou un puissant 4x4. Quand je vis arriver une vieille Clio délabrée, je n’imaginais pas un seul instant que ce « On vient nous chercher » pouvait s’appliquer à elle. Mais quand sa conductrice en descendit, quand elle nous balaya d’un regard et vint vers nous, je dus me rendre à l’évidence et réviser ma position.
— Bernie Andrew ? interrogea-t-elle en se rapprochant.
— Moi-même, voici mon assistant, Charles Duquesne, madame Brauman, je présume ?
— Oui, je suis Brigitte Brauman, mon mari est désolé mais il n’a pas pu se libérer pour vous accueillir. Il m’a demandé de le remplacer… À moins que vous n’ayez des choses à faire à Lannion, nous pouvons nous rendre directement à Trégastel…
Je me souvins de la mission que m’avait confiée Bernie. J’observai madame Brauman avec attention, en essayant de rester le plus discret possible, tout en recherchant les mots qui pourraient la décrire. C’était une belle femme, fine, aux cheveux mi-longs certainement naturellement blonds mais dont la teinte était rehaussée grâce à une fréquentation manifestement régulière des meilleurs salons de coiffure. Elle était de taille moyenne et je lui donnais une quarantaine d’années. Sa beauté n’était pas tapageuse alors que son physique très distingué lui aurait facilement permis d’être très attractive. Elle était séduisante tout simplement. De son regard émanait de la tristesse et je devinais en l’observant un curieux mélange de distinction et d’effacement.
— Nous ne pourrons pas aller directement à Kastell ar Mor, annonça-t-elle. Il nous faudra attendre la marée. Nous aurons le temps de visiter rapidement Trégastel. Mais je crois que vous connaissez déjà, monsieur Andrew ?
— C’est une station et une région que je connais déjà, confirma-t-il, mais je suis certain que Charles sera très heureux de la découvrir, n’est-ce pas, Charles ?
Il se retourna vers moi et me lança un clin d’œil complice qui n’était pas dans ses habitudes.
Je n’eus pas le temps de répondre que déjà il continuait :
— Kastell ar Mor, c’est le nom de votre maison ou est-ce le nom de l’île sur laquelle elle se trouve ?
— L’île s’appelle l’île Kuzh, en breton Kuzh signifie caché. Vous comprendrez ce nom dès que vous verrez le site. Kastell ar Mor ça veut dire le château sur la mer. C’est une propriété que je tiens de famille. Autrefois, il n’y avait que les vestiges d’un vieux manoir. Nous y allions parfois pique-niquer avec mes parents et ma sœur. Jamais nous n’aurions pensé que ces ruines seraient un jour rénovées. Mais… vous connaissez mon mari, il a voulu tout reconstruire. Vous imaginez le coût d’une rénovation de nos jours, alors qu’il n’y a même pas une route d’accès digne de ce nom…
— Quel dommage ! s’écria Bernie, ce n’est donc pas un vieux manoir d’époque avec de vieilles boiseries et le fantôme de service qui vient tordre les orteils de ses descendants pendant leur sommeil ?
— Ah… mais vous ne serez pas déçu ! s’exclama Brigitte en souriant. L’ensemble a été refait dans l’esprit des propriétés du Trégor des années vingt. Les pièces sont spacieuses, hautes sous plafond, vous trouverez les boiseries que vous aimez tant, les vieux meubles lourds d’époque, le grand escalier d’honneur ; mais avec tout le confort moderne. Nous disposons même d’un groupe électrogène dans l’île. Il est vrai que, par grande tempête, nous avons parfois l’impression d’être seuls au monde. Il n’y a qu’un point pour lequel j’ai peur que vous ne soyez déçu, c’est le fantôme. Malheureusement pour vous, aucun spécimen n’a jamais daigné nous honorer de sa présence.
Mais déjà nous arrivions dans Trégastel. Madame Brauman avait programmé d’occuper notre temps d’attente obligatoire en nous faisant découvrir les sites caractéristiques de la station.
Dans la baie de Sainte-Anne, la mer avait largement commencé à baisser. Le panorama était surprenant de beauté. Dans le lointain, le phare de Ploumanac’h se dressait, fièrement érigé dans son écrin de rochers roses, défiant le temps des hommes, la mer et le vent qui commençaient à s’agiter.
Puis, la Clio bringuebalante nous transporta vaillamment, d’abord à la plage du Coz-Pors où nous admirâmes le front de mer et le très célèbre “dé” en équilibre depuis des millénaires.
Nous nous rendîmes ensuite à la plage de Tourony.
En face de nous, le château solidement campé sur l’île de Costaeres se préparait à affronter les éléments qui, sans nul doute, allaient se déchaîner dans la nuit. Les rocs de granit rose émergeant de l’eau, les rayons de soleil qui perçaient encore à travers le ciel tourmenté, transformaient le paysage en un décor somptueux. Je restai muet, presque impressionné par la majesté impérieuse de l’endroit. Ce fut Brigitte Brauman qui rompit le silence.
— Nous avons un peu de temps, nous annonça-t-elle, faisons quelques pas…
Nous contournâmes une petite colline et, au détour d’un chemin, elle s’arrêta. Bernie contempla le site avec intérêt. Il restait pensif quand Brigitte proposa :
— Si vous n’êtes pas trop fatigués, nous pouvons encore faire quelques pas sur l’île Renote. Nous serons toujours à temps pour la marée.
L’île Renote est en vérité une presqu’île. On y accède en voiture et un grand parking attend les visiteurs à l’entrée.
— Il faut vingt minutes pour faire le grand tour, dit Brigitte, nous pouvons commencer et puis, en fonction de l’horaire, nous verrons bien quand il sera temps de rentrer… L’impératif est que nous soyons à seize heures trente devant l’île Kuzh.
La promenade fut très agréable. Le vent très vif qui soufflait en rafales était chargé d’embruns qui nous mouillaient le visage. Le site était empreint de la touche de sauvagerie et d’authenticité qu’un vrai paysage breton se doit d’opposer aux intrus qui tentent d’en percer les secrets. Le chemin, large et bien dessiné, longeait la Manche. Devant nous, tout le long de la mer, un exceptionnel chaos granitique bordait l’eau sur plusieurs centaines de mètres. Sur notre gauche, un chapelet d’îles soulignait l’horizon. Curieusement, l’une d’entre elles, à moitié cachée, semblait enneigée.
— En face de vous, vous avez les Sept îles, répondit madame Brauman avant même que je n’aie posé la question. Vous voyez, celle qui est toute blanche, c’est l’île Rouzic, l’île aux oiseaux. De février à septembre, plus de vingt mille couples de fous de Bassan viennent s’y réfugier et c’est leur concentration qui lui donne cette couleur. Je vous garantis que ce n’est pas de la neige.
Nous étions arrivés à la pointe de la presqu’île. Le château de Costaeres qui, de ce côté, nous présentait son profil, avait toujours aussi fière allure.
Nous commencions à rebrousser chemin quand une jeune femme, venant à notre rencontre, s’approcha de nous pour embrasser madame Brauman.
— Tiens, Nolwenn, tu es là ! Je ne savais pas que tu viendrais ce week-end.
— Ce n’était pas vraiment prévu, répondit la jeune femme. Je me suis décidée au dernier moment.
— Laisse-moi te présenter à nos invités.
Tandis que madame Brauman expliquait qui nous étions, je contemplais cette jeune personne. C’était une toute jeune fille qui n’avait guère plus de vingt ans. Grande, mince, elle portait un long vêtement noir qui n’était pas boutonné, mais qu’elle maintenait fermé à l’aide de ses mains enfoncées profondément dans les poches. En parlant, elle faisait des mouvements avec ses bras qui ouvraient son vêtement et révélaient des jambes magnifiques, gainées de noir et recouvertes jusqu’à mi-cuisses seulement par une jupe assez courte. Je la trouvai très élégamment vêtue pour marcher dans le vent et les embruns. Ses cheveux longs étaient très bruns et très beaux. Mais ce qu’il y avait de plus marquant dans son apparence, c’étaient ses yeux bleus, profonds comme la mer.
Madame Brauman nous la présenta comme étant sa petite-cousine, ce qui en Bretagne, comme chacun le sait, n’a pas grande signification en ce qui concerne le lien de parenté qui peut exister entre les personnes. Quand j’appris qu’elle était étudiante à Rennes, je me mis à envier les camarades de cette jeune fille aussi belle. Lorsque nous nous séparâmes, j’espérais vaguement au fond de moi avoir la chance de la croiser pendant les quelques jours que nous devions passer ici.
— Cette fois, il va être temps d’y aller, nous dit Brigitte.
Après avoir rejoint la voiture et roulé quelques minutes seulement sur un chemin de terre à l’ouest du village, nous stoppâmes sur un petit parking perdu où, curieusement, plusieurs véhicules stationnaient déjà.
Un homme était là qui, vraisemblablement, nous attendait. Très maigre, noueux, il nous regardait d’un air méfiant de ses petits yeux vifs, intensément bleus. Il était assis aux commandes d’un tracteur agricole auquel était attelée une remorque assez haute.
À notre arrivée, il sauta de son siège et s’approcha de la voiture.
— Ça y est ! Nous sommes là, Yannick ! dit Brigitte. Si tu veux bien charger les bagages de nos invités, nous allons pouvoir y aller. Tout le monde est déjà arrivé ?
— Je crois bien, grommela-t-il, je vais faire encore un aller-retour si jamais il y avait des retardataires.
Yannick chargea nos bagages et nous aida à grimper dans la remorque qui était équipée de sièges en bois plutôt sommaires.
— Tout le monde est bien installé ? interrogea-t-il, cramponnez-vous, c’est parti !
— Yannick Le Brann, c’est le gardien du Kastell, nous expliqua Brigitte. Ici tout le monde l’appelle Yannick ou Père Yannick. Il vit à demeure dans l’île avec sa femme, Maï. Ils ont une petite maison à côté du manoir.