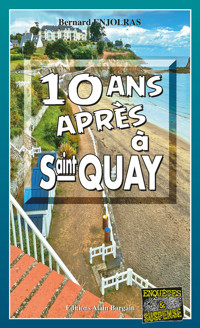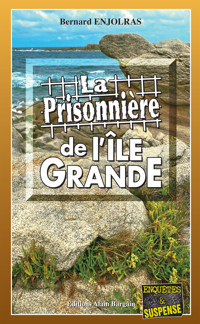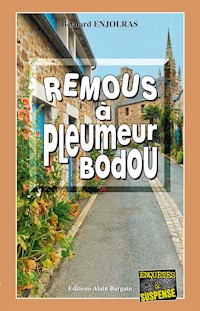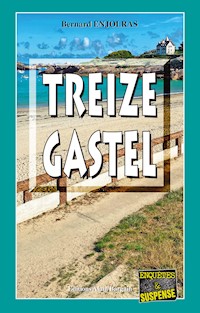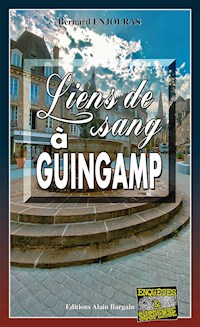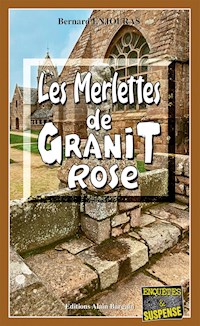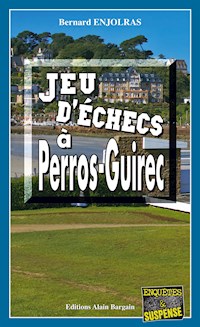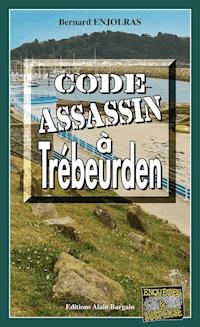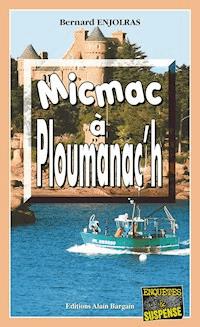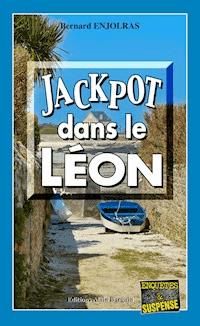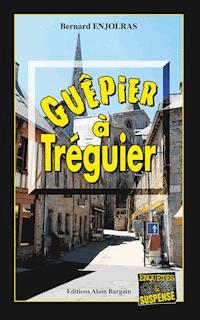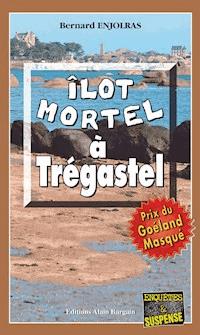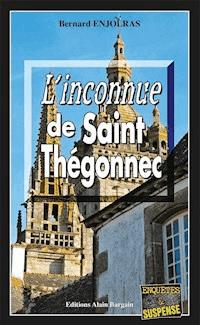
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les dossiers secrets du commandant Forisse
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Une affaire retorse pour le commandant Forisse et Clémence.
S’il est une chose que Clémence voulait à tout prix chasser de son esprit, c’était bien la vision cauchemardesque de ce cadavre découvert par un hasard malheureux dans une longère abandonnée. Mais c’était sans compter sur le caractère obstiné du commandant Forisse, à qui elle s’était imprudemment confiée. Le flic mal embouché, sous le coup d’une suspension administrative, et la jeune adolescente paumée se mirent en tête de faire toute la vérité sur cette affaire. Ils ne se doutaient pas que leur enquête allait les conduire bien au-delà de la simple mise au jour d’une dépouille oubliée.
Plongez dans ce second tome haletant des dossiers secrets du commandant Forisse et suivez pas à pas les investigations d'un duo surprenant, bien décidé à découvrir la vérité sur un cadavre oublié...
EXTRAIT
L’interrogatoire se poursuivit afin de connaître les lieux et les personnes que fréquentait la victime. Simon nota soigneusement les noms de plusieurs bars, boîtes de nuit ainsi que les identités de plusieurs individus qu’il faudrait interroger sans tarder. Les deux gendarmes remercièrent madame Maillé pour son concours et la libérèrent. Elle souleva sa lourde carcasse et quitta pesamment les locaux de la gendarmerie. Keroual la suivit un instant du regard tandis qu’elle s’éloignait d’une démarche fatiguée. « Il y a des gens qui n’ont pas de chance dans la vie », pensa-t-il.
A PROPOS DE L'AUTEUR
Né à Lyon,
Bernard Enjolras vit depuis de nombreuses années à Trégastel. C’est là qu’il écrit, au cœur de la magnifique Côte de Granit rose. Dans ce onzième roman, le lecteur retrouve le commandant Forisse, ce vieux flic aigri et fatigué, découvert dans
Jackpot dans le Léon.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 349
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
À mon bon Gardozier.
REMERCIEMENTS
À Michèle Jacques, Marc Reveillère, Jean-Yves Le Fichous,
et
À toute l’équipe des Éditions Alain-Bargain.
PROLOGUE
Ça y est ! C’est terminé !
La dernière épreuve est passée. Il ne reste plus qu’à attendre les résultats.
En réalité, je ne suis pas inquiète du tout.
Le bac, aujourd’hui, tout le monde l’obtient sans difficulté. L’Éducation nationale demande aux correcteurs, paraît-il, d’ajouter quatre à cinq points à chaque copie.
Pas étonnant qu’il y ait autant de mentions.
Moi, pour être honnête avec vous, je vise la mention très bien. Même si cela ne veut plus dire grand-chose en termes de niveau scolaire, j’en ai besoin pour être admise en khâgne.
Je parle de tout ça sur un ton qui peut vous paraître léger, voire suffisant, mais j’ai pleinement conscience d’être revenue de très loin.
Si ma vie ne s’était pas subitement transformée en tragédie, il y a quelques années, je serais sans doute aujourd’hui sans emploi ou, au mieux, avec un petit boulot de misère, peut-être déjà mère de famille, très certainement célibataire, avec, pour tout avenir devant moi, la ligne d’horizon du bar d’un bistrot de campagne.
C’est Forisse qui m’a permis d’échapper à ce destin qui ouvrait tout grand ses bras devant moi.
Forisse, vous ne le connaissez sans doute pas, mais c’est un flic, un commandant de police, un vieux poulet fatigué, comme il se définit. Le genre grognon, râleur, jamais content, qui n’obéit qu’à lui-même et ne supporte aucune hiérarchie au-dessus de sa tête.
J’avais fait sa connaissance lors de la disparition de mon père. Forisse était, je l’ai appris beaucoup plus tard, suspendu de ses fonctions pour une faute assez grave, et passait quelques semaines dans le village où j’habitais avec mes parents. C’est lui qui avait soufflé aux gendarmes les solutions pour retrouver mon petit papa chéri.
Il m’a prise sous son aile, m’a sortie de mon collège de campagne et m’a inscrite dans le meilleur lycée de Rennes.
Quand j’y pense !
Il est vrai que je n’étais pas très bien partie dans ma vie d’avant. Je ne m’en rendais pas compte à l’époque, mais mon environnement, notamment scolaire, n’était pas des plus reluisants.
Et puis, vous ne vous en souvenez peut-être pas, après la disparition de mon père, il y avait eu la découverte de son cadavre au fond d’une cave où il avait été séquestré, l’arrestation de ma mère, sa condamnation par la cour d’assises à plusieurs années d’emprisonnement.
J’avais été confiée à une parente éloignée. Une femme déjà âgée qui, la pauvre, faisait ce qu’elle pouvait avec ses maigres moyens.
Forisse était allé la trouver et lui avait proposé de s’occuper de mon éducation. Il s’engageait à prendre en charge tous les frais : scolarité, pension, habillement, transports…
Lui-même avait obtenu sa mutation à Rennes pour pouvoir m’accueillir tous les week-ends.
La cousine Guénolé, qui avait tout de suite compris qu’elle n’aurait rien à payer pour moi, s’était empressée d’accepter avant que ce policier atypique ne change d’avis.
La transition avait été rude. Je découvrais la vie en pension, une approche du travail scolaire dont je n’avais aucune idée, l’émulation, la compétition, la recherche de l’excellence…
Il faut dire, même si ce ne sont pas des circonstances que je peux invoquer, que je venais de perdre mon père que j’adorais, que ma mère se retrouvait en prison et que j’avais été à deux doigts de mourir dans un incendie que j’avais volontairement allumé…
Lourd à assumer !
Forisse m’avait non seulement sauvé la vie en m’arrachant aux flammes, mais il s’était de surcroît arrangé avec les gendarmes pour faire passer cet incendie volontaire pour un simple accident, m’évitant ainsi de nombreux problèmes avec la justice.
Je lui dois plus que beaucoup ; en fait, je lui dois tout.
Mais je ne vous parle pas de tout ça sans raison.
J’avais en tête depuis longtemps de raconter l’enquête menée par Forisse juste après le décès de mon père.
Cette affaire n’a rien à voir avec la fin tragique de mon petit papa. Je dirais que les deux intrigues se sont succédé chronologiquement et que, dans les deux cas, le commandant est intervenu de façon totalement déterminante.
Juste après ma dernière épreuve du bac, le bon moment pour rapporter ce qui s’est passé, me paraît arrivé.
J’ai assisté personnellement à certaines scènes qu’il me sera facile de relater. Pour d’autres, vécues par Forisse, je n’aurai aucun mal à les raconter puisqu’il me les a décrites en détail. Pour certaines enfin, auxquelles ni Forisse ni moi n’avons participé, je devrai reconstituer les choses telles que j’imagine qu’elles ont dû se passer.
Mon objectif est que mon récit soit clair et compréhensible par tous. Je n’ai pas la prétention de lui apporter la touche de suspense qui conviendrait, mais enfin… sait-on jamais ?
Je me souviens…
J’étais complètement déboussolée à cause de la disparition de mon père et j’étais partie faire un tour avec ma meilleure copine de l’époque, Margaux Lopreden.
Tout me revient à la mémoire comme si c’était hier.
C’était un dimanche après-midi, un 8 novembre.
Nous étions parties nous promener avec deux copains à elle qui, n’ayant pas obtenu de nous ce qu’ils voulaient, nous avaient abandonnées en pleine campagne.
Il pleuvait, il faisait froid, nous étions frigorifiées…
Après avoir erré dans la campagne, nous étions tombées sur une espèce de longère perdue au milieu des champs. Nous en avions forcé la porte et c’est là que l’affaire dont je vais vous parler avait commencé…
I
Quelques années plus tôt
Après l’incendie, j’avais été conduite à l’hôpital par les gendarmes. Forisse m’avait accompagnée et je me souviens que le premier visage que j’avais aperçu à mon réveil était le sien.
Il était assis dans un fauteuil où il avait dû passer la nuit. Il me regardait d’un œil presque attendri, ce qui lui donnait une apparence très différente de son air de bouledogue habituel.
— Ça va, Clémence ? me demanda-t-il d’une voix douce. Tu es réveillée ?
J’acquiesçai d’un mouvement de tête, un peu désorientée de me réveiller dans ce lit et cette chambre inconnus. J’ignorais où je me trouvais et il me fallut plusieurs secondes pour me souvenir que j’avais été conduite à l’hôpital.
Je restai plusieurs jours dans cet établissement. Le jeune lieutenant de gendarmerie que je connaissais déjà vint me rendre visite à plusieurs reprises. Il souhaitait savoir ce que je faisais dans la boutique en flammes de mon père, comment le feu avait démarré, etc.
Forisse m’avait préparée à ces interrogatoires répétés et je répondis aux questions du gendarme conformément à ce que nous avions prévu. En fait, j’en disais le moins possible en prétextant le choc émotionnel que j’avais subi.
L’idée était de faire croire que l’incendie de l’entrepôt et du magasin était accidentel et que je m’étais retrouvée piégée au milieu de tout ça.
La réalité était bien différente, car c’était moi qui avais mis le feu. Je voulais en finir et je n’avais rien trouvé de mieux que de tout embraser et de m’immoler comme un quelconque bonze du Viêtnam.
Le lieutenant Marceau, vraiment très sympa, se comporta comme s’il me croyait sur parole. En réalité, je n’ai jamais su si cela était vraiment le cas ou s’il avait seulement eu pitié de moi.
À la fin de notre premier entretien, il me parut soudainement très gêné.
— Vous avez de la famille dans la région ? interrogea-t-il.
Je savais que mon père avait des cousins quelque part du côté de Saint-Pol, mais je ne les connaissais pas vraiment. Je fis une moue dubitative.
— Pourquoi ? demandai-je.
— Vous êtes mineure et vous n’avez nulle part où aller. Nous devons vous trouver un lieu d’accueil.
Je n’avais pas du tout pensé à cet aspect de la question. J’avais cru naïvement que je pourrais rentrer chez moi, retourner à l’école comme si de rien n’était, reprendre ma vie, mais ce n’était pas possible.
J’étais mineure !
Une vague de panique me submergea. On allait me confier à la DDASS le temps de trouver un parent éloigné qui veuille bien me prendre en charge.
Je fus incapable de prononcer le moindre mot pendant plusieurs secondes. Je parvins finalement à balbutier :
— Je pourrais en parler au commissaire ?
À l’époque, dans le village, tout le monde appelait Forisse « commissaire », je n’ai connu son véritable grade que beaucoup plus tard.
Un sourire éclaira le visage du lieutenant.
— Au commissaire ? reprit-il, très bien je vais l’appeler.
Forisse proposa une solution provisoire qui fut fort heureusement acceptée par tout le monde.
Je resterais chez son amie Nelly, le temps pour les services sociaux d’organiser mon accueil dans ma famille paternelle.
Nelly, je la connaissais un peu, au moins de vue, ainsi que sa fille. Elle était serveuse chez Louis, et c’est là que Forisse avait fait sa connaissance. Elle était devenue assez rapidement sa maîtresse. Elle n’avait pas très bonne réputation dans le village, trop sexy, trop portée sur les hommes, mais elle était cool et, finalement, j’étais plutôt contente d’être hébergée chez elle.
Le soir où je quittai l’hôpital, Forisse m’emmena dîner au restaurant. J’étais surprise de le voir aussi détendu. Il était beaucoup plus drôle que je n’aurais jamais pu l’imaginer.
Il me raconta des tas d’anecdotes marrantes, des histoires de sa jeunesse. Il me parla aussi de mon père et de ses obsèques qui devaient avoir lieu le lendemain.
À la fin du repas, il se pencha vers moi et, en baissant le ton, me dit :
— Tu te souviens de ce que tu m’as raconté quand je t’ai sortie des flammes ?
Je jouai l’étonnée.
— Non, je ne me souviens pas.
Il plongea son regard au plus profond du mien et je sentis qu’il me serait très difficile de ne pas lui révéler ce qui s’était passé.
— Tu m’as dit que, pendant ton escapade avec ta copine, tu avais vécu une expérience horrible. J’ai eu l’impression que tu avais rencontré le Diable en personne. Tu veux bien m’en parler ?
J’étais embêtée par cette demande. J’avais décidé d’occulter de ma mémoire cet épisode douloureux et voilà que Forisse remettait ça sur le tapis. D’un autre côté, j’avais mauvaise conscience à lui cacher la vérité, car il s’était montré vraiment sympa avec moi et m’avait évité un détour par la DDASS. Je décidai de tout lui dire.
— C’était un dimanche après-midi, commençai-je, j’étais avec Margaux. Deux copains à elle nous avaient laissées tomber en pleine campagne. Il pleuvait et il faisait froid…
Forisse m’écoutait sans rien dire. Ses yeux étaient braqués sur moi et je le sentais bienveillant à mon égard. C’est étrange mais je n’avais jamais décelé jusqu’alors une telle douceur dans son regard. Je savais par expérience qu’il était capable de se montrer odieux et cette attitude nouvelle m’étonnait. Je continuai :
— Il faisait sombre et nous avions besoin d’un abri pour nous protéger de la pluie, nous réchauffer et peut-être même passer la nuit… Nous avons marché longtemps et, au bout d’un long moment, nous avons aperçu une longère derrière un champ. Nous avons traversé dans la boue et nous nous sommes approchées de la maison, qui semblait inhabitée. Nous avons essayé d’entrer, sans succès au début, puis, en forçant un petit peu la porte, nous avons réussi à y pénétrer…
L’expression « forcer un petit peu la porte » amusa Forisse, car il se mit à sourire d’un air ironique. Cela me déstabilisa car je crus, au début, qu’il se moquait de moi. Voyant ma mine déconfite, il m’expliqua la raison de son hilarité et je poursuivis :
— L’odeur était épouvantable, expliquai-je. La maison n’avait certainement pas été aérée depuis des mois. Il n’y avait pas de lumière non plus et nous avons dû nous déplacer dans le noir.
— Vous n’aviez pas vos portables pour vous éclairer ?
— Les batteries de nos téléphones étaient presque à plat et nous étions obligées de les économiser au maximum.
— Très bien, et alors, que s’est-il passé ?
Je me remémorais la scène que nous avions vécue et je ne pus m’empêcher de frémir. Forisse posa sa main sur la mienne pour me réconforter et m’encouragea à poursuivre.
— Nous avancions dans le noir… En fait, j’étais collée à Margaux, qui marchait devant moi. À un moment donné, je ne me souviens plus très bien, Margaux a trébuché contre un tapis ou quelque chose qui traînait sur le sol et nous sommes tombées toutes les deux par terre. Pour se relever, elle s’est appuyée contre…
Peur rétrospective, les mots restèrent bloqués au fond de ma gorge. Forisse me tendit un verre d’eau que j’avalai d’un trait.
— Margaux s’est appuyée contre quelque chose, insista-t-il. De quoi s’agissait-il ?
Je fermai les yeux. J’avais du mal à respirer normalement.
— C’était un cadavre, murmurai-je dans un souffle.
— Un cadavre ? Mais comment peux-tu en être sûre ? Tu viens de me dire que vous n’aviez pas de lumière.
— Il restait un peu de batterie à Margaux et elle a sorti son téléphone pour voir clair. C’était bien un cadavre… Un homme qui portait un chapeau. Il était assis dans un fauteuil et on avait l’impression qu’il nous regardait… C’était affreux, je m’en souviens comme si c’était hier et j’ai ce corps sans vie sous les yeux en permanence.
— Et qu’avez-vous fait ?
— Je ne sais vraiment. Nous avons hurlé, je crois, et nous sommes parties en courant comme des folles.
Cette évocation me bouleversa et je fus incapable de prononcer une parole pendant plusieurs secondes. Forisse respecta mon trouble et ne fit aucune tentative pour m’inciter à poursuivre. Quand il se rendit compte que j’avais retrouvé mes esprits, il redemanda :
— Et qu’avez-vous fait ensuite ?
— Nous étions complètement affolées. Je ne me souviens même pas comment nous avons quitté la maison. Nous avons couru sous la pluie, comme ça, au hasard, droit devant nous… Nous nous sommes retrouvées sur une route goudronnée et nous avons aperçu une espèce d’abri pour les bus, où nous avons trouvé refuge. C’est là que nous avons passé la nuit, à grelotter, serrées l’une contre l’autre… sans fermer l’œil… Au matin, un car est passé, que nous avons pris et c’est comme ça que nous avons retrouvé notre chemin.
— Et c’est à ce moment que tu es rentrée chez toi ?
J’acquiesçai et Forisse poursuivit :
— Comment tu as su pour tes parents ?
— À la maison, nous sommes abonnés au journal. Il est déposé tous les matins dans la boîte aux lettres. J’ai vu la photo de ma mère en première page et, en lisant l’article, j’ai appris tout ce qui s’était passé.
Forisse hocha lentement la tête à plusieurs reprises. Il devait réfléchir à ce qu’il fallait faire désormais.
— Tu as parlé de tout ça à quelqu’un ? m’interrogea-t-il.
— À part vous, à personne.
— Et ta copine ?
— Margaux ? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. À mon avis, elle n’en a parlé à personne non plus.
Forisse regarda sa montre et jugea qu’il était temps de rentrer.
La musique jouait en sourdine dans sa voiture et nous n’échangeâmes pas une parole durant tout le trajet.
Il m’accompagna jusqu’à l’appartement de Nelly, où il me fit entrer. Le logement était vide, Nelly devait être de service chez Louis ce soir-là.
Forisse me montra ma chambre. Un sac de voyage contenant mes affaires se trouvait sur le lit. Je me préparai à me coucher.
Le commandant me dit qu’il allait s’installer au salon en attendant que Nelly arrive. Il semblait bien connaître la maison. Je l’observai de loin et le vis s’asseoir dans un canapé, un verre d’alcool à la main.
Je dus m’endormir car je ne refis surface que le lendemain matin. La radio diffusait une musique de vieux qui me réveilla. Il me fallut un peu de temps pour comprendre dans quelle chambre je venais de passer la nuit. Je me levai et tombai nez à nez avec Nelly, qui prenait son café dans la cuisine.
Elle prépara mon petit-déjeuner tout en discutant de choses et d’autres. C’était une femme très bavarde. C’était certainement une qualité dans son travail, mais je me dis que dans la vie de tous les jours cela devait se révéler parfois un peu fatigant.
Elle m’annonça que Forisse passerait dans la matinée. C’était le jour des obsèques de mon père et c’est lui qui devait m’y conduire. Elle me dit également qu’elle m’avait trouvé des vêtements pour cette circonstance et qu’ils étaient rangés dans l’armoire de ma chambre.
C’est étrange, mais je n’avais jamais envisagé le décès de mes parents. J’avais des copines dont l’un des parents était décédé, mais je n’avais jamais imaginé que cela pourrait m’arriver personnellement.
J’angoissai toute la matinée en me demandant si j’arriverais à faire face à cette épreuve. J’avais l’impression que je n’en aurais pas la force, que j’allais m’évanouir à la simple vue du cercueil.
Forisse resta à mes côtés à l’église et au cimetière. Je ne me souviens pas vraiment des paroles prononcées par le curé, ni des chants qui furent repris en chœur par l’assemblée. Je passai mon temps à pleurer et à renifler. Forisse m’avait procuré plusieurs paquets de kleenex et je les consommai tous.
Je fus un peu surprise qu’il y ait autant de monde à la cérémonie. Mes parents n’avaient pas d’amis et je me demande encore qui étaient tous ces gens qui défilèrent tristement devant le cercueil de mon père.
Forisse me raccompagna ensuite chez Nelly alors que les autres participants se rendaient chez Louis, à l’invitation de la municipalité.
Je me couchai de bonne heure et, épuisée par l’émotion, sombrai comme une masse dans le sommeil.
Forisse me rejoignit le matin suivant.
J’étais reposée et je n’avais plus de larme à verser. Je me souviens qu’il faisait beau ce jour-là.
Nous quittâmes l’appartement de Nelly pour Carantec où nous fîmes une promenade sur le bord de mer.
Le commandant m’expliqua que mon sort serait réglé dans quelques jours. Les services sociaux étaient en contact avec la famille de mon père et une solution d’hébergement semblait se dessiner.
Tandis que nous marchions lentement, Forisse se tourna vers moi.
— Tout sera bouclé très vite, me dit-il. Quelqu’un de ta famille s’occupera de toi très prochainement.
Je dus faire une tête bizarre car il me demanda :
— Ça n’a pas l’air de te faire plaisir ?
Je ne savais pas trop quoi répondre. Je me limitai à grommeler un « bof » tout juste perceptible.
Forisse se mit à rire.
— Écoute, il reste encore quelques jours avant que tout ne soit ficelé. Ne te mets pas martel en tête avant d’apprendre chez qui tu vas aller.
Je n’étais pas convaincue et ma mine boudeuse en témoignait suffisamment.
Le commandant me considéra un moment en silence.
— D’ici là, il y a quelque chose que nous pourrions faire tous les deux.
Je lui jetai un regard interrogatif. Je ne voyais pas où il voulait en venir.
— Tu sais, l’histoire que tu m’as racontée, le cadavre que ta copine et toi avez découvert…
— Oui, eh bien ?
— Eh bien, je crois qu’il serait judicieux que nous le recherchions.
— Pour quoi faire ?
— Il y a peut-être des gens qui s’inquiètent de ne plus avoir de nouvelles de cet homme. Des enfants… Et puis, toute personne mérite une sépulture décente, tu n’es pas d’accord ?
Je ne savais pas. Je n’avais jamais été confrontée à ce genre de problème. À vrai dire, je ne m’étais jamais posé la question.
— Ah bon, vous croyez ? fut la seule chose que je trouvai à répondre.
II
Nous étions garés devant chez ma grand-mère, à l’endroit même où ma virée tragique avait commencé. Je me revoyais en train d’attendre Margaux, assise sur le muret clôturant le jardin.
Les vieux volets en bois, dont la peinture s’écaillait par plaques, étaient fermés car ma grand-mère venait d’être placée dans un établissement pour personnes âgées.
Sans ma mère pour s’occuper d’elle, il lui était impossible de rester seule à la maison.
Je contemplai tristement cette demeure où j’avais mes habitudes et j’eus conscience une nouvelle fois que ma vie venait de changer irrémédiablement.
Tous mes repères s’étaient évanouis dans un passé récent à jamais révolu.
Bientôt, peut-être, le village où j’avais passé mon enfance ne serait plus qu’un douloureux souvenir.
Forisse n’avait pas arrêté son moteur.
— Donc, c’est ici que ta copine t’a récupérée, ce fameux dimanche après-midi.
J’acquiesçai d’un hochement de tête.
— Vous êtes partis de quel côté ? En direction de Morlaix ou de l’autre côté ?
Je montrai d’un geste la route qui s’étirait devant nous.
— Par là, tout droit. Nous sommes allés en direction du bourg.
Le commandant passa la première et embraya doucement. Nous traversâmes le centre déserté en ce début d’après-midi.
— Tu te souviens combien de temps vous avez roulé ?
Je ne savais plus très bien. Il faut dire que, pendant tout le trajet, j’avais plutôt été préoccupée par ce sale type qui me collait en essayant de me peloter. Je n’avais pas eu de chance parce qu’il ne me plaisait pas du tout. Le copain de Margaux, lui, c’était un beau mec. S’il avait été sur le siège arrière à côté de moi, toute l’histoire aurait été différente. Mais bon… c’était comme ça. Je répondis comme je pus à la question du commandant.
— Je ne sais pas trop. Un quart d’heure, une demi-heure…
— Vous avez pris la route sur laquelle nous roulons ?
Je regardai le paysage autour de moi. J’étais incapable de dire si nous étions passés par là ou pas.
— Vous êtes allés jusqu’à Plouvorn ?
Je connaissais bien cette ville.
— Non !
— Tu es sûre ?
Je n’avais aucun doute à ce sujet et, pour une fois, je pus me montrer affirmative.
Le commandant prit sur la gauche et je remarquai que, au bout d’un moment, nous traversions Guiclan.
— Ça te dit quelque chose ?
— Peut-être. Je ne suis pas certaine.
— Est-ce qu’à un moment vous êtes passés sous la nationale 12 ?
J’hésitai… Je ne savais pas trop mais quand Forisse s’engagea sous le tunnel étroit, j’eus comme un flash.
— Je me souviens de cet endroit, dis-je. Oui, c’est sûr, nous sommes passées par là.
La voiture poursuivit sa route jusqu’à Guimiliau. Nous n’étions pas venues jusque-là avec Margaux. Je le dis à Forisse qui chercha un endroit où faire demi-tour.
— Vous êtes donc allées quelque part entre la 12 et ici. Tu as des souvenirs de la route où vous avez trouvé cet abribus ?
Il faisait nuit, tout cela était très flou dans mon esprit.
Le commandant me demanda de sortir de la boîte à gants la carte de la région qu’il avait préparée pour notre expédition.
Il l’étudia pendant plusieurs minutes et se remit en route. Je compris rapidement qu’il avait l’intention d’explorer systématiquement chacune des voies carrossables mentionnées sur la carte.
— Tu regardes bien autour de toi, me dit-il, et si tu reconnais quelque chose, tu me le dis aussitôt.
Je concentrai mon attention sur la campagne environnante, mais, pour moi, chaque champ ressemblait au précédent, chaque arbre à un autre arbre. Je ne distinguai aucune particularité dans ce paysage uniformément vert, et cela d’autant moins que mon escapade avec Margaux s’était déroulée principalement de nuit.
Forisse roulait lentement et me jetait des regards en coin. Je faisais mon maximum mais j’étais dans l’incapacité la plus complète de dire si j’étais déjà passée par là ou non.
— Tu te retrouves ?
Je répondis d’une grimace sans équivoque.
— Essaie de te souvenir. Il n’y a rien qui t’avait frappée. Une maison biscornue, un arbre tombé à terre, un hangar en ruine…
Je fermai les yeux et essayai de me projeter par la pensée quelques jours en arrière.
Une image de linge séchant sur un fil me revint subitement en mémoire et j’en fis aussitôt part à Forisse.
— C’était au bord de la route ? interrogea-t-il.
— Je crois, oui. J’ai l’impression d’avoir vu ça alors que nous étions assises dans le bus et qu’il venait de démarrer.
Notre quête se poursuivit, mais nous avions cette fois une piste assez précise. Nous cherchions un étendage à proximité de la route.
Il nous fallut plus d’une demi-heure pour le trouver.
— C’est pas ça ? me demanda soudainement Forisse, en me montrant du doigt du linge qui pendait sur un fil.
— Peut-être bien… Arrêtez-vous, que je puisse voir un peu mieux…
Le commandant stoppa et descendit de sa voiture. Je le vis faire un tour complet sur lui-même et balayer l’horizon d’un regard circulaire. Il regagna l’habitacle presque aussitôt.
— Il y a une espèce d’arrêt de bus là-bas. On va y aller.
Les souvenirs me revinrent quelques dizaines de mètres plus loin. Ma mémoire avait magnifié la réalité, car il ne s’agissait pas vraiment d’un véritable abri mais c’était bien ici que Margaux et moi avions passé la nuit à trembler de peur et grelotter de froid.
Forisse trouva où se garer et nous sortîmes tous deux de la voiture.
— On va continuer à pied, dit-il. Tu dois refaire le chemin à l’envers. Vas-y, n’aie pas peur, je suis là, tu ne crains rien.
Une étroite route goudronnée s’enfonçait dans la campagne. Je m’y engageai en escomptant que nous n’eussions pu arriver que par là. Deux maisonnettes isolées devinrent visibles au loin.
— C’est une de ces maisons ? demanda le commandant.
— Non, c’est pas ça.
— Tu te souviens d’être passée par là ?
À vrai dire, je ne me rappelais pas grand-chose. Nous avions couru dans le noir sous la pluie… Ces bâtisses avaient-elles pu échapper à notre attention ? Je n’en savais rien. Je ne répondis pas à Forisse mais continuai d’avancer.
Les deux bicoques marquaient le terminus de la route. Je restai un moment désemparée.
— C’est là ? s’inquiéta Forisse en me désignant un chemin de terre qui partait sur la droite.
Je n’étais sûre de rien et me bornai à un haussement d’épaules incertain. Mon instinct me soufflait cependant que nous étions sur la bonne voie. J’empruntai ce passage envahi d’herbes sur lequel apparaissaient les sillons parallèles laissés par la circulation de quelques rares voitures.
Nous parcourûmes environ deux cents mètres sans dire un mot, silencieux comme des Indiens sur le sentier de la guerre.
Et je l’aperçus !
Il n’y avait aucun doute. C’était bien la longère où Margaux et moi avions fait notre macabre découverte. Je me figeai instantanément, submergée par une frayeur rétrospective.
— C’est là, hein ? me dit simplement Forisse.
Il s’approcha de moi et je me sentis aussitôt en sécurité à ses côtés. La maison me parut plus petite que dans mon souvenir. Elle me sembla surtout beaucoup plus minable, pitoyable presque, en raison de sa décrépitude. Ses volets fermés et son toit assez bas lui donnaient l’air d’une vieille sorcière endormie. Je pensai que si nous l’avions vue en plein jour, nous n’aurions jamais tenté d’y pénétrer.
Le commandant s’avança jusqu’à la porte d’entrée et essaya de l’ouvrir.
— Elle est fermée, commenta-t-il. Vous étiez passées par-derrière, c’est bien ça ?
Nous contournâmes la bicoque et je reconnus l’ouverture que nous avions “un petit peu forcée”.
Elle s’ouvrit sur une simple poussée. Forisse passa la tête à l’intérieur et fit la grimace. Quelques pas derrière lui, je sentis une nouvelle fois l’odeur épouvantable qui avait agressé nos narines lors de notre première expédition.
— Il fait noir comme dans un four là-dedans. Il nous faut une lampe. J’en ai une dans la voiture.
Le commandant me demanda si je souhaitais l’attendre sur place tandis qu’il retournait à son véhicule, mais, évidemment, je refusai tout net.
Nous fîmes l’aller-retour très rapidement et Forisse se gara devant la maison.
— Tu vas m’attendre ici dans la voiture. Je n’en aurai pas pour longtemps.
Je préférais ne pas rester toute seule et je le suivis jusqu’au seuil de la maison. Je restai dehors et le laissai entrer, précédé par le faisceau lumineux de sa lampe. Il revint quelques minutes plus tard. Son visage fermé était sans équivoque. Il avait dû tomber sur des tas de cadavres dans son métier mais je voyais que ce qu’il venait de découvrir l’avait véritablement affecté.
— Tu avais raison, me dit-il. Il y a bien un corps dans un fauteuil. J’ai vérifié qu’il ne s’agissait pas d’un mannequin. Mais ne restons pas là, retournons dans la voiture.
Le soleil avait déjà beaucoup baissé et le paysage, autour de nous, semblait s’être assombri d’un seul coup. Il faisait bon dans l’habitacle et je me sentis tout de suite mieux.
— La première chose à déterminer est de savoir où nous sommes, expliqua Forisse.
— Pour quoi faire ?
— Nous devons appeler les gendarmes et il faudra leur dire où ils doivent se rendre.
— Comment va-t-on procéder ?
— Je vais essayer de trouver notre position avec mon téléphone.
Je retrouvai le policier malgracieux que je connaissais. Il s’énerva sur son portable pour essayer de savoir où nous nous trouvions. Il ne parvint pas à afficher les coordonnées GPS de notre emplacement et dut, après avoir grommelé de nombreux « putain, bordel » et autres joyeusetés, se contenter d’une application qui lui fournit seulement le nom de l’impasse par laquelle nous étions arrivés jusqu’à la maisonnette.
Il appela ensuite le lieutenant Marceau.
Il ne mit pas le mains libres ; j’entendis néanmoins toute la conversation.
— Marceau, c’est Forisse à l’appareil. Je suis avec la petite Nadeau dans un coin paumé de Saint-Thégonnec. J’ai besoin de ton aide.
Le lieutenant se fendit d’une réponse prudente :
— Oui, bien sûr. De quoi s’agit-il ?
Le commandant ne s’embarrassa pas de longs préliminaires.
— Eh bien, pendant son escapade avec sa copine Lopreden, elle avait cru dénicher un cadavre dans une longère abandonnée. Je lui avais dit qu’elle se gourait et qu’elle avait dû rêver – Il m’adressa un clin d’œil complice. C’est pour ça qu’elle ne t’en a pas parlé. Finalement, j’ai préféré vérifier et j’ai eu le nez creux car il s’avère qu’elle avait bel et bien raison…
— Quoi ! s’offusqua le jeune officier. Qu’est-ce que c’est que cette histoire encore ?
Forisse me gratifia d’un nouveau clin d’œil. Manifestement, la situation l’amusait beaucoup.
— C’est un cadavre, tout simplement. Je t’appelais pour savoir quelle était la brigade compétente. Apparemment, nous serions ici sur la commune de Saint-Thégonnec…
Marceau répondit sèchement du tac au tac :
— Une brigade de gendarmerie est implantée dans cette commune. Vous voulez les appeler où vous préférez que j’établisse le premier contact ?
— Appelle-les, ça facilitera notre entrée en matière. Je reste sur place et j’attends leur coup de fil. La réception n’est pas terrible mais ça suffira pour qu’on se comprenne.
Nous attendîmes un bon quart d’heure avant que le téléphone ne sonne.
Forisse, adossé contre son siège, paraissait presque assoupi. La radio diffusait de vieux morceaux qui m’étaient, pour la plupart, inconnus.
Un gimmick criard vint perturber la musique. Le commandant avait des goûts bizarres en matière de sonnerie de téléphone. Il décrocha d’un air nonchalant.
— Commandant Forisse, annonça-t-il.
Je le regardai du coin de l’œil. Le pitbull était de retour. Je l’ai appris plus tard mais il n’y avait aucune chance que quiconque à la brigade de Saint-Thégonnec eût un grade supérieur ou équivalent au sien. Se présenter comme commandant de police équivalait à se situer d’entrée de jeu en position hiérarchique avantageuse vis-à-vis de l’appelant. Le stratagème fonctionna à merveille car les intonations de la voix que je perçus au bout du fil me semblèrent, si ce ne sont respectueuses, au moins pleines de prudence.
Forisse donna notre position approximative et précisa qu’il allait rester sur place pour attendre la maréchaussée.
Les pandores promirent d’arriver sans tarder, ce qu’ils firent, car moins de dix minutes plus tard, une fourgonnette bleue débouchait du chemin et venait se garer derrière notre véhicule.
III
La bedaine proéminente de l’adjudant-chef Keroual témoignait de son intérêt affirmé pour la bonne chère. Il s’extirpa avec difficulté de la camionnette bleu foncé, suivi de près par un individu longiligne dénommé, comme je l’appris plus tard, Pierre Silo.
Je ne pus m’empêcher de sourire en pensant aussitôt à Laurel et Hardy. J’espérais seulement que les deux gendarmes se montreraient un peu plus dégourdis que le célèbre duo comique.
Ils s’approchèrent de notre voiture. Forisse sortit à leur rencontre et je fis de même.
Je sentais les deux individus sur la défensive. Le sous-officier nous balaya d’un regard noir qui ne cherchait pas le moins du monde à dissimuler la méfiance qu’il devait ressentir à notre endroit. J’avais l’impression de lire dans ses pensées et je devinai sans peine toute la suspicion qui l’animait. Il porta la main à la visière de son képi et octroya au commandant un bref salut, le minimum syndical sans aucun doute.
Puis il tendit la main en avant et se présenta :
— Adjudant-chef Keroual. Je suis le responsable de la brigade de Saint-Thégonnec.
Forisse lui rendit la politesse mais ne fit aucun commentaire me concernant. J’avais entendu un de mes profs dire, une fois, que la négation d’autrui était la pire des humiliations. Je n’avais pas compris à l’époque ce que cela voulait dire mais je reçus ce jour-là le comportement du commandant comme une gifle en pleine face.
— Selon le lieutenant Marceau, vous auriez découvert un cadavre, grogna Keroual d’un ton sceptique.
— Nous aurions…, répliqua Forisse ironiquement. Si vous voulez bien vous donner la peine… Je vous conseille de vous munir d’une lampe.
Il prit la direction de la longère tandis que Laurel se précipitait vers la camionnette à la recherche d’une torche électrique.
Je patientai à l’extérieur jusqu’à ce que les hommes réapparaissent. Forisse avait dû expliquer mon rôle dans cette affaire car, à sa sortie de la maison, l’adjudant-chef me considéra d’un drôle d’air. Je pensai qu’il allait m’interroger dans la foulée mais il préféra s’isoler pour passer quelque temps au téléphone.
Il nous rejoignit une poignée de minutes plus tard et nous annonça qu’il venait de contacter les services du procureur de la République, ainsi qu’un médecin légiste et les techniciens de la gendarmerie.
Comme je m’étonnai auprès du commandant de tout ce branle-bas, ce dernier m’informa que cela était la procédure habituelle car nous nous trouvions en présence d’un homicide.
Je pensai, durant un court instant, que Forisse et moi allions désormais rentrer chez Nelly, mais je compris rapidement que je me fourvoyais.
Le commandant avait bel et bien l’intention de demeurer sur place et d’assister en personne au moins à la phase préliminaire de l’enquête.
Keroual et Silo ne restèrent pas inactifs et entreprirent de “geler la scène”. Un ruban de plastique interdit bientôt l’entrée de la maison à toute personne non autorisée.
Une voiture rutilante arriva environ une heure plus tard et se gara derrière la camionnette des gendarmes. Un homme plutôt jeune, élégant, rasé de près, qui semblait très imbu de lui-même en sortit. Il s’agissait du médecin légiste, que l’adjudant-chef, pleins d’égards, accompagna à l’intérieur.
Puis ce fut le tour du représentant du procureur. Un petit être terne et gris, presque insignifiant, d’une quarantaine d’années, au regard de chien battu. La déférence des gendarmes vira pour ainsi dire à l’obséquiosité.
Forisse observait tout cela d’un œil narquois, alors que je découvrais un univers qui m’était inconnu.
Les équipes de techniciens firent leur entrée en scène un peu plus tard.
Le petit coin de campagne s’était soudainement transformé en parking de supermarché.
Je retournai dans la voiture, tandis que le commandant, adossé à la maison, contemplait le paysage qui s’étendait devant lui. Il semblait tellement perdu dans ses pensées que j’étais persuadée qu’en fait il ne devait rien percevoir de son environnement.
Ce qui avait peut-être été jadis une pelouse s’étirait sur une vingtaine de mètres jusqu’aux confins de la propriété. Quelques elaeagnus rabougris qui n’avaient rencontré aucun taille-haie depuis des lustres constituaient les seuls ornements de ce terrain à l’abandon. Au-delà, se développait de façon anarchique une lande dense et touffue à travers laquelle, mis à part les lapins et les renards, personne ne devait jamais s’aventurer.
Lassée d’attendre dans la voiture, je rejoignis le commandant. J’avais dans l’idée d’essayer de le convaincre de rentrer à la maison, mais lorsqu’il se tourna vers moi et que j’aperçus son visage bougon, je compris qu’il n’y avait rien à espérer. Mieux valait l’éviter quand il faisait cette tête-là. Je gardai prudemment le silence.
C’est alors que le légiste, l’adjudant-chef et le substitut sortirent de la maison.
Le médecin affichait la même allure dégagée que lors de son arrivée, le gendarme tirait franchement la gueule et le procureur paraissait soulagé de se retrouver au grand air.
Forisse les interrogea tout d’abord du regard avant de demander :
— Alors ?
— Alors, on est bien en présence d’un homicide. La pauvre femme a pris une balle en plein cœur, répondit Keroual.
— Comment ça, la pauvre femme ? La victime est bien la personne assise dans un fauteuil ? C’est pas un homme avec son chapeau ?
Le légiste se mit à rire.
— Il ne faut pas toujours se fier aux apparences, s’amusa-t-il. L’habit ne fait pas le moine et, en l’occurrence, le chapeau ne fait pas le mâle. Il s’agit bien d’une femme habillée en homme.
— Elle est morte depuis longtemps ?
— Il y a certainement plusieurs mois. L’autopsie me permettra peut-être d’en dire un peu plus mais, pour l’instant, je préfère rester prudent.
Il se tourna vers le procureur.
— Vous aurez mon rapport sans tarder mais vous pouvez déjà considérer que la cause du décès est la balle qui a frappé cette personne en pleine poitrine.
Il se dirigea vers sa voiture et entreprit de se dégager tant bien que mal du parking improvisé et très encombré.
Nous le suivîmes du regard pendant que les feux arrière de son véhicule disparaissaient dans le petit chemin herbeux.
Forisse se rapprocha du gendarme.
— Vous avez identifié la victime ? demanda-t-il.
— Pas encore, mais s’il s’agit de la propriétaire, nous saurons vite de qui il s’agit. Nous allons, avant de quitter les lieux, faire le tour du quartier. On ne sait jamais, un voisin aura peut-être remarqué quelque chose ?
— Je vous souhaite bien du plaisir, commenta le commandant. J’ai pas l’impression que les voisins, ça court les rues par ici.
Keroual haussa les épaules.
— Bah, nous verrons… Même dans les coins les plus paumés, on trouve toujours des curieux à l’affût du moindre passage. Je ne suis pas plus inquiet que ça.
Le substitut du procureur prit congé à son tour.
Il ne restait plus sur place que les représentants en bleu et en blanc de la gendarmerie.
J’avais été très surprise de voir débouler ces TIC1, comme les autres les avaient appelés. On aurait dit des cosmonautes avec leurs masques et leurs combinaisons. Ils s’étaient engouffrés dans la maison et on ne les avait pas revus. Puis l’un d’eux était ressorti et s’était mis à fouiller le jardin comme un chien de chasse coursant un lièvre. Je l’observai presque machinalement quand je le vis s’accroupir et ramasser un objet dans l’herbe haute. Il se releva et appela l’adjudant-chef.
— Venez, Chef. J’ai trouvé quelque chose d’intéressant.
Keroual se précipita, suivi de Forisse. Ils examinèrent ce que l’homme avait trouvé au sol. C’était un pistolet. Il avait dû séjourner longtemps dans l’herbe, car il me parut en mauvais état.
Le TIC retira le chargeur.
— Il manque une balle, annonça-t-il. Rien n’est engagé dans le canon.
Le gendarme se pencha pour vérifier les assertions du technicien.
— C’est un Browning M1910, un 7,65 à sept coups, déclara-t-il en connaisseur. Il faudra analyser tout ça et déterminer si la balle que le légiste trouvera sur le cadavre provient de cette arme. J’espère que les empreintes digitales sur la crosse n’auront pas été endommagées par un séjour prolongé en plein air. On aura peut-être notre coupable grâce à ça, sauf s’il s’agit d’un suicide… évidemment, mais dans ce cas-là, nous le saurons aussi – Il soupira. Ce ne sera peut-être pas une affaire si compliquée que ça, finalement.
La perspective d’une réponse simple à son enquête semblait l’avoir ragaillardi. Il jeta un rapide coup d’œil à sa montre. Peut-être serait-il à l’heure à la maison pour manger sa soupe ?
— Vous en avez encore pour longtemps, s’enquit-il après du TIC.
— Nous avons bientôt terminé. Dans moins d’une demi-heure, nous aurons effectué tous nos relevés.
Keroual se tourna vers Forisse.
— Eh bien, Commandant, il ne me reste plus qu’à vous remercier pour votre concours. J’aurai besoin d’entendre la jeune personne qui vous accompagne. Est-ce que vous pourriez passer à la brigade demain matin ?
Je pensais en avoir terminé avec toute cette histoire mais j’avais tort. Décidément, j’étais abonnée aux gendarmeries. J’espérai, pendant un dixième de seconde, que le commandant demanderait à l’adjudant-chef de me foutre la paix, mais je me trompai une fois de plus.
— Nous serons chez vous demain en fin de matinée, fut sa réponse.
*
La gendarmerie de Saint-Thégonnec se situe au nord de la nationale 12. Il nous fut donc très facile de nous y trouver à l’heure convenue.
L’adjudant-chef Keroual, qui attendait notre arrivée, nous reçut sans délai.
Forisse m’avait assuré la veille que je ne devais pas m’inquiéter, qu’il resterait avec moi durant tout l’entretien. Cela m’avait permis de ne pas passer une trop mauvaise nuit. Sans cela, je me serais peut-être inquiétée de me retrouver encore une fois face à un gendarme en uniforme.
Je déclinai mon identité et l’interrogatoire commença. Je racontai de nouveau les circonstances qui nous avaient amenées, Marion et moi, à pénétrer dans cette longère inhospitalière.
L’adjudant-chef, installé derrière son bureau, transcrivait toutes mes déclarations sur son ordinateur.
Il me posa quelques questions complémentaires qui ne me posèrent aucune difficulté.
— Voilà, c’est terminé, me déclara-t-il soudain. Vous allez signer votre déposition et ce sera tout pour moi.
Je fis ce qu’il me demandait et il se leva pour nous raccompagner.
Nous étions toujours debout dans son bureau quand Forisse demanda :
— Vous avez identifié la défunte ?
— À vrai dire, pas encore, mais nous y travaillons.
Il me sembla percevoir une certaine gêne dans la réponse.