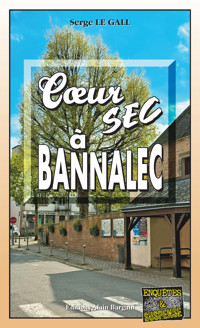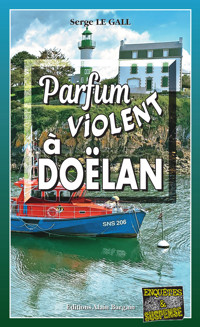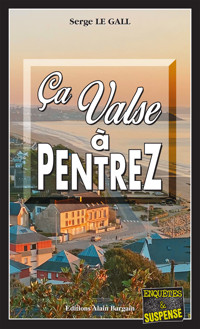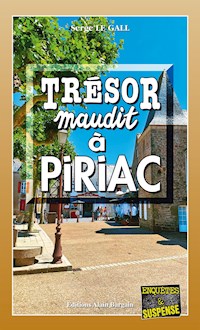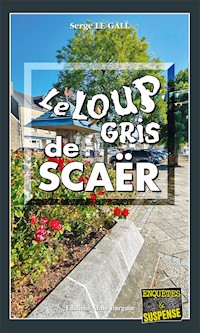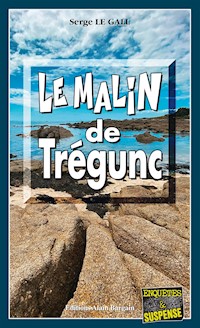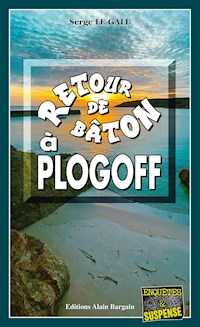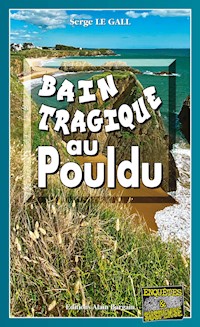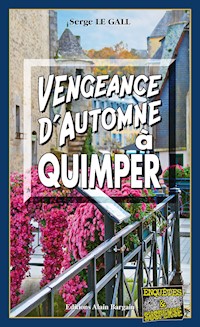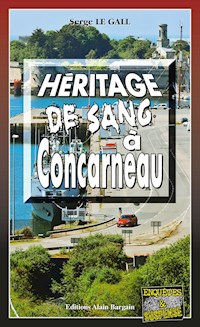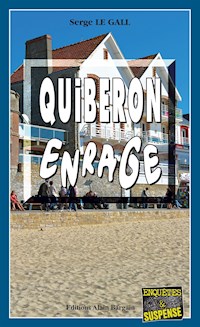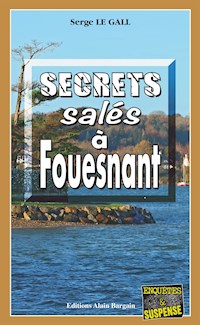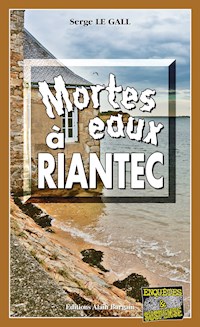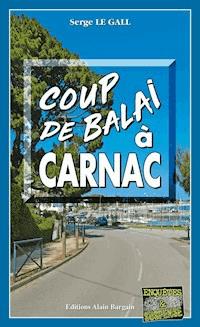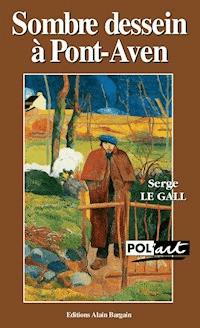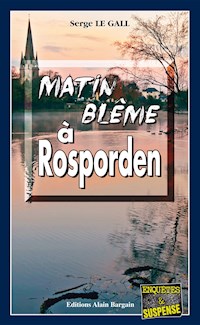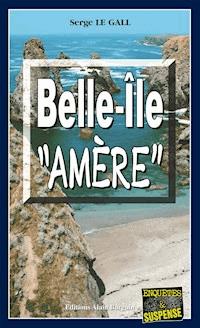
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Landowski
- Sprache: Französisch
En remuant le passé, on prend le risque de réveiller de vieux démons...
« Maintenant, ils me portent. J'ai un dernier sursaut pour leur montrer que je suis vivante. Ultime témoin de ma propre exécution. Que le remords les ronge à jamais. »
Robert Draner, dit "Le Renard", journaliste indépendant, enquête sur les enfants d'Argentine volés dans les années soixante-dix par des militaires de la dictature. Avec le concours de Julieta Heras, pigiste dans un journal associatif de Buenos Aires, il se lance sur les traces des tortionnaires.
C'est à Belle-île que leur quête pour éclairer l'Histoire les entraîne au moment où Landowski y séjourne une nouvelle fois.
Il suffit d'un crime pour brancher le célèbre commissaire !
De Buenos Aires à Belle-île en passant par Quiberon, La Trinité-sur-Mer et même Hondarribia en Espagne, les acteurs de ce jeu de piste mortel cherchent à faire la lumière sur cette douloureuse affaire.
Mais la vérité se paie… cher !
Ce 14e tome surprenant des enquêtes du commissaire Landowski vous emmènera au cœur d'une affaire historique !
EXTRAIT
Landowski pénétra dans le salon. Le garde du corps s'effaça sur un signe de son patron. La pièce était sombre. La rue étroite ne permettait pas au soleil de remplir complètement sa mission. De plus, la clarté trop vive était une souffrance pour l’ancien ministre. Lors de l’attentat, ses yeux avaient été sérieusement touchés.
— Alors, Commissaire, dit-il d’une voix aussi joviale que rocailleuse, vous voila enfin chez moi !
— J’ai pu faire une jolie balade en ville avant d’arriver jusqu’ici…
Takanea rit aux éclats, un rire un peu forcé. En parfait français, il continua :
— Je n’ai plus le loisir de me promener comme cela…
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Les investigations de Landowski sont riches en péripéties, en noirs mystères et en hypothèses, le menant jusqu’à la Pointe des Poulains, à Belle-Île, pour le dénouement. Un très bon suspense. -
Claude Le Nocher, Action-Suspense
Éditions Bargain, le succès du polar breton. -
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Serge Le Gall vit et écrit à Pont-Aven. Côté Enquêtes, il s’appuie sur son expérience professionnelle dans le milieu judiciaire. Côté Suspense, il aime bien jouer à cache-cache avec son lecteur. Le commissaire divisionnaire Landowski est son personnage fétiche.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« La neige couronne les cimes.La lune se pare de lichens.L’empire n’est plus.Quand le peuple se lèvera,Les barbares puantsFuiront vers le nord.Nous reverrons le soleil. »
Uchen Yang,
Infatigable voyageur chinois
(Période des Cinq Dynasties - Xe siècle)
PROLOGUE
Buenos Aires, 13 décembre 1978
Je suis comme dans un brouillard.
J’ai l’impression d’être tombée au fond de moimême comme dans un puits, de m’être détachée de mon enveloppe charnelle, comme si cette séparation était aussi naturelle qu’inéluctable. Je sais que je suis en train de vivre la toute dernière partie de mon parcours. Il n’y a pas d’autre issue.
L’espoir m’a abandonnée ce matin quand ils sont venus me chercher. Je l’ai senti tout de suite au fond de moi quand la porte s’est ouverte. Ce sont des vérités que l’on doit comprendre sans qu’on vous les dise. Il y a le cours des choses sur lequel on n’a aucune prise. Le malheur en fait partie.
Je ne peux plus imaginer une fin heureuse à mon histoire. Ils ne pourraient pas. Ils sont allés trop loin. Ils effacent les traces de leurs méfaits au fur et à mesure. Ils manquent bien de courage ceux-là qui affirment si fort leur bon droit, la légitimité de leur pacification nationale et le respect de leurs valeurs.
Que n’osent-ils se mesurer à leurs détracteurs pour les confondre et chercher démocratiquement à avoir raison au lieu de se corrompre par la torture et l’abus de pouvoir ?
Si tout cela s’arrête un jour, on ne pourra rien prouver. Ni actes ni paroles. Ils auront fait le nécessaire pour qu’on ne soit plus là pour témoigner. Il n’y aura personne pour leur demander des comptes. Juste une liste interminable de desaparecidos.*
Il n’y aura pas de justice pour eux. Ils n’entendront pas la sentence, ils ne subiront pas de condamnation. Ils passeront au travers. Le calme reviendra parce que c’est dans l’ordre éternel des choses et ils couleront des jours tranquilles avec leurs enfants.
Pas moi.
Le dieu dont ils se réclament parfois, s’il existe, je lui demande de nous assister le moment venu. Pourvu qu’on nous épargne un nouveau lot de souffrances. Je n’ai plus la force. Je suis fatiguée par cette lutte iné-gale. Seule, reste ma dignité.
Même s’ils m’ont brutalisée, torturée et déshonorée, ils ne m’ont pas asservie. Même s’ils ont fait de moi leur objet de jeu et de plaisir, je n’ai pas léché leurs bottes. Je n’ai pas imploré leur clémence. Je ne me suis pas soumise.
Le corps plaqué sur le plancher, je ressens chaque mouvement du véhicule. J’entends le bruit sourd du moteur du camion. À la manière d’une mécanique qui est en train de nous broyer inexorablement. Destination inconnue. Les gardes n’ont rien dit. Ils n’ouvrent la bouche que pour ordonner et crier. Nous progres-sons avec lenteur. À faire peur. Une marche funèbre avec un petit peu d’avance. Du cynisme d’État. De quoi laisser le temps aux rares badauds de comprendre, puis d’imaginer, avant de craindre pour leur vie. C’est déjà ça de gagné pour le pouvoir. La terreur est une alliée qui ne coûte pas cher.
Le chauffeur fait grincer les vitesses. Fébrile ou inexpérimenté, les deux peut-être. Il veut bien faire, se conformer aux ordres pour ne pas risquer réprimandes et brimades. Il a vu ce que l’on fait aux prisonniers. Il sait ce que pouvoir veut dire. Il a peut-être aidé lors des tortures. Regardé certainement. Il n’a pas envie de changer de camp. Les tortionnaires sont toujours fascinés par leurs actes.
À chaque hoquet du moteur, une bouffée de gaz brûlés me passe sur le visage en coup de vent. De la pestilence comme toute cette horreur.
Je ne peux pas bouger. Je suis enfermée dans un monde situé à côté de l’autre, un monde qu’on n’imagine même pas. Une sorte de création du mal sous couvert de sursaut national. On ne me laissera plus en sortir. Mais, ironie du sort, on me permet d’être spec-tatrice impuissante de mon destin.
Je ne peux pas crier non plus. On m’en a tant fait que la parole m’est presque devenue étrangère. En détention, on vous apprend le silence avant de tolérer un chuchotement. Pour mieux vous le faire payer. Les tortionnaires ne manquent pas d’imagination.
Mes yeux ont bien du mal à rester ouverts comme si une chape de plomb s’employait à me couper du monde. D’ailleurs, il n’y a rien à voir qu’un plancher rugueux, des ridelles et une bâche salie. Celle-ci a été bordée à la hâte pour masquer les colis à transporter. Les morts-vivants que nous sommes.
Elle flotte un peu, claque sur les montants de temps en temps et elle tire sur la cordelette qui passe dans les œillets métalliques comme si elle voulait s’en libérer. Elle est comme moi, prisonnière.
Ainsi, par l’espace éphémère, je peux apercevoir des petites choses naturelles et dérisoires : un bord de trottoir, un pied de réverbère, un paquet de cigarettes écrasé, le bout des chaussures d’un passant.
Ce dernier, je l’imagine immobile au bord de la chaussée, volontairement indifférent au convoi militaire qui passe dans la rue pour ne pas risquer de connaître le même sort que nous. Il va se dépêcher de rentrer chez lui, se presser, la tête baissée de peur de devenir une cible, un suspect, un coupable. Il va oublier ce qu’il a vu. Par lâcheté. Par nécessité vitale.
Il n’y a plus de héros disponibles. Simplement des martyrs.
Matias a été extrait de sa cellule en même temps que moi. Je l’ai vu de face le temps qu’il prenne sa place dans la colonne. Il m’a regardée avec cet éclair si particulier dans les yeux. C’est dans ce regard-là que j’ai lu l’amour le jour où je l’ai rencontré la première fois. Cette intensité préservée m’a réconfortée, m’a redonné un peu de courage. Parce que nous allons faire ensemble le dernier voyage.
Tortionnaires de tous poils, vous n’arriverez jamais à éteindre cette flamme ! Elle n’appartient qu’à nous. Elle restera éternellement même si vous prenez nos vies. Vous aurez notre sang et nos larmes mais la douceur de sa peau contre la mienne, la sensation de ses mains sur moi et l’élan indicible de nos corps avant de s’épouser charnellement pour un grand bonheur partagé, vous ne pourrez jamais nous les prendre !
J’ai été heureuse de le voir marcher devant moi dans ce tunnel sans âme. Il me manquait terriblement. Ils m’ont changé de lieu de détention. Je suis revenue dans la capitale, il y a deux ou trois jours. Peut-être. Je ne saurais pas dire exactement. J’ai été enfermée seule dans un réduit exigu. Je n’imaginais pas le revoir. Ils ne l’ont pas épargné. Il m’a semblé avoir vieilli de dix ans. Il avait l’air très fatigué et il portait les traces des tortures qu’on lui avait infligées. Pourquoi ?
Mon soulagement de le savoir vivant n’a été que de courte durée. Notre pérégrination vers le jour comme des fourmis au fond d’un trou n’augurait rien de bon. D’habitude, le prisonnier était souvent seul avec ses gardes avant de retrouver d’autres détenus dans le camion. À nous voir à quatre, j’ai eu un pressentiment. En plus, Matias était du convoi.
Je veux que mon mari meure le premier. Pour qu’il n’ait pas la douleur de me voir mourir. Je serai plus forte que lui. Du moins, j’essaie de le croire. J’aurai le dernier sursaut pour le rejoindre. Ils peuvent bien prendre nos vies. Notre amour, ils ne le détruiront jamais.
Je sens ses mains me toucher quand le camion brinquebale sa marchandise au gré de la conduite hasardeuse du jeune chauffeur. Peut-être qu’il ne sait même pas ce qu’il transporte à l’arrière de son véhicule… Peut-être qu’il trouve normal de participer au Proceso de Reorganizacion Nacional…* Peut-être qu’il s’en fout… Tout simplement.
Que les mains de Matias ont été douces sur mon corps ! Des centaines de fois, je me suis laissée aller sous leurs caresses et je ne regrette pas un seul instant de m’y être soumise comme de les avoir sollicitées. Pour la tendresse comme pour le plaisir.
Je suis allongée sur mon côté gauche, les mains liées devant par une ficelle grossière. Ensuite, il y a Matias, dans la même position. Puis les deux autres détenues, deux femmes que je ne connais pas. Françaises, je crois. Nous sommes disposés comme des ballots. Certainement pas comme des humains qu’on nous refuse d’être pour établir la distance nécessaire à notre avilissement. Je crains pour les générations à venir. Les peuples qui ont entaché leur histoire de ces pratiques, en ont fait des marques indélébiles que même le temps ne parvient pas à effacer.
J’ai replié les jambes pour tenter d’atténuer un peu la douleur qui sourd dans mon épaule. Mes mains sont glacées. Mon corps aussi, à l’intérieur. J’ai le cœur qui ralentit, trébuche et s’emballe avant de se calmer un peu. Le propre des morts-vivants.
Ils sont venus nous chercher en fin de nuit. Je n’ai pu le vérifier qu’en sortant dans la cour. Ma dernière cellule ne faisait qu’un mètre sur deux. Elle n’avait pour seule ouverture que la porte métallique plaquée comme une verrue sur un côté de ce cube blanc me servant de logement depuis quelques jours. Difficile de repérer le déroulement de la journée avec des temps de repas toujours approximatifs et parfois carrément supprimés. Quand j’ai trouvé que les portes ne claquaient presque plus, j’ai supposé que c’était la nuit.
Quand ils m’ont enlevé l’immonde capuchon me coupant du monde, j’ai pris en pleine figure cette lumière agressive nous rendant tous blafards, gardes comme détenus. Dure cette pression oculaire soudaine qui vous vrille le cerveau, vous le taraude mieux qu’un outil pour vous affaiblir encore un peu plus ! À vivre dans le noir du capuchon, on se construit un environnement virtuel et la perception qu’il nous reste se débrouille sans ça. Elle s’organise alors en sons et en odeurs. Le toucher est réduit à sa portion congrue avec des mains liées en avant. La vie passe pour une illusion.
J’ai vu que nous étions quatre à cheminer dans le couloir du sous-sol.
Conformément aux ordres, nous étions légèrement habillés. Matias en simple short et sandales. Nous les femmes avec un chemisier blanc en plus. Pour afficher une sorte de pudeur hypocrite. La couleur des suppliciés. Tres de Mayo.*
Il n’y avait que le bruit des bottes et le cliquetis de nos menottes pour meubler le silence imposé d’une main de fer. Au bout du boyau cimenté, nous sommes arrivés devant une grille fermée. J’ai pensé aux gladiateurs attendant la rumeur de la foule avant de pénétrer dans l’arène. Je me suis souvenue de ces images montrées dans les livres d’histoire. Je me suis dit que j’étais en train d’en écrire la suite. À mon corps défendant.
Un gradé a déverrouillé la grille de l’extérieur et nos sbires nous ont poussés dehors sans ménagement. Les deux femmes ont prononcé à voix basse quelques mots en français. Comme une prière. Je me suis rapprochée tout près de Matias pour lui chuchoter qu’il était le papa d’une petite fille splendide. J’ai eu le temps de voir le bonheur envahir son beau regard. À quelques mètres, un camion de l’armé nous attendait, hayon arrière abaissé. Il y avait là un comité d’accueil composé d’un infirmier militaire cachant mal son uniforme étriqué sous sa blouse blanche, d’une assistante androgyne et de trois soldats en tenue de campagne chargés des translados.*
On nous a annoncé qu’en ce mercredi 13 décembre 1978, on allait être transportés dans une prison du sud du pays et que nous allions être vaccinés pour éviter les maladies contagieuses. Nous avons dû nous résoudre à subir la piqûre. J’ai remarqué que le flacon dans lequel l’assistante trempait l’aiguille pour remplir le réservoir de la seringue avant de la tendre à l’infirmier ne comportait pas l’étiquette habituelle avec la bordure bleue. Celle-ci était rouge. Rouge sang. On m’a fait avancer les mains pour m’enlever les menottes. J’ai immédiatement pensé à un autre voyage. Trop de coïncidences, trop de signes…
Pendant que j’ai eu le bras nu tenu fermement par sa main tandis que l’homme en blouse blanche officiait, je l’ai fixée elle, l’assistante aux seins plats. Je l’ai regardée intensément. J’avais envie de savoir. Elle a baissé les yeux. Juste assez pour me signifier que j’avais compris. Amère victoire…
Puis elle a eu ce geste inattendu que je ne saurais qualifier d’humanité. De sursaut féministe peut-être… Je n’aurai jamais la possibilité de m’en expliquer avec elle. Dans nos regards, qui se sont croisés, il y a eu quelque chose, un lien éphémère d’une femme à une autre. D’une mère à une autre peut-être… Le poids d’une culpabilité… Je ne sais pas. Elle a simplement retenu la main de l’infirmier pour interrompre l’injection et je n’ai reçu qu’une petite moitié de dose au lieu du contenu d’une seringue entière. Quand j’ai rabaissé ma manche devant l’infirmier qui maugréait à cause de ce travail gâché, j’ai cherché son regard à elle pour qu’elle lise une sorte de remerciement dans mes yeux. Elle venait de me laisser un peu de lucidité pour assister moi-même à mon exécution.
Tandis que Matias passait devant l’infirmier, un garde m’a lié les mains avec une ficelle grossière. En serrant fort et en ricanant. J’ai eu envie de lui cracher à la figure mais je ne l’ai pas fait. Ne jamais donner aux bourreaux de quoi justifier leurs gestes.
Un autre soldat m’a aidée à monter dans le camion. Avec les mains liées, je ne pouvais pas le faire seule. Je me suis allongée la première sur le bois rugueux. Inutile de faire preuve de résistance pour risquer une ultime injection ou une séquence de violence gratuite. Je n’ai pas oublié les coups de crosse le jour de notre enlèvement. Je n’ai pas eu le courage de le forcer à m’abattre dans la cour. Simplement pour ne pas leur donner ce plaisir-là parce que je ne me fais pas d’illusion sur la suite. J’ai décidé d’accompagner Matias jusqu’au bout. Notre vie, nous l’avons construite à deux. Si nous devons mourir, autant le faire ensemble.
Je dis “enlèvement” dans ma tête parce qu’il n’est pas correct de qualifier cela d’arrestation. Ils sont arrivés chez nous de nuit. C’étaient les hommes du 3.3/2, l’un des grupos de tareas* mis en place par la junte pour arrêter, enlever, torturer et exterminer systématiquement les opposants en dehors de tout cadre juridique.
Nous connaissions leurs agissements. Quelques mois plus tôt, des amis de Matias avaient été ainsi enlevés sans que l’on puisse en savoir davantage sur le sort qui leur avait été réservé. On avait appris qu’ils avaient été emmenés dans un CCD, un centre clandestin de détention. Ces lieux de rassemblement, installés du temps de la présidence d’Isabel Perón, étaient déjà de sinistre réputation.
Diego, mon petit bonhomme de trois ans, s’est mis à pleurer en voyant la maison envahie par ces militaires déguisés en civils et armés comme s’ils avaient affaire à des criminels de haut rang. À l’insigne porté par leur chef, j’ai compris qu’ils appartenaient à la Marine. Cela voulait dire que notre destination était probablement l’ESMA.** Mon sang s’est figé dans mes veines.
Mon mari a voulu se défendre. La scène était pathétique. Il était torse nu, pieds nus et juste vêtu d’un short de nuit froissé. Deux hommes l’ont fermement ceinturé avant de le forcer à s’asseoir et de l’attacher solidement sur une chaise. J’ai empêché Diego d’assister à cela. Je l’ai entraîné dans notre chambre. J’ai mis un grand foulard sur mes épaules nues. On s’est blot-tis tous les deux, assis sur le bord du lit. Ils nous ont laissés pleurer ensemble pendant qu’ils frappaient Matias.
L’un d’entre eux est venu me chercher, ce commandant sanguinaire que j’ai retrouvé plus tard au pied de mon lit à la maternité. Diego s’est agrippé à ma jambe gauche, serrant ses petites mains sur ma peau. Ils se sont mis à deux pour le détacher de moi. Mon foulard a glissé par terre. Diego s’en est emparé. J’ai résisté, frappé et mordu avant de recevoir un coup de crosse dans l’épaule. La douleur fulgurante a mis un terme à ma résistance physique.
On m’a indiqué ironiquement que ce n’était pas un spectacle pour un enfant de cet âge et que je le retrouverais plus tard. Des boniments et des mensonges mais je n’avais pas la possibilité d’empêcher la sépa-ration. Je ne voulais pas qu’il assistât à plus de violence.
Je les ai laissés l’emmener.
Oui, rendez-vous compte ! Moi, sa maman, j’ai lâché la main de mon fils ! Je l’ai abandonné à ces bourreaux ! Je l’ai laissé s’en aller avec les tortionnaires de son père ! Je l’ai vu disparaître au bout du couloir, serrant mon foulard sur sa poitrine comme une relique. Un gamin de trois ans. Mon amour.
Depuis ce jour, j’ai gardé dans mes bras la sensation de notre dernière étreinte. Je l’ai embrassé comme toujours, comme jamais. Parce que je sentais tout au fond de moi-même que sa chance de survivre résidait fondamentalement dans cette séparation douloureuse. Ils étaient bien conscients du choix inique qu’ils me mettaient en main.
Pour cela, je les hais.
Qu’un jour, on les pende pour leurs méfaits ! J’ai milité pour la justice, le partage, l’humanité. Mais je ne suis pas pour le pardon salvateur. Il est des choses qui resteront à jamais inacceptables, définitivement imprescriptibles. Si la justice ne poursuit pas ces gens, l’Histoire le fera.
J’ai froid. Le produit, même diminué de moitié, fait son effet. Matias ne réagit presque plus. Je sens qu’il se laisse ballotter par les mouvements du camion. Les deux femmes sont plus loin. Peut-être déjà loin…
Après le départ de Diego, ils m’ont fait revenir dans la salle à manger. Sans ménagement, au point de me faire un énorme bleu au bras gauche.
Matias s’était affaissé sur la chaise. Il avait un œil fermé et le visage tuméfié. Ils avaient tenté d’essuyer le sang qui avait coulé sur son torse, à l’endroit même où j’aimais tant somnoler et m’endormir sous ses caresses. Il en était barbouillé comme une carcasse d’animal à l’abattoir. Je n’ai pas voulu éclater en sanglots pour ne pas leur donner le spectacle de l’épouse éplorée.
Presque nue devant ces hommes se rabaissant eux-mêmes au niveau de la bête, je craignais de donner libre cours à leurs pulsions sexuelles et leur servir de proie facile devant mon mari avant d’être froidement exécutée pour ne pas laisser de trace.
Je n’oubliais pas Diego.
Matias était blessé parce que ces hommes l’avaient tabassé en règle, mais ce genre de pratique, nous la connaissions.
Malheureusement, elle a toujours fait partie du quotidien des tortionnaires et tous les accords hypocrites entre les États n’y changeront rien. Mais nous étions vivants tous les deux. Il fallait chercher à le rester encore. Gagner du temps.
Je me suis assise sur une chaise. J’ai entendu le gradé à l’insigne me signifier que nous étions arrêtés pour subversion et atteinte à la sûreté de l’État et qu’en conséquence, nous allions être transférés dans un lieu de rassemblement pour nous interroger.
C’est quand je me suis levée qu’un des hommes a pointé son doigt vers mon ventre. Il venait de s’apercevoir que j’étais enceinte. Et il l’a dit aux autres.
Le camion ralentit. J’aperçois un morceau de grillage dans l’espace libre entre la bâche et le bord du plateau du véhicule. On roule au pas mais on ne s’arrête pas. J’entends un ronflement caractéristique. C’est le bruit d’un moteur d’avion. Nous devons être arrivés à l’aérodrome militaire d’Aeroparque. C’est là qu’ils emmènent des gens comme nous. Pour nous faire disparaître à jamais.
Je dois fermer les yeux pour paraître somnolente comme les autres. Mais auparavant, je me rapproche comme je peux de Matias pour que ses mains me touchent encore une fois dans le dos.
Quand ils ont compris que j’étais enceinte, ils m’ont mise nue pour s’en assurer. Ma grossesse se voyait à peine. Ils m’ont exhibée devant mon mari en me faisant tourner. Ils lui ont dit de bien me regarder parce qu’il ne me reverrait pas de sitôt. Ils m’ont trouvée belle, piètre consolation, mais ma maternité en cours les a dissuadés d’abuser de moi. Sinon, ils ne m’auraient pas épargnée.
Ils m’ont ordonné de m’habiller complètement. Quand je suis revenue dans la salle, Matias n’était plus là. Ils l’avaient emmené. Je n’ai rien demandé. Ils ne m’auraient rien dit. Je ne l’ai revu que ce matin.
Ils m’ont conduite à l’ESMA. Ils m’ont interrogée des heures durant pour tout savoir sur nous, nos opinions politiques et religieuses, nos goûts, nos pratiques sexuelles. Ils se sont délectés des détails.
La pression était toujours forte. Je me suis pliée à ces exercices. Pas assez sincèrement cependant puisqu’ils m’ont emmenée dans les combles situés juste au-dessus des appartements des gradés pour me torturer plus sérieusement. Des séances harassantes psychologiques et physiques, plus insidieuses aussi en me mentant sur les aveux supposés de Matias pour me déstabiliser. Mais la femme enceinte qu’ils avaient enlevée à trois mois et demi de grossesse forçait un minimum de respect.
Je me souviens très bien des caresses de Matias cette dernière nuit. Il m’avait fait l’amour assez tôt dans la soirée et touchée au petit matin en me réveillant doucement. Je lui en ai voulu au début. Nous avions trop peu dormi et je n’étais pas du matin pour les choses de l’amour. Je lui ai vite pardonné quand il a parlé à l’enfant à venir sa bouche appuyée contre la peau de mon ventre et je l’ai laissé me prendre. Je me souviens très bien de ce moment-là. Je l’ai senti plus doux que d’habitude, plus aimant, plus charnel et je l’ai laissé m’emporter.
C’était juste avant que la porte n’explose sous la poussée des militaires.
Je suis restée trois mois à Buenos Aires avant d’être transférée sur l’aire militaire de Campo de Mayo située à trente kilomètres de la capitale. Une unité de l’hôpital militaire y était dédiée aux accouchements clandestins. C’est là qu’est née Maria, ma fille.
Je suis contente d’avoir pu annoncer la nouvelle à Matias au moment du passage de la grille fermant le tunnel. Il ne l’aura pas serrée dans ses bras. Moi, je n’ai pu la garder que quelques jours auprès de moi avant d’être à nouveau ramenée à l’ESMA. Sans elle. J’espère qu’elle pourra savoir plus tard qui étaient ses parents.
Voilà. Nous sommes arrivés au bout du voyage. Ce n’est peut-être pas le plus dur qu’il nous reste à vivre. La mort n’est rien sauf la perte des personnes aimées. Ils nous en ont tant fait que nous sommes fatigués de n’être plus rien.
Personnellement, je n’ai plus d’illusions depuis longtemps, plus de rêves, plus d’avenir. Juste un espoir pour mes deux enfants. Si jeunes, si fragiles et orphelins par le seul fait de militaires assoiffés de pouvoir. Il n’y a pas une seule raison valable qui justifie notre exécution.
Nous sommes des militants de la liberté, de la justice et de l’égalité. Il faut croire que ces tortionnaires ont bien peur d’eux-mêmes pour éliminer ainsi des citoyens sans défense.
J’espère qu’ils paieront, mais j’ai de sérieux doutes sur la probité de ceux qui les jugeront. Le temps a trop tendance à absoudre.
On nous emmène vers cet avion qui ronronne à quelques mètres. On nous traîne, on nous porte.
Matias semble inconscient. Je fais semblant d’être dans le même état. Je les vois ces bourreaux tirés à quatre épingles pour assister au spectacle. Je les maudis.
On nous jette sans ménagement sur le plancher de l’avion. La marchandise vouée au rebut n’exige pas d’attention particulière. Ils arrivent même à me faire mal au seuil de la mort.
Il y a déjà d’autres passagers. Je ne vois pas bien. Trois ou quatre, pas plus.
Deux hommes s’affairent autour d’eux. J’aperçois la seringue. L’anesthésique comme coup de grâce. La fin est toute proche maintenant.
L’avion s’arrache du sol, prend de la hauteur et vire quelques instants plus tard en direction de la mer. Direction le cimetière marin du Rio de la Plata. La rumeur disait donc la vérité.
Ils en sont à déshabiller les passagers moribonds tandis que la vaccination pour l’au-delà se poursuit inexorablement. Jamais on ne pourra mettre un nom sur ce qui restera de nous.
J’ai peur.
Je n’évite pas l’injection. Ni la nudité. La porte s’est ouverte sur l’océan. Le vent, le bruit s’engouffrent dans la carlingue. Cela ne dérange plus personne. Les tueurs approchent une victime nue de l’ouverture béante et la poussent dans le vide. La deuxième suit puis la troisième. Effroyable régularité des vuelos de la muerte.*
— Diego, mon fils chéri, où es-tu ?
C’est au tour des deux femmes françaises de notre convoi de disparaître sans un mot, sans un cri.
— Maria, ma fille, qui te dira que je t’aime ? Ils empoignent mon mari, le soulèvent.
— Oh, Matias, tu m’as serré si fort pour m’embrasser la première fois ! Je t’aime.
Je l’ai regardé s’envoler.
Maintenant, ils me portent. J’ai un dernier sursaut pour leur montrer que je suis consciente.
Ultime témoin de ma propre exécution. Que le remords les ronge à jamais.
Ils m’approchent du vide.
— Mon amour, mon amour. Attends-moi, je vais te rejoindre…
Ils me poussent.
— …là-bas… où… marchent… des… colombes.
* Nom donné aux victimes de disparitions forcées, arrêtées et tuées pendant la dictature militaire en Argentine (1976-1983).
* Processus de réorganisation nationale : “programme” de la junte.
* Toile de Goya.
* Déplacés.
* Escadrons de la mort.
** École Supérieure de Mécanique de l’Armée qui servait de lieu de détention.
* Vols de la mort.
I
Landowski pivota sur lui-même, façon derviche tourneur. Il inspecta des yeux les alentours d’un regard vif, éveillé, précis. Une attitude somme toute très professionnelle. Il aimait ça, ce rôle de solitaire aux aguets, toujours paré pour l’aventure, prêt aussi à répondre au coup de grisou comme à l’agression. Histoire de se goinfrer d’adrénaline et, une fois l’orage passé, se retrouver entier et vainqueur devant l’adversité terrassée. Rester vivant.
Le divisionnaire se disait parfois qu’un jour, il se sentirait brutalement poussé en avant par une balle à ogive blindée et qu’il n’aurait même pas le temps de voir son agresseur. Quand on s’y prend bien, la victime est morte avant d’atteindre le sol. Des balles, il en avait tiré. Des hommes, il en avait mis à terre. Pour la loi et l’ordre. Pour la République.
Il acceptait l’éventualité de sa propre mort. Cela faisait partie de la vie professionnelle, des risques du métier et de la destinée potentielle de chaque fonctionnaire de police. Heureusement qu’il ne s’agissait pas d’une hécatombe quotidienne mais seulement d’actes isolés. Mais chaque policier à terre, c’était une vie prélevée de trop. D’autres étaient tombés qui n’avaient rien demandé à personne et qui n’avaient pas démérité de la vie. Question de malchance, de destin. La roulette russe.
Ce qu’il souhaitait vraiment c’était d’avoir la possibilité de faire face, de se défendre et, si c’était à son tour de perdre, qu’il puisse vendre chèrement sa peau. Pour partir en beauté, avec panache, comme Pike Bishop dans La Horde Sauvage, un western crépusculaire. Son film fétiche.
Les flics à terre, il y en avait chaque année. Souvent à la suite d’actes gratuits et disproportionnés par rapport aux enjeux. Parce que les petites frappes armées de pistolets plus gros que leur cerveau se reproduisaient au gré de la constitution des bandes et de l’augmentation de la délinquance urbaine. Heureusement, ce n’était pas encore l’hécatombe dans les services actifs, mais chaque décès retentissait avec tristesse dans les tripes des collègues comme un avertissement.
Maigre consolation, il n’avait pas à la maison des enfants jeunes qui pouvaient devenir des orphelins par le simple vouloir d’un fondu de la gâchette. Il n’aurait pas voulu les voir grossir les rangs de l’association Orphéopolis, l’orphelinat mutualiste de la police nationale. Bien sûr, il mettait un point d’honneur à donner son obole chaque année pour aider l’association et, quand il voyait le sourire des enfants dans le bulletin “Serment de Coeur”, il en retirait une réelle satisfaction.
Des enfants, il ne savait pas vraiment s’il en avait. Il lui arrivait parfois de se poser la question. Il était de cette génération où le préservatif n’était qu’un objet de rigolade pour les soirs de fête et où la responsabilité de la maternité était laissée à la partenaire. Depuis, il avait pris conscience du risque et il s’était rangé des voitures comme tout le monde, mais les femmes qu’il avait serrées dans ses bras dans une période antérieure, avaient très bien pu être enceintes de ses œuvres sans qu’il n’en sache rien. Aucune n’était arrivée un matin tenant un enfant par la main. Il le regret-tait parfois.
Il continuait à marcher. Il venait de passer la portion en arc de cercle de l’avenue des Mimosas à HendayePlage. Sur sa gauche s’élevaient hôtels et résidences. À cette heure de la journée, l’endroit était calme. Quelques employés allaient prendre leur service. Deux ou trois personnes promenaient leur chien. Des joggeurs trottinaient le long du quai. L’ambiance habituelle des stations balnéaires avant le déferlement des vacanciers.
Landowski s’arrêta à côté de la passerelle descendant au ponton des navettes maritimes. Il jeta un regard en direction de Hondarribia, la ville espagnole située en face, de l’autre côté de la Bisassoa. C’était là qu’il allait. Il avait rendez-vous avec Jose Ramon Takenea.
Le petit bateau était là. Il dansait au gré du léger clapot. Son timonier s’affairait avec une bouilloire d’eau chaude à la main. Il devait être en train de se préparer un peu de café à consommer entre deux allers-retours.
Le commissaire descendit la rampe de bois munie de tasseaux pour faciliter la marche puis il monta à bord de la navette peinte en bleu et blanc. Dans le petit habitacle, il s’intéressa aux porte-clefs vendus par l’équipage, de la cordelette de nylon tressée en boule, puis il sortit à l’air libre sur la plage arrière.
Il s’assit dos à la mer afin de garder un œil sur le quai et les abords. Il n’avait pas de raison particulière de se méfier mais, pour avoir tant donné dans la coïncidence tirée par les cheveux, il préférait faire preuve de la plus élémentaire des vigilances pour ne pas avoir à le regretter.
De la terrasse d’une des résidences, il était très facile d’observer ses faits et gestes. Un tireur discret pouvait même lui loger une balle dans la tête sans une once de difficulté. Le policier était là incognito, loin de toutes ses bases et, qui plus était, tout seul. Il ne craignait pas vraiment l’élimination à la Kennedy. Un agresseur éventuel attendrait son retour pour agir parce que ce qu’un observateur aurait voulu savoir en ce matin un peu frais c’était la destination précise de Landowski et l’identité de son interlocuteur.
Mais il ne fallait pas flipper. Il était un touriste comme un autre, adepte plutôt de l’intersaison que de la période estivale et il pouvait passer inaperçu sans la moindre difficulté. À part cette grosseur dans son dos au milieu de la ceinture qui indiquait l’arme de poing prête à cracher sa première Valda toujours engagée dans le canon.