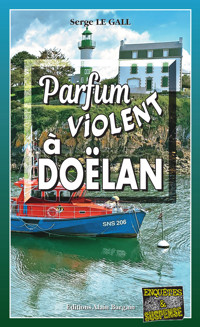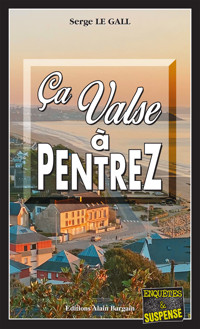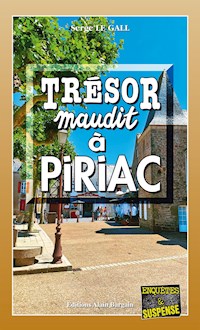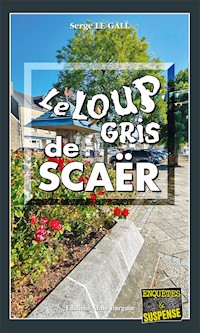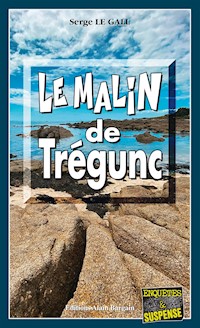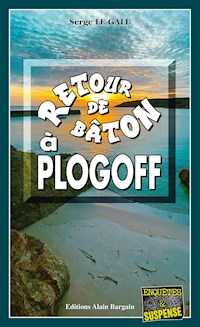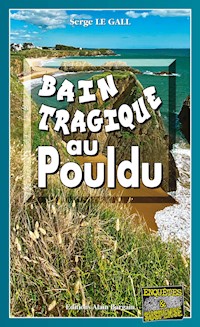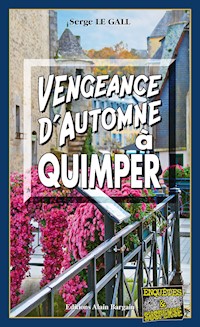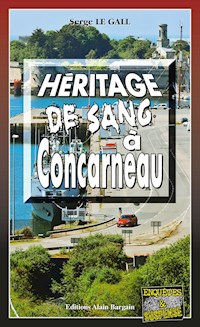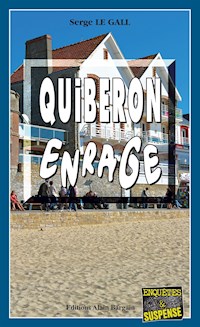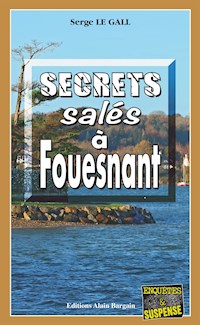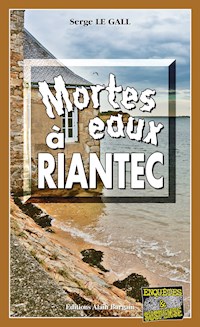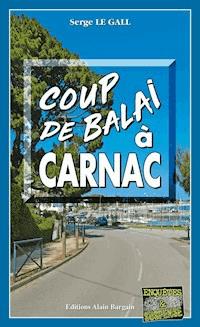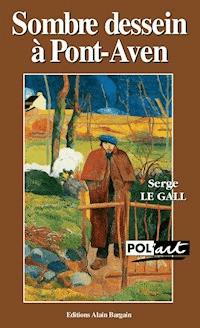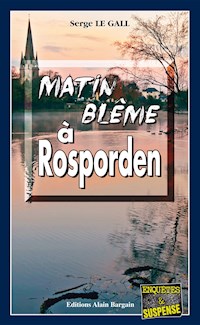Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Landowski
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Le commissaire nage en eaux troubles…
Quelques bulles et plus rien... Du côté de Chateauneuf-Du-Faou, le canal de Nantes à Brest ne ressemble plus à un long fleuve tranquille. Depuis quelques mois, on s'y noie ferme ! Accidents, suicides ? On dit que les crimes sont souvent commis en période de lune montante. C'est à l'écluse 218 qu'on assassine !
Des chats disparaissent aux abords des cimetières. Une fatigue soudaine atteint les jeunes filles du canton. Les retraités fortunés n'ont plus goût à la vie. La mystérieuse résidence hôtelière des Jardins de Lagad propose des cures de jouvence. Rajeunissement garanti ! Le commissaire Landowski ne croit pas aux arts divinatoires. Pourtant, Marie-Jeanne, voyante occasionnelle, approche de la vérité. À en avoir froid dans le dos... Au pied du château de Trévarez, Lando mènerait-il son ultime enquête ?
Suivez le commissaire Landowski dans le 17e volet de ses enquêtes palpitantes, au sein d'une mystérieuse résidence hôtelière !
EXTRAIT
Pour être dépouillés de leurs avoirs et de leurs biens, il faut qu’ils meurent. Pour que le doute ne s’insinue pas dans les esprits, il faut qu’ils meurent proprement.
Les instigateurs de leur enlèvement n’ont pas d’autre choix. Depuis le début de l’opération, l’exécution fait partie de leur projet, mais il s’agit de présenter les choses comme un suicide, au minimum comme un accident si les constatations d’usage laissent la porte ouverte à une autre interprétation. L’assassinat programmé doit rapporter gros. On ne s’attaque pas à du menu fretin. C’est un investissement et c’est un risque. Si la brigade de recherches s’oriente sur la piste d’un crime, c’est clos cacheté. Adieu le pactole et bonjour les emmerdes !
Du côté des victimes programmées, ce n’est pas tout à fait la même chanson. En désespoir de cause, ils souhaiteraient en finir au plus vite puisqu’ils savent tous les deux qu’on va prendre leur vie. Leur fin est inéluctable. Elle est gravée dans la machination qu’ils n’ont comprise que trop tard.
Ils ne peuvent pas dire qu’ils sont pressés de mourir. Tant qu’il y a de la vie, il reste un espoir. Même si cette notion est intellectuelle et dérisoire. Il n’y a que la souffrance qui puisse dicter ce choix. C’est la peur qui les fait appeler la mort de toutes leurs forces, dans un silence très lourd.
CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE
Éditions Bargain, le succès du polar breton. –
Ouest France
À PROPOS DE L'AUTEUR
Serge Le Gall vit et écrit à Pont-Aven. Dans la collection Pol'Art, il vous a invité à suivre quatre aventures du détective Samuel Pinkerton. Dans la collection Enquêtes et Suspense, il vous propose ici de participer à la treizième enquête du désormais célèbre commissaire divisionnaire Landowski.
À PROPOS DE L'ÉDITEUR
"Depuis sa création en 1996, pas moins de 3 millions d'exemplaires des 420 titres de la collection « Enquêtes et suspense » ont été vendus. [...] À chaque fois, la géographie est détaillée à l'extrême, et les lecteurs, qu'ils soient résidents ou de passage, peuvent voir évoluer les personnages dans les criques qu'ils fréquentent." -
Clémentine Goldszal, M le Mag, août 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la réalité, et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
REMERCIEMENTS
- À mon ami Pierre-Henry Fontaine, grand spécialiste des baleines et autres cétacés, pour son autorisation à commencer ce roman par une scène insolite et vraie qu’il m’a racontée un soir de novembre 2001 à Québec.
- À l’Établissement Public de Coopération Culturelle “Chemins du Patrimoine en Finistère” et son directeur pour m’avoir autorisé à placer l’une des dernières actions de cette enquête au Domaine de Trévarez.
« La cuirasse rougieDu sang des batailles,Le guerrier valeureuxBuvait au ruisseau.La femme assoupieDans le limon docileEspérait de sa boucheUn souffle de vent. »
Uchen Yang,Infatigable voyageur chinois(Période des Cinq Dynasties - Xe siècle)
PROLOGUE
La victime s’est résignée au moment ultime qui va mettre un point final au reste de sa vie.
L’homme n’est plus tout jeune mais il a encore fière allure. Sauf qu’en ce moment précis, il a le corps emmailloté dans une longueur de bâche plastique épaisse qu’on déroule habituellement sur les talus pour empêcher la prolifération des mauvaises herbes. Pour maintenir en place ce corset peu seyant, on a utilisé de l’adhésif brun couramment utilisé pour fermer les colis. On n’a pas lésiné sur le saucissonnage de peur que le prisonnier ne parvienne à se libérer.
Cette armure ne laisse en dehors que les jambes en dessous des genoux et la tête à partir de la base du cou. À cet endroit, on a placé une serviette de toilette arrangée comme celle qui protège le boxeur d’un coup de froid toujours dommageable pour le combat à venir. Le tissu épais empêche le contact du plastique avec la peau et, de ce fait, évite l’apparition de marques de frottement qui ne manqueraient pas d’intéresser des enquêteurs scrupuleux. Tout a donc été prévu pour qu’il en soit ainsi.
La tête, elle aussi, a subi un traitement particulier. On dirait qu’on l’a coiffée d’un casque de fantassin datant du Moyen-Âge avec un cercle qui obstrue la bouche et un autre, perpendiculaire au premier, qui le rejoint sur la nuque.
De médiéval, c’est tout ce qu’on pourrait en dire. Le dispositif est en plastique renforcé de bandes collantes doublées par endroits. En dessous, on a placé un tissu épais qui empêche toute trace de pression sur la peau mais qui fait transpirer terriblement.
Pour la femme, on n’a pas fait de différence. L’accoutrement de plastique est rigoureusement identique. Il semble provenir de l’atelier du même créateur de mode, sauf que celui-ci doit plutôt être installé boulevard de la torture, en enfer. En supplément sur sa poitrine, on a tracé une sorte de croix de Saint-André qui sépare deux seins opulents qui auraient tendance à se laisser aller en l’absence de lingerie de soutien.
On ne voit pas les mains des deux prisonniers. Elles sont attachées entre elles et solidement arrimées au corps selon le même mode opératoire. Des manchons de tissu épais protègent les poignets de la morsure des liens.
Il n’y a que leurs yeux fous à bouger sans cesse. Mieux qu’un puissant acide, l’angoisse, la peur, l’impuissance les rongent à l’intérieur. La perte de la parole aussi. La bouche ne peut s’entrouvrir que de quelques millimètres et les sons émis sont limités à une sourde plainte. Les cris sont exclus. Il n’y a d’ailleurs personne pour les entendre. Sauf les hommes, là dehors, qui pourraient devenir méchants pour tuer dans l’œuf toute envie de mutinerie. L’un et l’autre, ils ont compris, un peu tardivement malheureusement, les raisons de ce traquenard. Surtout la finalité criminelle de l’entreprise. Leur jolie fortune intéresse au plus haut point et la convoitise, quand elle submerge la morale, pousse au crime d’une manière si naturelle que le public se demande toujours comment on a pu en arriver là.
Pour être dépouillés de leurs avoirs et de leurs biens, il faut qu’ils meurent. Pour que le doute ne s’insinue pas dans les esprits, il faut qu’ils meurent proprement.
Les instigateurs de leur enlèvement n’ont pas d’autre choix. Depuis le début de l’opération, l’exécution fait partie de leur projet, mais il s’agit de présenter les choses comme un suicide, au minimum comme un accident si les constatations d’usage laissent la porte ouverte à une autre interprétation. L’assassinat programmé doit rapporter gros. On ne s’attaque pas à du menu fretin. C’est un investissement et c’est un risque. Si la brigade de recherches s’oriente sur la piste d’un crime, c’est clos cacheté. Adieu le pactole et bonjour les emmerdes !
Du côté des victimes programmées, ce n’est pas tout à fait la même chanson. En désespoir de cause, ils souhaiteraient en finir au plus vite puisqu’ils savent tous les deux qu’on va prendre leur vie. Leur fin est inéluctable. Elle est gravée dans la machination qu’ils n’ont comprise que trop tard.
Ils ne peuvent pas dire qu’ils sont pressés de mourir. Tant qu’il y a de la vie, il reste un espoir. Même si cette notion est intellectuelle et dérisoire. Il n’y a que la souffrance qui puisse dicter ce choix. C’est la peur qui les fait appeler la mort de toutes leurs forces, dans un silence très lourd.
Ils n’ont pas été molestés, en aucune façon. Leurs ravisseurs, soucieux de préserver leur retour à meilleure fortune, les ont traités avec égard, comme pour leur masquer la suite peu réjouissante inscrite au programme. Aux animaux de boucherie, on parvient à cacher la mort programmée pour ne pas les stresser. La chair est plus tendre. Mais pour des humains…
Quand on leur a proposé à tous les deux une promenade sur le chemin de halage, ils ont accepté d’emblée. Au repas de midi, ils avaient longuement parlé du canal. Lui, en tant qu’ancien entrepreneur, avait manifesté son intérêt pour les ouvrages d’art, sa fortune provenant de ce type d’activité. Elle, s’était apparemment émue du travail des forçats creusant l’énorme fossé. Elle avait voulu savoir combien d’hommes y avaient laissé leur peau. On n’avait pas su lui répondre.
Ils auraient pu s’étonner de devoir prendre leur propre véhicule pour se rendre sur place mais, comme l’accompagnateur leur avait dit qu’il avait une course à faire avant de les rejoindre, ils avaient trouvé ça normal.
Ce qui le fut moins, une fois arrivés à l’endroit du rendez-vous en fin d’après-midi, c’était l’absence de leur guide. À sa place, un homme ganté de noir s’était approché d’eux à visage découvert et il avait tout de suite menacé la dame avec une longue lame. De quoi rendre silencieux le vieil homme ne voulant pas mettre la femme en danger. D’ailleurs, il n’aurait servi à rien de hurler en cet endroit désert. Les ravisseurs l’avaient bien choisi pour ne pas être dérangés.
On leur avait dit de laisser leur voiture sur le terreplein avant de descendre vers le bief en suivant un petit sentier. Comme deux petits soldats, ils auraient suivi à la lettre les indications de leur mentor. C’est beau, la confiance !
Sur place, ils n’avaient pas été surpris de voir qu’un véhicule utilitaire était stationné sous les arbres. À travers les branches, on pouvait apercevoir l’une des berges du canal. Un homme attendait assis au volant et deux autres conversaient à proximité de l’arrière du fourgon.
Dès que les deux personnes âgées étaient sorties de leur véhicule, l’un des hommes s’était précipité avec un grand couteau vers la dame. Le retraité s’était laissé ceinturer par le deuxième quidam sans faire un geste de protestation pour éviter de donner à son acolyte l’envie de saigner la femme avec cet énorme coutelas. Elle était manifestement choquée par la contrainte et terrorisée par la menace. L’homme approchait l’arme blanche de son cou, à toucher la peau sans la blesser, avec un rictus de délectation morbide aux lèvres, puis il faisait mine de donner un coup sec qu’il accompagnait avec son corps. De quoi briser dans l’âme tout projet de révolte.
Le retraité a redouté de voir la femme agoniser devant lui à cause d’une stupide résistance. Il s’est dit qu’il valait mieux se soumettre et répondre aux exigences des ravisseurs pour espérer retrouver la liberté au plus vite. Il a même fait un rapide calcul mental pour se préparer à rassembler la rançon qui pourrait être exigée pour leur libération. Il s’est alors focalisé sur les modalités de la transaction pour ne pas penser à une issue plus tragique.
Puis les pièces du puzzle se rassemblant dans le bon ordre dans sa tête, il a fini par tout comprendre. Avec ces relents d’amertume qui se sont mis à remonter en bouffées désagréables du plus profond de son être. À le submerger.
Il s’était laissé avoir. On l’avait pris par les sentiments. Elle plus que lui d’ailleurs. On les avait aveuglés. De multiples attentions, des boniments, des onguents et la nostalgie de plaisirs oubliés avaient eu raison de leur jugement. Ils s’étaient laissés bercer et embarquer dans une aventure sans lendemain les menant au bord d’une portion perdue en pleine campagne du canal de Nantes à Brest.
Pour y mourir.
Il a regardé l’un des hommes dérouler deux larges bandes de plastique noir puis s’approcher de lui tenant l’une d’elles à deux mains tandis que le deuxième larron menaçait toujours la vieille dame tremblante en lui caressant le cou de sa lame tranchante.
Avec résignation, ils se sont laissés ficeler l’un après l’autre, puis bâillonner avant d’être entraînés vers le véhicule arrêté à deux pas. Leurs deux ravisseurs ont rejoint le chauffeur et se sont serrés sur les sièges, puis le fourgon s’est engagé sous les arbres et il a rejoint lentement le chemin de halage. Il a fait une centaine de mètres avant de s’arrêter en amont de la dernière maison éclusière avant le vieux pont du Roy.
Le linteau au-dessus de la porte de la maison indique “Ecluse 218 Skluz Bizernig”, mais les deux prisonniers reclus à l’intérieur du véhicule ne sont pas en capacité de lire l’inscription.
C’est là qu’ils attendent ce qui va être le moment de leur exécution annoncée. Lui, espère qu’elle ne souffrira pas. C’est maintenant son vœu le plus cher. Elle, veut l’accompagner jusqu’à la fin. Ils ne se sont jamais quittés. Ils veulent partir ensemble.
Tout à coup, l’arrière du véhicule s’ouvre en deux parties. Le grincement métallique ressemble à celui d’une porte de geôle dans un mauvais film. La pénombre disparaît pour laisser place à cette clarté si particulière qui nimbe les abords totalement déserts du canal. Les deux prisonniers engoncés dans leur accoutrement tournent le dos à l’ouverture. Lourdement lestés, ils n’ont pas la faculté de se mouvoir seuls. Le fourgon recule lentement. Les roues arrière mordent une légère pente herbeuse qui attire déjà les prisonniers vers la sortie. Un carton oublié glisse vers l’arrière puis tombe à l’extérieur.
Le véhicule s’arrête. Les deux bourreaux descendent et le dernier referme la portière sans vraiment la claquer. Le conducteur ne quitte pas son poste. Il ne se retourne pas. Il reste immobile et une sorte de silence ouaté s’installe. Alors que l’on peut s’attendre à l’hallali, rien ne se passe. On n’entend plus que le son étouffé de quelques paroles comme si les deux hommes s’étaient éloignés. Une minute dure une éternité dans ces cas-là. C’est le moment de croire à sa chance, le moment d’espérer un retour à la raison, le moment de vouloir effacer le cauchemar. L’esprit s’arc-boute sur les aiguilles de l’horloge pour tenter d’arrêter le temps.
Quelques longues minutes s’égrainent avant que les deux ravisseurs n’entrent dans l’habitacle par la porte coulissante de droite. Ils ont revêtu des combinaisons de plongée. C’était donc ça le grand sac de plastique noir qu’ils tenaient dans leurs bras tout à l’heure.
Ils s’accroupissent comme des grenouilles sur le plancher métallique puis ils poussent les prisonniers comme des ballots, pour les faire glisser vers l’arrière, vers la sortie. Les jambes des futures victimes se tendent et les talons adhèrent pour ralentir la progression. Le plastique malmené chuinte sur le plancher métallique. Le cri cherche à se frayer un chemin dans une ouverture minuscule et se transforme en sourde plainte.
Mis en déséquilibre, les deux paquets humains basculent dans le vide. Il y a d’abord un choc mou de la masse qui creuse la surface puis une vague qui leur mouille le visage en retour. Une eau froide qui s’insinue facilement sous le plastique, imbibe les vêtements et les alourdit considérablement. Une sensation encore plus désagréable quand on appréhende l’avenir immédiat avec frayeur.
Ils comprennent qu’ils ont été balancés dans le canal, juste en amont du bief qu’ils voulaient voir. Leur chute a engendré un léger mouvement rotatif. Ils tournent sur eux-mêmes comme deux toupies. Lentement.
Le jeu morbide n’a qu’un temps. Tout est réglé comme du papier à musique. Les deux ballots sont déjà en train de couler. Inexorablement. La chose a été prévue par les tueurs dans leur entreprise de mort. Les deux hommes-grenouilles se sont mis à l’eau sans créer de remous suspects. Ils rejoignent leurs proies, les entraînent vers la porte amont de l’écluse, hors du courant créé par la passe en escalier, puis les immobilisent fermement, chacun la sienne, avant de les faire disparaître sous la surface sombre sans les lâcher.
Et sans effort.
Les victimes n’ont aucun moyen de se défendre. Elles ne peuvent rien tenter pour sauver leur vie. Leur cocon de plastique interdit tout mouvement. Sauf qu’ils ne perdent pas une seconde du déroulement de leur exécution. Il y a bien quelques bulles et quelques bruits étouffés des corps qui résistent. Il y a aussi des regards éperdus, dirigés vers la surface toute proche sans pouvoir remonter vers elle et la crever pour retrouver un souffle salvateur. Des mains fortes appuient sur leurs épaules et les maintiennent entre deux eaux.
Des secondes passent. Le regard s’embrume. Il y a le froid qui engourdit, les sens qui abdiquent, les fonctions vitales qui s’altèrent jusqu’au déséquilibre fatal.
La mort fait son œuvre.
Il y a un temps de silence et d’immobilité, puis les plongeurs débarrassent prestement les corps de leur uniforme de plastique et de leur casque. Le harnachement a été conçu pour être ôté en un temps record sans blesser le cadavre. Il ne s’agit pas d’amateurs mais bien de tueurs chevronnés.
Ils poussent les corps sans vie contre la porte amont du sas. Déjà ceux-ci plongent lentement sous l’eau sombre et disparaissent.
Quelques bulles et plus rien.
Personne n’a rien vu. Le lieu a été repéré puis choisi. Le jour et l’heure aussi. À cet endroit, les arbres qui bordent le chemin brouillent la vue aux habitations du coteau. On est loin de toute agitation. La maison éclusière est fermée et les pêcheurs ne remontent pas toujours si loin. De même que le crachin a dissuadé les plus décidés des promeneurs assidus. Pourtant, le quai Jean Guivarc’h est tout proche ainsi que le pont où passent sans arrêt des véhicules.
Les deux assassins ne s’attardent guère. Ils remontent sur la berge en amont du mur du bief. Ils se débarrassent de leur combinaison de plongée en s’aidant mutuellement. Ensuite, ils rejoignent le véhicule de chantier. Ils passent chacun un survêtement à bandes neuf et identique. De véritables frères siamois.
Ils ont un dernier coup d’œil vers la scène de leur crime pour vérifier que les corps ne sont pas déjà revenus au ras de l’eau, puis ils montent dans le véhicule qui s’éloigne aussitôt en roulant au pas. Nul besoin d’attirer l’attention d’un regard qui traîne.
Reste sur place la voiture des deux victimes. Pour que tout fonctionne à merveille, il faut qu’elle soit bien visible. Quand la disparition des deux personnes aura été signalée, c’est le véhicule qu’on va rechercher en premier. Il ne faudra pas bien longtemps pour qu’on le repère. Quand on l’aura retrouvé à cet endroit, il limitera la zone d’action des gendarmes et orientera naturellement les investigations des enquêteurs vers le canal. On inspectera le chemin de halage, les abords de la maison éclusière et son parcours sportif, puis le fossé rempli d’eau. Ne trouvant rien, on en viendra au canal lui-même. Fatalement. C’est très précisément ce qui est attendu par les auteurs du crime.
Ensuite, on sondera pour chercher les corps.
Dans le bief, puis sur le pourtour.
Et, forcément, on les trouvera dans l’eau sombre.
C’est essentiel.
C’est écrit dans le plan diabolique.
Noir sur noir.
I
Il pleut.
Il ne s’agit pas d’un déluge à charrier maisons, veaux, vaches, cochons, voire habitants surpris par un flot aussi tumultueux qu’inattendu. Non, c’est simplement un petit crachin désagréable qui s’insinue partout, qui refroidit plus qu’il ne mouille et qui raye le paysage comme autant de coups de crayon tracés par un enfant turbulent.
Les nuages buttent contre les collines, tournent en rond et servent des orages comme en montagne. Les anciens disent que le canal y est pour quelque chose. Il serait comme une sorte de ligne de partage stoppant les nuages afin de les faire dégorger comme des outres trop remplies. À cela, il faudrait associer le sens du vent et la température. De quoi chercher l’âge du capitaine dans un baquet de saumure oublié au fond de la cale d’un vieux rafiot.
Le conducteur du fourgon fatigué n’en a que faire de ces considérations. Pour lui, il y a le concret de la situation. La flotte se colle au pare-brise et il a bien du mal à conduire paisiblement. Il râle à chaque fois qu’un pneu s’enfonce dans une ornière. C’est sa colonne vertébrale qui en prend un coup. La hauteur du véhicule accentue le mouvement de balancier et l’homme hirsute, baratté par ces cahots répétitifs, sent son estomac crier gare.
Parfois, ces tribulations un peu scabreuses qu’on lui fait faire pendant ses jours de repos lui pèsent terriblement. Alors, pour chasser les idées noires et s’affranchir du climat un peu rude, il rêve de cocotiers et de femmes autochtones disponibles à l’envi. La lascivité féminine associée au climat tropical a toujours fait naître en lui de dangereuses pulsions.
Quand il sera temps de payer la facture, il ne sera pas fier d’avoir agi ainsi. Il se retournera et il n’y aura personne pour l’aider. C’est toujours comme ça que ça se passe. Il y a les donneurs d’ordre et les lampistes. C’est ainsi depuis que le monde est monde. Du coup, il balaie les scrupules et il en profite en espérant passer au travers. Mais dans la vie, on ne fait pas toujours ce que l’on veut. On avale des couleuvres. On courbe l’échine en tendant la sébile et on se remplit l’escarcelle. Advienne que pourra !
Il a besoin de cet argent. Les femmes coûtent cher à ceux qui n’ont pas une tronche de premier de la classe et, en campagne, les top-modèles peu farouches ne courent pas les rues. Ou si vite que lui ne les a pas encore rattrapées. Aussi se contente-t-il de grisettes qui sont dans la même situation que lui, qui espèrent bêtement tomber sur le mec plus ultra puis, la nuit s’avançant, se rabattent sur ce qui reste sans trop faire la fine bouche.
Ce n’est pas toujours de si mauvaises affaires que ça. La tristesse s’en va toute seule pour peu qu’on se donne un peu de mal. Sur le coup de neuf heures du matin, quand les rayons d’un soleil timide cherchent à titiller la courbure d’un sein généreux ou l’ourlet d’une bouche pulpeuse de la belle endormie, il y a des moments de tendresse qui valent bien plus que des amours factices.
Aujourd’hui c’est samedi. À la nuit, il va repartir en chasse. Comme un prédateur civilisé. Il fera des kilomètres s’il le faut. Il choisira des lieux où on le connaît peu pour ne pas effaroucher. Même si certaines de ses conquêtes d’un soir n’en ont pas pris ombrage, la rudesse de ses manières rebute un peu. Il lui est arrivé de forcer l’adhésion de ses partenaires et de s’affranchir des limites. Au risque de devoir en répondre. Et tant pis s’il doit rentrer seul ! On ne peut pas garnir ses draps avec une simple envie.
Mais cette quête hebdomadaire le remet régulièrement debout. Elle est sa tartine d’adrénaline sans laquelle il se serait foutu dans le canal depuis longtemps. En ouvrant bien la bouche pour se noyer plus vite.
Quand l’élue d’un soir n’a pas froid aux yeux et qu’elle sait rester discrète, notre homme a autre chose en magasin. Il peut lui proposer quelques petits extras joignant l’utile à l’agréable. Pour ça, il faut jouer fin et ne s’avancer à visage découvert que lorsque la jeune personne a montré son savoir-faire et sa largeur d’esprit. Il n’a pas envie de voir débouler le père, une batte de base-ball à la main !
La jeunesse a besoin d’argent pour se payer toutes ces nouveautés électroniques qui ne servent qu’à enrichir ceux qui les vendent ou, plus prosaïquement, pour payer ses études. Elle le prend parfois où c’est le plus facile. Et c’est sur ce chemin-là qu’il les attend, ces lycéennes et ces étudiantes qui se louent au coup par coup sans se poser trop de questions. Chacune a son prix. Il a le sien aussi !
Il ne sait certainement pas ce que c’est d’organiser un casting mais c’est bien comme ça qu’il procède quand il fait son marché, de jour comme de nuit, et s’il peut vérifier concrètement les vibrations positives de l’heureuse élue, il s’en trouve récompensé. Sans perdre de vue la commande qu’on lui a passée. Un contrat est un contrat.
C’est à ces perspectives qu’il songe en regardant la pluie dégouliner sur le pare-brise. Il fera beau demain, paraît-il… Pour en rajouter au plaisir de la conduite, l’essuie-glace a des soubresauts et des hésitations désagréables qui semblent annoncer que l’accessoire ne va pas tarder à rendre l’âme.
Avec cette pluie fine de queue d’orage interminable, ce serait le bouquet. Ici c’est la pleine campagne. La route est déserte et, tout à l’heure, la nuit va tomber sur les collines comme une chape de plomb. Le temps des maléfices et des sortilèges approche avec sa cohorte de fantômes. Les âmes en peine vont se mettre à errer de buisson de lande en amas de roches et les vivants ne devront leur salut qu’à une fuite éperdue vers le monde civilisé.
Du coup, l’homme accélère. Ce n’est pas qu’il se mette à croire à ces balivernes de grenouille de bénitier, mais on ne sait jamais… On a parfois retrouvé des cadavres dans la lande. Certains n’étaient pas beaux à voir ; comme s’ils avaient servi de jouets à une horde de loups.
Mieux vaut filer. Disons plutôt qu’il se hâte lentement car dans ce chemin creux agrémenté de nids-de-poule, un panneau pour limiter la vitesse serait superflu. La régulation se fait toute seule.
Dans la caisse du fourgon, brinquebale un ensemble hétéroclite de planches de lambris éclatées, de morceaux de plastique, de bidons de peinture cabossés et de cartons encombrants jetés à la hâte sur un tas de gravats. Rien qui puisse avoir un intérêt pour un quelconque bricoleur.
La décharge est encore ouverte pour une petite demi-heure. On l’a placée là, à l’abri des regards, loin des habitations, comme un chancre purulent dont on voudrait taire l’existence.
L’homme hirsute renâcle, peste et tempête. Il maudit ces hommes politiques qui ne font de routes bitumées que dans leurs fiefs pour régaler leurs électeurs avant les grandes échéances. S’il n’y en a pas beaucoup par ici de ces rubans noirs et lisses, c’est que ces élus madrés savent bien que les lapins de garenne ne se rendent pas aux urnes. Tout comme souvent ceux qui les braconnent !
La pluie, bienvenue cependant à cause des nappes phréatiques au plus bas niveau en cette période de l’année, a gorgé l’argile de la chaussée pour la transformer en une pâte collante et infecte, digne des plus beaux jours du déluge.
Le conducteur se méfie. S’il freine trop brusquement, son tas de ferraille va jouer à la danseuse et il ne tiendra à rien du tout que la destination finale se transforme en vol plané vers le fond du gouffre qui borde la route de chaque côté. S’il augmente l’allure pour jouer à Yves Montand dans “Le Salaire de la Peur”, il risque tout autant de finir dans le décor. Tout est dans le dosage.
Une fois arrivé sur place, il se débarrassera des saloperies qu’il transporte en deux temps trois mouvements. Il descendra une bière ou deux en compagnie de Louis, l’homme à tout faire de la casse. Il est gérant, gardien et employé à la fois. Il fumera une de ses cigarettes bizarres et il repartira vers de nouvelles aventures.
Après une bonne douche, un savonnage en règle, un vrai rasage et une giclette de sent-bon sous les aisselles, il sera de nouveau présentable pour lever une greluche pas farouche dans un rade du coin.
Le gars de la décharge est un pote. Ils font des extras ensemble et ils partagent quelques petites combines pour revendre discrètement des métaux ou autres marchandises sans spolier trop gravement l’entreprise. Les temps sont durs pour tout le monde.
Le dernier virage est négocié sans ménagement. La roue arrière droite perd le peu d’adhérence qu’elle a pu conserver malgré les intempéries, mais le moteur puissant tire la guimbarde en avant et la propulse dans l’entrée du dépôt.
L’aire d’accueil a été stabilisée par du gravillon jeté à la pelle sur un revêtement grossier. On dirait que la pente pour l’écoulement des eaux a été réalisée au pifomètre puisqu’il reste un chapelet de flaques pour permettre aux enfants qui s’aventureraient par là de braver l’interdit de leurs parents.
Le véhicule décrit lentement un arc de cercle en faisant crisser le gravier chassé vers l’extérieur comme dans une image de film de série B. Ensuite, on recule vers le fond, on benne le tout et basta !
C’est juste avant d’enclencher la marche arrière que le conducteur la voit.
Une femme est assise sur un canapé fatigué au velours grenat. Le tissu sali garde sans doute en mémoire dans ses fibres usées le souvenir d’ébats intimes des hôtes de passage se vautrant sans vergogne sur ses coussins.
Aujourd’hui, point de débauche, de stupre ni de luxure. Du silence, de la simplicité. De la force et de la fragilité. De l’émotion aussi parce que le drame vient de s’inviter au spectacle.
La jeune femme est nue, complètement nue. Ses cheveux très noirs font preuve d’indiscipline et l’humidité ne semble pas avoir de prise sur eux. Ils lui mangent le visage comme s’ils voulaient la cacher et la rendre anonyme au regard indécent des voyeurs.
Elle a une peau claire qui fait tache sur le rouge du canapé. Peut-être est-ce le contraste qui en éclaircit la pigmentation… Ses seins n’ont rien à envier à bien d’autres poitrines. Elle a le ventre plat d’une joggeuse assidue. D’ailleurs, elle a le profil d’une sportive. Ses jambes sont serrées comme celles d’une petite fille sage et rendent l’image très pudique. Elle a les pieds posés bien à plat sur le sol boueux. Un filet d’eau serpente, contourne le pouce gauche et continue son chemin.
La jeune femme tient verticalement un fusil de chasse à canons sciés, les bouches appuyées sous son menton légèrement relevé et la crosse creusant une légère concavité dans la peau de la cuisse. L’index de la main gauche effleure la première gâchette dans un geste lent et répété qui doit dire quelque chose aux adeptes de la roulette russe. Sauf qu’ici, on gagne à tous les coups si l’arme est chargée. Coup double en plus !
Les yeux dans le vide, elle regarde le nouveau venu. Enfin, regarder c’est beaucoup dire. Les yeux sont immobiles, pas forcément inexpressifs. Ils ont un champ de vision resserré et ils s’en tiennent là. C’est ainsi que l’intrus pourrait avoir l’impression de basculer dans une autre dimension et se la jouer façon film fantastique. Disons que ce n’est certainement pas la préoccupation première du conducteur du fourgon que de chercher midi à quatorze heures.
Celui-ci hésite une poignée de secondes parce que l’image le percute. Il coupe le contact et le moteur s’arrête dans un hoquet sonore. Il s’extrait de la cabine en laissant la portière ouverte et pose les pieds à terre. Il ne va pas plus loin.
On entend un air de musique distillé par la radio. Un morceau de jazz manouche où l’air des guitares monte dans les aigus tandis que le son lourd et obsédant d’une contrebasse fait vibrer le tableau de bord.
L’intrusion de l’inconnu dans l’univers de la jeune femme ne modifie pas fondamentalement la scène. Elle ne change rien à son attitude. Elle ne bouge pas comme si les dés étaient jetés.
Lui, il reste là, debout, immobile, comme pétrifié par le destin qui s’amuse et par le fil de la vie qui se tend.
À se rompre.
II
C’est une maison bleue, mais elle n’est pas adossée à la colline comme le dit la chanson. On peut y venir à pied en suivant le chemin empierré parce qu’il est à peine carrossable mais, en cette période d’orages, ce n’est pas franchement conseillé. À moins que vous ne soyez James Bond qui sort calmement d’un cataclysme nucléaire sans froisser sa chemise. Le rêve !
Landowski n’est pas délicat à ce point mais, comme il va être célibataire géographique durant quelque temps, il préfère ne pas maculer ses jambes de pantalon à la manière d’un routard peu précautionneux. Surtout qu’il a été contraint de changer de look pour les besoins de l’enquête. Non pas qu’il ait franchement besoin d’être un autre homme, mais on ne sait jamais. Il y a toujours, partout, quelqu’un qui observe. Quelqu’un qui se pose des questions, qui rend compte, qui est prêt à vendre l’information. Pas à la donner !
C’est donc en voiture qu’il effectue la fin du parcours. Vaut mieux pas se faire remarquer d’entrée de jeu. Il aura bien l’occasion par la suite de susciter des interrogations dans l’esprit des gens. Il n’est pas du genre à passer vraiment inaperçu.
Le commissaire divisionnaire Landowski, flic émérite et spécialiste des affaires tordues, émarge à la Direction Centrale du Renseignement Intérieur installée au numéro quatre-vingt-quatre de la rue de Villiers à Levallois-Perret, depuis la fusion des Renseignements Généraux et de la Direction de la Surveillance du Territoire.
Pour le reste, on ne sait pas grand-chose de sa position dans la hiérarchie puisque le véritable organigramme de la DCRI est classé “Secret Défense”. Tout comme d’ailleurs, les structures et le fonctionnement de cette puissante entité au service de l’État.1
Le véhicule de location qui l’attendait devant la gare de Quimper avance au pas. Le conducteur fait attention à la chaussée comme aux repères. Il y a des lieux comme ça où il faut bien se contenter d’adresses approximatives faute d’une signalisation claire. Au début de la petite route déserte bordée d’arbres imposants, il a bien lu “Allée des Bruyères” sur une plaque apposée sur un poteau de bois. Sur son contrat de séjour, c’est ce qui est marqué en dessous du nom de famille du couple qui propose des chambres d’hôtes. Il a cependant l’impression d’avancer sur une route ne menant nulle part. Sauf peut-être à un champ. David Vincent n’est pas loin !
Et ça, voyez-vous, ça exaspère le grand flic au plus haut point. Déjà qu’il a un peu de mal à comprendre ce qu’il fout là, il suffirait de pas grand-chose pour qu’il laisse tomber.
Sauf qu’il n’a pas franchement le choix, qu’il est encore soumis à une hiérarchie et qu’il a accepté une mission, même s’il la considère comme pourrie. Bah, il trouvera peut-être du grain à moudre pour rendre utile le désagréable de la chose ! Des cadavres de vieillards coincés dans les vannes d’un bief, il n’y a quand même pas de quoi battre du tambour.2 Sauf si…
Pour se la jouer un peu, il pose son arme de service sur le siège passager à la manière d’un licencié d’un club de tir inscrit au fichier AGRIPPA.3 Sauf que l’arme devrait être rendue inoffensive, démontée et sécurisée pour être ainsi mise à la vue de tout un chacun Il y a une grande différence entre la détention d’arme et le port d’arme. Les malfrats s’en foutent royalement !
Il a tendu le bras et laissé la crosse bien tournée vers lui. Il y a bien des années, du côté de Grigny dans l’Essonne, son calibre placé exactement dans cette position lui a sauvé la vie. Il lui arrive parfois de se raconter des histoires et de se goinfrer d’une tranche de parano mais là, il s’agit tout simplement d’un geste de confort, le canon de l’arme lui titillant un peu trop le bas de la colonne vertébrale.
Arrivé à ce qui semble être la fin du chemin, il fait demi-tour non sans mal, puis il revient sur ses pas. Une fois sur la route bitumée, il tourne à droite en roulant lentement. Il se met en maraude comme un tueur de la Mafia qui va flinguer un témoin gênant. Mais ça ne l’amuse même pas de se faire un film !
Chercher, il sait faire. Donc il ne désespère pas de trouver même si ce genre de contretemps le gonfle grave. Il n’est guère du genre patient. Il ne supporte pas bien que les éléments se liguent contre lui. En plus, il a faim. Un flic qui a l’estomac vide peut devenir un prédateur redoutable.
Pour un peu, il foncerait vers le chef-lieu pour attraper le premier train. Non pas pour mastiquer un carré de pain en carton baptisé sandwich mais bien pour retourner aux choses sérieuses. Il regrette de ne pas être aux premières loges avec le remue-ménage qui est en cours. Les affaires sordides pullulent. Il y a encore beaucoup à faire pour la République.
Il n’a guère apprécié qu’on lui file cette mission. Pour un homme de son poids se coltiner une affaire pourrie de vioques suicidaires en Centre-Bretagne relèverait plutôt d’une disgrâce si on ne lui avait présenté cette mise au vert comme une nécessité stratégique. Sans vouloir rabaisser les gendarmes du secteur, ils auraient pu mener à bien cette enquête. On est dans le rural, pas dans un quartier chaud bouillant où la Kalachnikov s’achète au troc et puces.
S’il a été écarté de la capitale par le directeur de la DCRI, c’est qu’il pourrait bien intéresser certains magistrats qui souhaiteraient l’entendre au sujet de grands flics emmêlés dans des relations peu raisonnables avec des membres influents de la pègre. Le temps s’est couvert à Lyon, puis à Lille. À tourner à l’orage de grêle. Et comme cela n’a rien à voir avec le docile nuage de Tchernobyl stoppant stupidement à la frontière, des affaires pourraient faire tache d’huile…
Les médias se sont gargarisés de l’histoire de ces flics aux méthodes peu orthodoxes et chacun en est allé de ses protestations au nom de la morale. C’est oublier quand même que ce n’est pas uniquement avec des principes que l’on met hors d’état de nuire ceux, justement, qui n’ont rien à faire de la loi.
Landowski ne compte pas que des amis dans la Grande Maison. Il a déjà fait un peu de ménage, mais la poussière se cache parfois dans les placards. Comme les cadavres ! Il s’en trouverait bien de ces bons hypocrites capables de le mouiller dans des affaires sordides. Tout le monde sait bien qu’on ne fait pas d’omelette sans casser les œufs. Dans la police, c’est pareil. Pour sortir des affaires, il faut parfois aller trop loin, franchir la ligne blanche alors que d’autres la reniflent allègrement. Et il y a ces juges qui n’aiment pas beaucoup les flics et qui brandissent le code quand les autres jouent du calibre. Des mondes qui n’arrivent pas toujours à se comprendre !
De l’autre côté de la barrière, il y a les malfrats. Ils sont toujours à l’affût des faux pas de ceux qui les pistent. Ils pourraient bien profiter de la confusion pour faire un carton. Sauf que Landowski peut aussi se transformer en chasseur sans crier gare. Il en a allumé quelques-uns et fumé quelques autres. Il ne déteste pas qu’on lui en veuille. C’est humain d’aimer ou de ne pas aimer. Les rapports sont plus clairs en somme. S’il faut réagir, il excelle dans la réponse brutale. Il n’est pas l’homme des fioritures, des hésitations et des consensus. Gare à ceux qui en voudraient à son scalp !
Connaissant l’oiseau et ses humeurs, son directeur a pris les devants. Le règlement de compte, d’un côté comme de l’autre, serait catastrophique pour l’institution comme pour le fonctionnaire. D’où cette balade bucolique, si l’on peut dire, dans les Montagnes Noires.