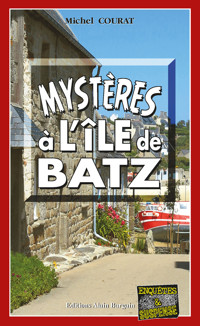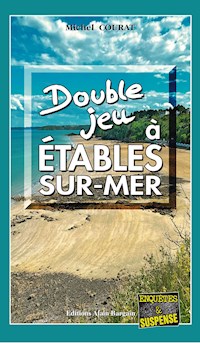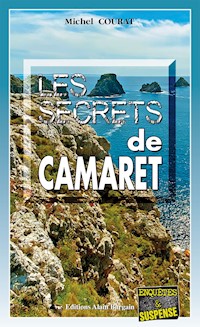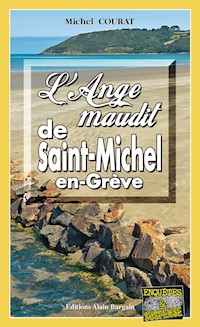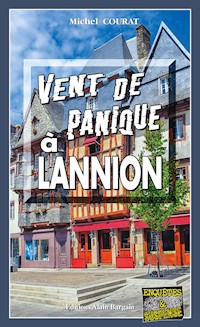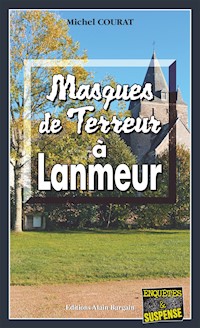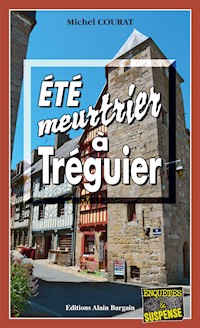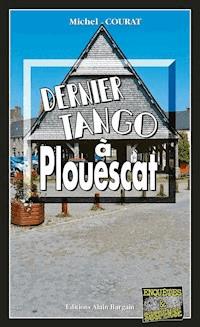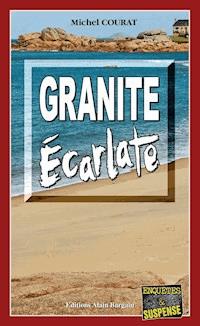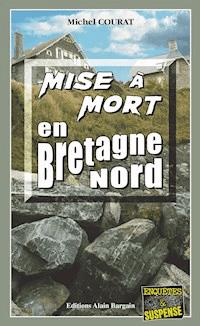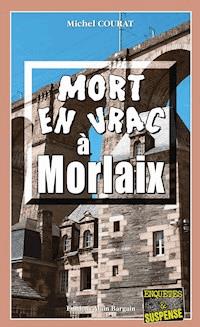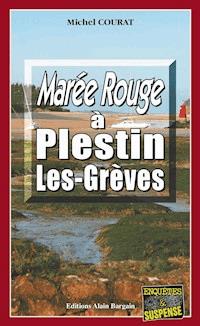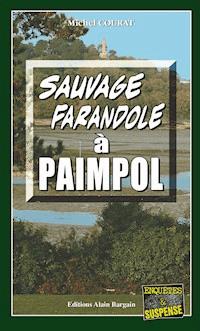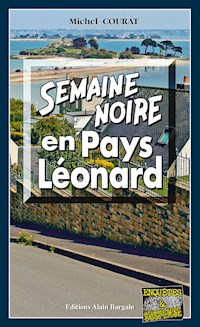
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Alain Bargain
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Les enquêtes de Laure Saint-Donge
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Pourquoi la soeur d'Ann s'est-elle jetée du sommet d'un célèbre monument breton ?
Saint-Pol-de-Léon. Marjory Arzano vient de se jeter dans le vide, du haut d’un des plus célèbres monuments de Bretagne… Ann, sa sœur, fait appel à son ancienne collègue, Laure Saint-Donge, pour essayer de comprendre. Une tâche difficile pour LSD, qui ne dispose que d’un seul indice : le journal intime de la victime. Ce qu’elle y découvre ne peut expliquer un tel acte désespéré : un gâteau qui disparaît, une voiture qui se déplace toute seule, un pull déchiré… Mais cette semaine en Pays léonard ne fait que commencer : mystères et drames vont se succéder, jusqu’au bouquet final. Inattendu.
Accompagnez Laure Saint-Donge à Saint-Pol-de-Léon, dans le 16e tome de ses mystérieuses enquêtes bretonnes !
EXTRAIT
— Absolument. Et surtout elle a des comportements qui commencent à devenir dangereux. Isa, tu as vu le coup de la “fugue” en chemise de nuit ?
Une situation de base qui suscite un intérêt évident chez le pharmacien…
— Racontez-moi ça !
C’est Isa qui s’y colle, à regret visiblement.
— Je te résume, parce que je dois avouer que c’est une histoire qui m’a laissée mal à l’aise. Une nuit, fin juin, Sylvain, le mari, se réveille et se rend compte que sa femme n’est plus dans la chambre. Il la cherche partout dans la maison. Personne. Monia dort tranquillement, alors il va faire un tour dans le jardin, et il découvre Marjory dans sa Sandero. La voiture avait embouti un des piliers du portail. Sa femme était à l’intérieur, endormie sur le volant, en chemise de nuit. Elle avait vraisemblablement voulu aller faire une balade en bagnole, et n’avait pas bien visé. La voiture était bien cabossée, mais le choc n’avait pas dû être trop violent. Elle ne semblait pas blessée, elle dormait profondément. Il l’a remise au lit, a rangé la voiture à sa place. Le lendemain matin, elle s’est réveillée comme une fleur, mais ne se souvenait de rien. Alors il lui a tout raconté, il a vérifié ses médicaments, comme il faisait souvent d’après ce qu’elle dit dans d’autres passages du journal. Elle avait pris la bonne dose.
— Crise de somnambulisme ? Ou alors trop de bibine ? suggère Hugues.
Laure se charge de la réponse :
— Somnambulisme ? Non ! Elle n’a fait ça qu’une fois et cela faisait vingt ans qu’ils se connaissaient et près de quinze ans qu’ils vivaient ensemble. Elle aurait forcément fait d’autres crises avant. Quant à l’alcool, il n’y avait aucune odeur dans son haleine, et aucun cadavre de bouteille quelconque, ni dans la maison, ni dans la voiture, ni dans le jardin. Pourtant, sa mère m’a dit qu’elle s’était remise à bibiner pendant l’été, mais c’était “après” l’accident.
— Bon, j’ai compris, reprend Hugues. Au fil des semaines, son état empirait, mais jusqu’à présent, entre ce que vous venez de me raconter et ce que vous avez lu, vous ne m’avez jamais parlé “d’incident” qui pourrait faire penser à une TS. Pourquoi se serait-elle décidée d’un coup à se jeter dans le vide, alors que, si j’ai bien compris, elle se faisait une vraie joie de remonter en haut du Kreisker ?
À PROPOS DE L'AUTEUR
Si, pour des raisons professionnelles,
Michel Courat vit actuellement en Belgique, après 9 ans passés en Angleterre, ce vétérinaire a laissé son cœur dans le Trégor. Amoureux de Locquirec depuis toujours, il y a exercé pendant des années avant de partir s'occuper de protection animale à l'étranger. Mais il revient dans "sa" Bretagne aussi souvent que possible, et c'est là qu'il a écrit
Ça meurt sec à Locquirec, son premier roman policier.
Auparavant, il a déjà publié trois ouvrages humoristiques :
Gare aux Morilles (1998),
La Brise de la Pastille (2000), et
Mots pour rire (2001).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Cet ouvrage de pure fiction n’a d’autre ambition que de distraire le lecteur. Les événements relatés ainsi que les propos, les sentiments et les comportements des divers protagonistes n’ont aucun lien, ni de près ni de loin, avec la réalité et ont été imaginés de toutes pièces pour les besoins de l’intrigue. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existant ou ayant existé serait pure coïncidence.
« Aux quatre coins de Paris qu’on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m’en fait trop, je correctionne plus : je dynamite, je disperse, je ventile ! »
Bernard Blier dans Les Tontons flingueursMichel Audiard
« Certains silences sont plus parlants que des mots, seul le cœur peut les entendre. C’est pour ça qu’il a des oreillettes. »
Julien Le Drennec (oto-rhino-cardiologiste et philosophe)
REMERCIEMENTS
- Bar de l’Évêché, Saint-Pol-de-Léon.
- Champagne François-Denizon, Verneuil.
- Le Parvis, Saint-Pol-de-Léon.
- Les Amis du Birdie, golf de Carantec.
- Office du tourisme de Saint-Pol-de-Léon.
- Pizzas Pinocchio, Plestin-les-Grèves.
- Restaurant Mary-Stuart, Saint-Pol-de-Léon.
I
48° 40’ 58” nord, 3° 59’ 12” ouest. Voici les coordonnées exactes de l’endroit où commence cette histoire. Un endroit. Que dis-je… un monument. Sans doute l’édifice religieux le plus célèbre de Bretagne, en tout cas le plus élevé. Devant vos yeux se dresse la chapelle Notre-Dame du Kreisker, appelée plus communément le Kreisker, indissociable de la ville de Saint-Pol-de-Léon, comme la Tour Eiffel l’est pour Paris. Avec son clocher culminant à 78 mètres, il fait la pige à Notre-Dame, Quasimodo en moins. Pourtant, depuis quelques secondes, aucun regard ne lui porte plus la moindre attention. Les yeux des badauds et touristes, attirés par un hurlement suivi d’un bruit sourd, fixent une silhouette incongrue, dans une position indécente. Une forme gisant sur le toit de la nef de l’église, figée dans une posture qui prêterait presque à rire. S’il en émanait encore ne serait-ce qu’un souffle de vie.
11 h 38, un samedi de septembre. Du haut de la plate-forme qui constitue l’embase de la flèche du clocher, des exclamations d’horreur ont remplacé le roucoulement des pigeons et les cris plaintifs des goélands. Les quelques visiteurs ayant gravi les 169 marches de l’escalier étroit pour accéder au sommet cantonné de ses quatre clochetons ne verront pas le spectacle qui aurait dû s’offrir à leur regard en cette journée du patrimoine gorgée de soleil. Remise à une date ultérieure la vue panoramique allant de la pointe de Primel au littoral de la Côte des Sables en passant, côté sud, par les monts d’Arrée. L’horizon de leurs yeux effarés se limite à l’observation morbide d’un corps immobile étendu sur des ardoises, le visage ensanglanté, la colonne vertébrale dans une position peu anatomique, voire grotesque. Homme, femme, difficile à dire… Cheveux courts, pull rouge, jean et baskets n’apportent pas d’élément décisif de réponse. Et, en fait, qu’importe pour eux… En retrait, mutique, le visage enfoui dans la paume de ses mains, un homme pleure.
Au bas de l’édifice règne aussi la consternation. Les badauds s’accumulent sur la place Michel-Colombe, un des parkings du centre-ville. Tout le monde y va de sa lamentation, ou de sa réflexion, au gré de son niveau de compassion ou d’intelligence. Aucun moyen de porter secours à la victime, inaccessible, posée comme un sinistre accent circonflexe de chair et d’os sur le faîtage de la toiture de l’église. Impossible de distinguer son visage, car les curieux ne peuvent voir le corps sans se mettre en retrait du bâtiment, et à cent mètres de distance, il est difficile de distinguer un quelconque détail sans jumelles. D’autant plus impossible que seules les jambes du cadavre désarticulé sont visibles côté rue. Miracle du téléphone portable, il s’écoule moins de cinq minutes avant que les sirènes ne se fassent entendre. Venant de la rue du Budou et de la rue de Roscoff, pompiers et gendarmes n’ont pas beaucoup de chemin à parcourir.
*
— Monsieur Arzano ! Merci d’être passé si vite à la brigade. Je vous présente toutes mes condoléances.
Une intonation grave, posée, chargée d’empathie non feinte. L’homme qui répond le fait avec une certaine hésitation. Son regard vide fixe le mur sans âme de ce bureau de gendarmerie. Sa voix ressemble plus à un soupir qu’à une réponse. Ignorant complètement les yeux de son interlocuteur, Sylvain Arzano murmure :
— Vous savez, autant en finir tout de suite avec la paperasse. Rien ne me rendra ma femme, alors…
Un silence respectueux. Le major Lemaire reprend, avec douceur :
— Je comprends… mais je sais combien c’est difficile de parler dans un moment pareil. Si vous le désirez, nous pouvons attendre jusqu’à ce soir, et même jusqu’à demain pour prendre votre déclaration.
Un hochement de tête de dénégation, des paupières qui se baissent, trop lasses de malheur.
— Je vous en prie. Posez-moi vos questions, je voudrais retrouver ma fille.
Les larmes viennent se mêler aux mots.
— Vous l’avez laissée toute seule ?
— Non ! Bien sûr que non, elle n’a même pas quatre ans et demi ! Elle est restée avec mes parents, au Dossen. Et je ne sais pas comment je vais pouvoir lui annoncer la nouvelle…
— Vos parents savent déjà pour votre femme ?
— Oui ! Eux, ils savent, je les ai appelés. Je leur ai demandé de ne rien dire à Monia.
— Je comprends. Je ne vous retiendrai pas longtemps, je voudrais simplement que vous me disiez ce qui s’est passé.
Rire désabusé. Haussement d’épaules. Les yeux de Sylvain Arzano se tournent vers le major, attentif, les doigts sur son clavier d’ordinateur, prêt à noter.
— J’aimerais bien le savoir ce qui s’est passé !
— Dites-moi juste les choses comme elles vous reviennent. Ce n’est que pour essayer d’établir les faits. Si on a besoin de détails supplémentaires, je vous demanderai de revenir, ou je passerai chez vous. Pour l’instant, il faut juste que vous me racontiez ce dont vous vous souvenez.
— Avec Marjory, ma femme, on s’était promis depuis longtemps de remonter en haut du Kreisker. Cela devait faire dix-sept ou dix-huit ans qu’on n’y était pas montés. La dernière fois, on était lycéens, et on ne vivait pas encore ensemble. On n’a pas voulu le faire pendant l’été, avec tous les touristes, on a préféré attendre les journées du patrimoine. Pour la visite, on nous fait monter par groupe de dix. Cela faisait à peine deux minutes qu’on était sur la plate-forme quand Marjo a voulu faire un selfie avec moi. Comme c’était notre anniversaire de rencontre – vingt ans – ajoute-t-il d’une voix tristement ironique, elle voulait prendre une série de photos originales, sous tous les angles, des photos où nous ne serions que tous les deux. J’avais l’habitude de ces petites lubies, alors j’ai expliqué la situation aux gens du groupe qui étaient avec nous, je leur ai demandé s’ils ne voulaient pas nous laisser deux minutes seuls, le temps d’immortaliser notre anniversaire. Ils ont accepté très gentiment et je les ai raccompagnés jusqu’en haut de l’escalier. Au moment où le dernier s’engageait sur la première marche, j’ai entendu un hurlement. Et un bruit horrible. J’ai aussitôt appelé ma femme, tout en faisant le tour du clocher. Rien. J’ai pensé qu’elle pouvait m’avoir fait une farce, se cacher quelque part. Mais il n’y a aucun endroit pour se cacher dans un aussi petit espace. Les autres visiteurs étaient remontés aussi en entendant le bruit. À peine quelques secondes plus tard, il y a quelqu’un qui a poussé un cri d’horreur. J’ai tout de suite compris. Je me suis précipité. Il tendait son bras vers le bas…
Le récit s’interrompt, noyé par des sanglots longs, sans doute l’approche de l’automne, avant de reprendre. Peu de mots complets, plutôt un bégaiement. Vu la rapidité du débit, le pauvre major pourrait taper avec un seul doigt sur son clavier. J’ai… vou… lu re… regarder. Mais je… je ne pou… Je ne pouvais pas… J’ai le vertige. J’ai… j’ai pris sur moi… J’ai réussi à… à baisser les yeux… et je l’ai vue. La voix reprend son débit normal, entre deux écoulements de larmes.
— J’ai tout de suite compris qu’il n’y avait plus rien à faire. Je crois qu’après je me suis assis par terre, et j’ai pleuré. Pleuré. Jusqu’à ce que les pompiers arrivent et m’aident à redescendre. Je suis resté dans leur ambulance jusqu’à… jusqu’à ce qu’ils ramènent le corps. J’ai voulu la voir, la toucher une dernière fois, mais c’était horrible. Je…
— Je vous en prie, monsieur Arzano, ce que vous m’avez dit est largement suffisant. Le sous-officier marque un temps d’arrêt, puis reprend : Je peux vous poser une autre question ?
Un simple hochement de tête.
— Je ne comprends pas pourquoi vous êtes montés en haut du Kreisker si vous avez le vertige. Surtout si vous vouliez célébrer un anniversaire…
Maigre sourire avant que la réponse ne vienne.
— C’est Marjory qui a eu l’idée. Elle en avait tellement envie, alors, j’ai cédé. Vingt ans, un chiffre symbolique ! Ça méritait que je fasse un effort, non ?
Et le jeune veuf se remet à pleurer. En silence. Un silence que respecte le major avant de reprendre d’un ton très doux, comme s’il s’adressait à un enfant qui avait eu de grosses misères, et qu’on cherche à consoler.
— Je dois malheureusement vous informer que vous ne pourrez pas récupérer tout de suite le corps de votre femme. Il a été transféré à l’institut médico-légal, pour y subir des examens…
— Des examens ? Vous voulez dire qu’on va l’autopsier ? La mutiler ? interrompt une voix chargée d’une soudaine colère. Mais je ne veux pas ! Je veux qu’on me rende ma femme… C’est un accident, un simple accident ! La rambarde n’est pas très haute, elle a dû trop se pencher, et…
— Calmez-vous, monsieur Arzano ! Je réagirais sans doute comme vous dans les mêmes circonstances, mais c’est la procédure en cas de mort violente, je n’y peux rien. C’est au procureur de la République de prendre la décision, mais je ne pense pas que l’examen médical soit très poussé. Rassurez-vous. C’est l’affaire d’une journée tout au plus. Je vous tiendrai au courant. On va vous raccompagner chez vous.
*
Laure Saint-Donge regarde l’écran de son ordinateur avec stupéfaction. Sur sa boîte mail, un étrange message. Pas venu d’outre-tombe, seulement d’outre-Méditerranée. Un nom qu’elle ne risque pas d’oublier, même s’il est enfoui au septième sous-sol de ses souvenirs : Ann Fitzpatrick.
Le genre de patronyme qui vous “tamponne les neurones” à l’encre indélébile, pour le reste de votre vie. Ann F. ou plutôt Annef comme tout le monde l’appelait quand elle était encore à la BRB. Avec Laure, elle formait un binôme de choc, toujours partant pour les opérations difficiles. Ah ! Elles en ont passé du temps ensemble, en opération, en planque ou au bureau ! Et comme elles étaient du genre mignonnes, elles faisaient tourner la tête de bien de leurs collègues, et de bien d’autres hommes, et femmes, également. Physiquement très différentes, elles avaient pourtant la même vision de la société, et de la vie en général. Leur comportement au quotidien, leurs attitudes, leur humour, et tant d’autres détails en faisaient presque des jumelles. Un surnom d’ailleurs dont on les a affublées très vite. Un surnom qu’elles ont gardé tout au long des quatre années passées ensemble, dans le même groupe d’intervention. Et s’il y a une chose plus que toutes qu’elles partageaient, c’était bien le dégoût de l’injustice. Elles ont même poussé la ressemblance jusqu’à quitter la police ensemble, refusant de continuer à traquer des dealers ou des braqueurs de supermarchés, qu’elles arrêtaient le lundi et qui recommençaient le mardi. Quant aux hommes politiques, à quoi bon les poursuivre pour des détournements de sommes colossales puisque cela ne les empêchait pas de se retrouver quelques mois plus tard sur les bancs de l’Assemblée, du Sénat ou dans le fauteuil confortable d’un ministère quelconque ? Le même ras-le-bol au même moment, oui, mais après, leurs routes ont divergé. Ann s’est engagée dans l’humanitaire, tandis que Laure se lançait dans le journalisme d’investigation. Quelques échanges de mails au début, puis un peu moins, puis plus du tout. Plus le moindre contact entre elles depuis une dizaine d’années. Et là, Annef ressurgit du néant relationnel avec un message sibyllin : « Coucou, c’est moi ! Je sais que tu ne peux pas m’avoir oubliée. Et pourtant que de choses ont changé ! Je te donnerai des détails plus tard. Pour l’instant, j’ai besoin de toi de toute urgence. Es-tu dispo ? Si oui, fais-le-moi savoir au plus vite. Breizhoukes. Ann. »
Première réaction pour Laure : placer le message dans la corbeille de sa messagerie. Vous devez recevoir comme elle et comme moi régulièrement ces courriels parasites d’amis ou de relations perdus de vue depuis plusieurs mois ou plusieurs années et qui refont surface brutalement. Un premier mail pour vous dire qu’ils ne vont pas très bien, et qu’ils aimeraient vous contacter. Et un deuxième trois jours plus tard pour vous réclamer de leur envoyer du fric par mandat. LSD, comme vous, comme moi, a déjà failli se faire avoir et ne tombe plus dans ce genre de piège. Son index s’apprête à confirmer l’envoi aux oubliettes informatiques de ce pseudo-appel au secours quand son septième sens l’arrête. Pour les grincheux qui se demandent où est passé le sixième, celui de l’humour, je préciserais qu’il n’est pas développé chez tous les individus. Une ultime réticence. Elle repose sa main sur le plateau de son bureau et cherche à comprendre. À analyser ce que vient de lui souffler son subconscient. Qu’est-ce qui pourrait lui faire douter qu’il s’agisse d’une arnaque ? Que cette personne ait son adresse électronique ? L’argument ne tient pas, puisqu’il est disponible sur son site Internet, tout le monde peut le trouver. Le texte en lui-même, a priori, ne révèle rien qui puisse certifier l’authenticité de son expéditeur, sauf… Et là, une douce lumière illumine ses yeux vert d’eau. Sauf ce « Breizhoukes » final en guise de salut. Un “pirate informatique” n’aurait pas pu trouver ce mot dans un ancien courrier de son amie, puisqu’elle les a tous effacés. Et ce mot, « Breizhoukes », il a une histoire que seules Ann et elle peuvent connaître. Elles l’ont inventé ensemble à une soirée où elles avaient rencontré deux jeunes collègues bruxelloises venues faire un stage dans la police française. Au moment de se quitter, elles leur avaient lancé :
— Allez ! On se fait des “bizoukes” !
Un belgicisme très particulier qui avait fait rire Ann. Du coup, elle leur avait répondu avec un accent d’outre-Quiévrain caricatural :
— Ah non ! Moi, je suis à moitié bretonne, alors si vous me faites des “bizoukes”, moi je vous fais des “Breizhoukes”.
Tout le monde avait rigolé, et ce mot leur était resté, comme un symbole de ce bon moment passé entre filles. Et après, que ce soit au téléphone ou dans un mail, c’était le mot que Laure et Ann s’échangeaient avant de se quitter. Ce mot leur appartenait, personne ne peut l’avoir détourné, dix ans après leur séparation. Conclusion, ce message émane bien d’Annef. Et prend alors une tout autre importance. Ses doigts ne sont pas longs à pianoter sur les touches de son HP ProBook 4730s. Un mail court mais explicite, terminé, bien évidemment par un “Breizhoukes” et une signature très personnelle :
« Laure Saintonge. » Puisque Ann n’a jamais été fichue de l’appeler autrement que comme cela quand elle la présentait à quelqu’un. Laure Saintonge ou LSD. Mais jamais son vrai nom…
*
À la gendarmerie de Saint-Pol, on pousse un « ouf » de soulagement. Que ce soit le capitaine Gallois ou le major Lemaire, on se félicite de la décision du substitut du procureur de Brest. Les circonstances du drame du Kreisker, décrites de manière similaire par tous les témoins ne laissent planer que peu de doutes sur les causes de la chute de Marjory Arzano. Chute ou suicide sont les deux seules causes possibles. Dans les deux cas, un simple examen externe du corps et une prise de sang à l’IML suffiront. Pas besoin d’autopsie proprement dite. Un maigre soulagement pour les parents de la victime, mais cela leur permettra au moins de savoir que le corps de la défunte n’a pas été “charcuté” sans raison. Il ne reste plus qu’à attendre le compte rendu du docteur Lesage, l’affaire d’un ou deux jours maximum, et le corps pourra être rendu à la famille.
*
Laure regarde pensivement le fond de la baie de Locquirec. Un léger vent de nord-ouest suffit à faire voler les kitesurfers, qui profitent de la marée montante pour déployer leurs ailes et faire leur plein d’adrénaline. Assise devant la table de jardin, elle ne prête même pas attention au fringant sexagénaire, aux cheveux poivre et sel, qui profite du même spectacle, juché sur la terrasse du premier étage, un verre de whisky à la main. La sonnerie du téléphone vient perturber cette rêverie “lauréale”* où se mêlent excitation et mélancolie. Elle rentre dans la grande pièce de vie, toute carrelée de grège, jette un œil au numéro appelant et lance un joyeux :
— Ciao, mon Isa bella ? Ça gaze ?
— Super ! La journée a été bonne avec des auditeurs sympas. JR fait toujours autant de conneries, et raconte de plus en plus de blagues foireuses, un vrai plaisir, et, en prime, on se fait un petit restau avec Tanguy ce soir. Et toi, tu en es où ?
— Pour l’instant, nulle part. J’erre dans mes pensées, je suppute, je cogite, mes synapses vagabondent, avec un peu de cidre, du lambig, et Bruxelles pour me tenir compagnie. La maison est parfaite, et même si le jardin n’est pas grand, je le descends à la plage et au camping, alors, il est heureux comme tout. Et moi, cela me convient bien pour l’instant.
— C’est vrai qu’elle est parfaite, ta baraque, surtout dans la situation actuelle. Alors tu la pends quand, ta crémaillère ?
— Pourquoi on ne ferait pas ça demain midi, c’est dimanche ! Vous êtes libres tous les deux ? Je dirai à Hugues de venir aussi et à Vincent de… descendre.
— Parfait, on apporte les vins et le dessert.
— Ça roule !
*
Autre décor, rue de Kerivarch, à Saint-Pol-de-Léon. Une maison résolument moderne, comme un enchevêtrement improvisé de cubes. Une maison de créateur, comme on les appelle dans les magazines spécialisés. Seule concession au classicisme qui prévaut dans les maisons alentour, une avancée côté est, toute vitrée de baies de PVC blanc. Une immense véranda coiffée d’un toit à double pente d’ardoises. Un contraste étonnant qui est l’une des marques de fabrique du cabinet d’architectes dans lequel travaille Sylvain Arzano. Dessinateur en bâtiment, un métier difficile, mais qui lui a permis de bâtir la maison de ses rêves, suivant les plans qu’il a lui-même conçus. Plus exactement qu’il a concoctés en harmonie avec Marjory, et avec l’aide, indispensable, de son patron et ami, Thierry Guilliec, heureux résident de Henvic, le bourg qui peut s’enorgueillir d’avoir parmi ses habitants un multiple champion du monde du lancer d’artichaut. Une épreuve sportive de haut niveau qui fera son apparition aux Jeux olympiques de Roscoff, prévus en 2144, comme vous le savez. J’ai hâte d’y être. Dans le jardin engazonné, entretenu au quart de poil, un portique de bois. Monia alterne sans relâche les descentes de toboggan et les tours de balançoire. Son bonheur fait chaud à l’âme, si chaud qu’il tirerait peut-être même une larme à un auditeur de France Culture écoutant un débat sur l’antispécisme au temps des dinosaures. Le père de la petite fille ne la lâche pas des yeux, cherchant dans l’insouciance que révèle son comportement une once de réconfort. Debout contre la vitre, il reste silencieux et ne prête même pas attention à la silhouette de l’île Callot qui se dessine à l’horizon, de l’autre côté de l’estuaire de la Penzé. Ses yeux ne pleurent plus. Il sourirait presque en voyant le bonheur enfantin qui illumine le visage aux cheveux bouclés de son enfant.
*
Venue de derrière, une voix grave, légèrement éraillée, mais indiscutablement féminine, rompt le silence, sans interrompre la fascination du père pour la scène ludique qui se joue sur la pelouse.
— Tu comptes lui dire quand ?
Sans se retourner, la réponse vient, comme sortie d’une boîte vocale.
— Je ne sais pas, maman. Je ne sais pas. Un court silence. Un tendre signe de la main à sa fille qui lui lance un regard complice. Pour l’instant, je lui ai juste dit que sa mère était partie faire des courses et qu’elle passait la soirée avec une copine. Elle est si jeune, si fragile. Comment veux-tu que je lui dise ?
— Elle a presque quatre ans et demi. Même si la vie et la mort ne signifient pas grand-chose pour elle, il faut, en tout cas il faudra, justifier l’absence de sa mère !
— Je le sais parfaitement, papa. Mais je suis un grand garçon, alors laissez-moi gérer ça à ma façon. Elle a réussi à encaisser la mort de Léo, et pourtant elle l’adorait. Je ferai pareil cette fois-ci…
Le couple de grands-parents échange un regard embarrassé. Difficile de donner des conseils dans une situation pareille.
— Écoute, chéri, tu ne peux pas vraiment comparer. Quand Léo s’est noyé, Monia avait à peine plus de deux ans. Elle était à un âge où les absences peuvent vite s’oublier. Même si elle adorait son frère, elle ne pouvait pas comprendre les liens du sang qui les unissaient, ni l’éternité de son absence. Et Marjory était là. Avec toi, pour la prendre dans les bras, la consoler, lui faire penser à autre chose…
— Ta mère a raison, Sylvain. La situation n’est pas la même. Tu ne pourras pas lui faire comprendre de la même façon…
Un grand coup du plat de la main dans la vitre, si fort, si générateur de bruit que la gamine ne peut s’empêcher de tourner les yeux en direction de la véranda. Sylvain s’est retourné, et toise ses parents assis côte à côte sur l’un des deux canapés de cuir blanc.
— Putain ! Vous allez me lâcher, oui ? Je ferai du mieux que je pourrai, mais gardez vos leçons pour vous ! Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que je peux ressentir ? Est-ce que vous savez ce que c’est d’avoir perdu son fils, et deux ans après de perdre sa femme dans ces conditions ? Est-ce que vous le savez ? interroge une voix où la colère croît de syllabe en syllabe. La réponse ne vient évidemment pas. Alors, il continue, en hochant la tête, et en baissant nettement le ton. Je vous remercie vraiment pour ce que vous avez fait pour moi. C’est vraiment gentil à vous d’être venus aujourd’hui, mais maintenant je préférerais être seul. Seul avec Monia. Je vous rappellerai plus tard.
*
Le dimanche matin
— Trop cool, Skype ! T’es au milieu de l’Afrique, moi au bord de la Manche, et on a presque l’impression d’être dans la même pièce !
— Presque ! Petite différence… moi, je ne suis pas au bord de la mer, mais au bord de l’eau quand même, tout près du Niger. Je suis en ce moment à Dioliba, un petit village à 40 kilomètres de Bamako, au Mali. Quant à Skype, je voulais t’appeler hier soir, mais ça ne marchait pas…
— Incroyable ! Ce matin, la qualité d’image est parfaite en tout cas. Laure regarde son écran avec une attention toute particulière. Dis donc, t’as pas l’air d’avoir beaucoup changé ! À part le bronzage évidemment.
— Gentil de me le dire ! Mais toi ? C’est un effet d’optique, ou tu as quelque chose à la joue droite ?
Un petit rire désabusé. Laure caresse lentement la profonde cicatrice qui creuse sa joue martyrisée avant de répondre, avec une intonation qui se veut ironique.
— Je n’aurais pas dû brancher la vidéo… Enfin, maintenant, c’est trop tard ! Tu as vu le désastre… Depuis la dernière fois qu’on s’est parlé toutes les deux, j’ai fait pas mal de choses. J’ai été, entre autres, journaliste de guerre. Un reportage en Afghanistan, une balle perdue par les Américains, dont j’ai malheureusement hérité, et voilà comment je me suis retrouvée transformée en hybride de Joffrey de Peyrac et d’Angélique, marquise des anges… Je te passe les autres détails. Et toi, qu’est-ce que tu fous au Mali ? Dans ton mail de tout à l’heure, tu me disais que tu étais en mission pour Infirmières sans frontières, c’est ça ?
— Ouais ! En mission dans un dispensaire. Pas vraiment dans la brousse, plutôt au milieu d’un paysage de banlieue typiquement africaine, moitié bidonville, moitié campagne, avec des animaux en liberté un peu partout. Dans un village démuni de presque tout. Je reste là environ six mois, et après je devrais partir au Ghana. Ou autre part… Tu sais, dans tous les pays d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud, les besoins sont tellement immenses, et les choses changent si vite que l’on peut m’appeler à tout moment pour partir ailleurs. Enfin…
— Enfin, tu ne m’as pas contactée après dix ans pour discuter de ton boulot, ni du mien, je présume ? Et encore moins pour me parler de ma balafre !
— Tu vois, dix ans sans se voir, ni communiquer, mais on se comprend toujours au quart de tour…
— Comme de vraies amies. On nous appelait les jumelles, tu sais bien. L’Afrique reste silencieuse. Le visage souriant se ferme brutalement. La tête s’est détournée de la caméra de l’ordi, avant de revenir dans le champ, de grosses larmes sur les joues. Qu’est-ce que tu as ? J’ai dit quelque chose de spécial ?
Un silence éploré. Des mots qui reviennent, avec difficulté. La jeune femme prend sur elle à l’évidence.
— Non… Tu n’as rien dit de spécial. Juste le mot « jumelles ». Et c’est pour cela que je t’appelais. Il n’y a pas de réseau de téléphone ici, et je n’ai pu vérifier mes mails qu’hier soir. Il y en avait un de ma mère… La douleur lui enserre la gorge. Skype reste muet une nouvelle fois. Ma sœur… ma sœur est morte, hier matin.
— Morte ! Merde ! Je suis… Le genre de nouvelles, pour des retrouvailles, auxquelles Laure ne risquait pas de s’attendre. Je suis vraiment, vraiment désolée… Elle était encore toute jeune, non ? Un accident de voiture ?
— C’est ce que je voulais te dire après mon premier mail, mais Internet ne marchait plus. Je n’ai pu me reconnecter qu’il y a vingt minutes. Avant de t’appeler, j’ai réussi à “skyper” avec maman ; Marjory s’est tuée en tombant du haut du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon. Elle allait avoir trente-cinq ans. Pour l’instant, on ne sait pas ce qui s’est passé… Accident ou suicide ? Il n’y a eu aucun témoin. Ma mère est évidemment complètement effondrée, mais elle m’a dit quelque chose de bizarre, c’est pour ça que j’aurais besoin de ton aide. J’ai suivi tes diverses aventures à travers ton site Internet, j’ai lu tous tes bouquins sur ma liseuse, et je me doute que tu dois être dans le coin, pas trop loin de Saint-Pol. La voix venue du Mali a repris une certaine assurance. Celle des femmes et hommes qui affrontent le drame au quotidien et qui savent prendre sur eux pour ne pas tomber dans l’émotionnel. Même quand un tel événement les touche personnellement. Apparemment, ma sœur se sentait menacée, et elle avait laissé une enveloppe à ma mère, il y a quelques jours. Une enveloppe cachetée où était écrit « À ouvrir en cas de mort violente, d’internement ou d’état végétatif… »
Laure ne peut cacher sa surprise.
— Attends ! Tu plaisantes ? À son âge, on n’écrit pas ce genre de mots sur une enveloppe fermée ! Ou alors…
— Ça a, évidemment, été ma première réaction. Pourquoi écrire cela, et qui plus est, laisser ce document chez ma mère ? Cela devient encore plus bizarre, quand tu sais ce que maman a trouvé à l’intérieur…
*
— Alors, là, elle exagère !
Assis face à la mer sur la terrasse du premier étage, Toussaint écoute avec un certain amusement, pour dire la vérité, les doléances de Tanguy Rosnoën. Malgré le panorama sur la baie de Locquirec qui devrait suffire à son bonheur, il peste contre sa copine.
— Elle file à Saint-Pol, à 11 heures du matin, en nous plantant là, alors qu’on est supposés pendre la crémaillère ce midi ! Elle se fout de nous ! Et même pas un texto pour nous prévenir ! Qu’est-ce qu’il lui a pris ? Elle s’est assise sur un essaim de frelons asiatiques ou elle a été piquée par une vive volante ?
— Mon pauvre Tanguy, elle doit tenir ça de moi… ce goût de disparaître sans donner de justification. En fait je ne sais fichtre rien de ce qui s’est passé. Elle est montée me voir, m’a juste dit qu’elle devait impérativement partir à Saint-Pol et qu’elle devrait rentrer vers 13 heures, 13 h 30. Qu’on ne l’attende pas pour commencer l’apéro.
— On ne risque pas, commente Isabelle, hésitant entre rire et colère. Connaissant bien son amie, rien ne peut plus l’étonner. On ne va pas rester plantés là pendant deux heures à regarder la mer sans se boire un petit quelque chose…
— Champagne ? propose le sexagénaire québécois. Je me suis fait à vos habitudes françaises. Il doit bien y avoir une bouteille de Denizon dans son frigo ? C’est quand même meilleur que notre bourbon…
— T’inquiète, Toussaint, interrompt Isabelle, avec un grand sourire. Connaissant la mère Laure, je crois qu’il doit y en avoir au moins trois ou quatre au frigo. Je descends en chercher une.
— Pour commencer…, ajoute Tanguy en souriant.
— Et moi, propose le père de Laure, je vais chercher des coupes.
* Adjectif qualifiant ce qui se rapporte à Laure Saint-Donge.
II
Saint-Pol. Après avoir quitté la route de Roscoff, Laure passe le centre Leclerc et le bâtiment qui abritait son drive, tourne à gauche dans la rue de la Tour-d’Auvergne, avant de s’engager dans la rue de Plouescat. Un nom sans doute soufflé par le destin, compte tenu de ses précédentes, et récentes, aventures. Une maison toute simple, mitoyenne des deux côtés, comme dans un village de mineurs du Ch’nord, mais avec un cachet indubitablement breton. Chaque maison a ses particularités, sous forme de volets en bois coloré pour la plupart, aux lattes renforcées d’un Z, à l’endroit, ou à l’envers. Un Z traditionnel pour ce type de persiennes, qui ne veut pas dire Zorro. “L’abeille” de LSD, sa Mini jaune et noire, trouve à se garer sans peine non loin du numéro recherché. Pas de jardin, ni même de courette en façade, la porte d’entrée donne directement sur le trottoir. Une maison sobre, à l’image de la mère de Marjory et d’Annef, qui l’accueille sur le seuil. Fin de soixantaine, une chevelure grise qui encadre un visage décomposé par le chagrin, et une tenue décontractée qui sied bien à sa silhouette légèrement rondelette. Laure ne prête que peu d’attention au décor qui l’entoure, suffisamment pour percevoir la remarquable propreté des lieux. Chaque chose à sa place, soigneusement rangée, avec une odeur d’encaustique à l’ancienne et de produit nettoyant qui ne laisse aucun doute sur les qualités de fée du logis de son hôtesse. Elles prennent place dans deux fauteuils à armature de bois recouverts d’un coussin aux imprimés fleuris. Quelques banalités de circonstance, et Laure attaque le vif du sujet :
— Je suis venue aussi vite que j’ai pu quand Ann m’a parlé de l’enveloppe laissée par Marjory. Avant de parler du contenu, même si je sais que cela doit être horrible à évoquer pour vous, vous pourriez me dire ce que vous savez sur les circonstances de sa chute, Ann n’a pas pu me donner de détails ?
Le récit de Thérèse ne lui apporte pas beaucoup d’éléments intéressants :
— Je n’en sais pas plus que Sylvain, son mari. Il venait de demander à des visiteurs qui arrivaient en haut de l’escalier du clocher de patienter une ou deux minutes, le temps que Marjory et lui puissent prendre des photos pour leur anniversaire. Il était encore en haut des marches quand il a entendu un cri horrible. Lorsqu’il s’est penché, il a vu la pauvre Marjo, écrasée sur le toit de la chapelle…
Et les larmes reviennent. Les gestes de consolation de Laure ne changent rien à son chagrin. Patiemment, elle attend que l’averse lacrymale s’estompe avant de demander d’une voix aussi douce qu’une peau de pêche, lavée avec un mélange de Soupline et de Lénor.
— Vous avez une idée de ce qui a pu arriver ? Vous aviez des raisons de penser qu’elle pouvait se suicider ?
Léger ricanement. Des yeux rougis fixent Laure comme un naufragé voyant s’approcher le bateau de ses sauveurs.
— Marjo ? Se foutre en l’air ? Ah non ! Impossible ! Elle aimait trop sa petite et son mari. Jamais elle n’aurait pu les laisser seuls. Surtout après la mort de Léo…
— Excusez-moi ! Mais qui est Léo ?
Un hochement de tête désabusé. Un maigre sourire, tellement maigre qu’il en exprime de la tristesse.
— C’est vrai ! Bien sûr vous ne savez pas. Marjo et son mari Sylvain avaient un fils aîné, Léo, qui s’est noyé sur la plage Sainte-Anne, à Saint-Pol, ça fait à peine plus de deux ans. C’était début septembre, un jour de semaine, après l’école. La plage était déserte, Marjory s’occupait de la petite Monia qui avait envie de faire… autre chose que pipi. Léo jouait dans le sable à faire des pâtés. Elle l’a perdu de vue, une, peut-être deux minutes, le temps de trouver un endroit adéquat pour la petite. Quand elle est revenue, elle l’a cherché des yeux partout. Au début, elle croyait qu’il jouait à cache-cache, elle ne s’est pas trop inquiétée. Elle a exploré les rochers au pied du camping. Et là… elle l’a vu. Inerte. Flottant sur le ventre. Il était tombé dans une des deux piscines d’eau de mer qui permettent de se baigner ou de patauger quand la mer est basse. Elle l’a sorti de l’eau tout de suite, a tout fait pour le ranimer, les pompiers aussi, mais c’était trop tard. Trop tard. Ça a été terrible, terrible. Et après… le calvaire a commencé.
Pleine de compassion, Laure cherche néanmoins à essayer d’en savoir plus sur l’état d’esprit de la jeune femme la veille.
— Un drame si affreux. La perte d’un enfant… Elle a quand même réussi à s’en remettre ? Une épreuve pareille. Elle devait s’en vouloir ?
— Horriblement ! Les mois qui ont suivi ont sans doute été les plus éprouvants de sa vie et de la mienne. Marjo n’avait plus de goût à rien, complètement dépressive, elle portait toute la responsabilité sur ses épaules. J’avais beau lui répéter que c’était un accident, qu’un moment d’inattention, cela aurait pu arriver à n’importe quelle mère de famille, à n’importe quel père, rien n’y faisait. Elle passait son temps à répéter « Si je ne l’avais pas quitté des yeux… » De la voir comme ça, je peux vous dire que je me sentais mal, vraiment mal. Et impuissante. Léo était un bout de chou si mignon, si attachant, et si gentil avec moi. Je crois que j’ai encore plus pleuré après sa disparition que quand Paul, mon mari, est parti de son cancer… Le perdre après trente-huit ans de vie commune représentait une immense douleur, mais lui, c’était un adulte, d’un certain âge, qui en plus fumait comme une locomotive à vapeur. Alors, je suis arrivée à faire mon deuil progressivement. Pour Léo, j’ai toujours du mal, un gamin de quatre ans…
— J’imagine. Et son mari, ses autres grands-parents ?
— Geneviève, son autre grand-mère, ne lui a jamais pardonné. Elle se tenait correctement devant elle quand Monia était dans les parages. Le reste du temps, elle l’insultait ouvertement, et l’accusait de négligence. Parfois de bien pire. Jean, son mari, avait beau essayer d’arrondir les angles, rien n’y faisait.
— Je comprends. Et le mari de votre fille ?
— Difficile à dire. Marjory ne m’en parlait pas beaucoup. Il lui en a certainement beaucoup voulu au début, et puis après, j’ai l’impression qu’ils avaient fait la paix, signé un genre de pacte de bonne conduite pour le bien de la petite. Plus elle grandissait, et plus ils se rendaient compte qu’il fallait “faire semblant”. D’autant que Monia n’a pas beaucoup réagi à la mort de son frère, elle était trop jeune. « Il est parti voir le soleil, et les dinosaures… » Voilà ce qu’elle répétait si jamais on venait à évoquer le nom de Léo… Ils ne voulaient pas lui gâcher son enfance…
— Donc, si je comprends bien, votre fille n’était pas complètement remise du choc de la mort de Léo ?
— Est-ce qu’on peut se remettre d’un tel choc ? Tout ce que je sais, c’est qu’elle était sous anxiolytique et antidépresseur, qu’elle buvait un peu plus que la normale. Mais quand on était ensemble, on ne parlait jamais du petit, on parlait de tout, de rien, de Monia…
Une étrange flamme traverse, sans se mouiller, les yeux vert d’eau de notre détective, quand elle lance :
— Ce qu’elle ne vous a pas dit, elle l’a peut-être écrit dans cette lettre qu’elle vous a remise…
— Vous avez raison, je vais vous la chercher.
Sur le bahut-vaisselier, adossée à une photo de famille montrant les deux sœurs Fitzpatrick et leurs parents, une enveloppe. « Enveloppe », un mot qui rappelle bien des souvenirs à Laure*. Quelques semaines auparavant, elle en ouvrait une qui ressuscitait un père disparu. Toussaint Larivière devenait, ou redevenait Vincent Saint-Donge. Une bonne nouvelle qu’estompait au même moment un coup de téléphone, venant de Jean-Philippe, l’homme de sa nouvelle vie. Elle qui attendait de cette voix un souffle de tendresse, une rafale d’amour, s’était pris dans la tronche une annonce inattendue. Il la larguait, comme on largue les amarres d’un bateau avant de quitter le port. Il la larguait avec tendresse, avec regret, mais aussi avec une détermination sans faille. Son esprit militaire sans doute. Son cœur et surtout sa raison lui avaient donné un ordre, il obéissait. Un ordre, ça ne se discute pas. Mais foin de ses problèmes intimes, Laure s’efforce vite d’effacer, provisoirement, ses émotions personnelles. Dans le cas présent, il y a eu mort d’homme, ou plutôt de femme. Une jeune mère de famille, vraisemblablement fatiguée de porter un trop lourd fardeau. Laure a vite fait de saisir l’enveloppe tendue par la main tremblotante de Thérèse. Elle va pour en dégager son contenu, et se ravise aussitôt.
— Avant de découvrir ce document, j’aimerais vous poser encore quelques questions, si cela ne vous dérange pas, bien sûr. En fait, vous ne m’avez pas totalement répondu. Laure continue, cherchant ses mots avec précaution, soucieuse de ne pas brusquer la mère d’Annef. Votre fille était sous traitement, buvait plus que d’habitude… Il n’y aurait pas certains petits indices, même minuscules, qui auraient pu vous faire penser ces derniers jours que des idées d’en finir avec la vie lui traversaient la tête ? Elle n’avait jamais fait de TS ?
— À ma connaissance, non. En tout cas, je n’ai rien su.
— Sylvain ne vous en a jamais parlé ?
— Entre Sylvain et moi, le courant passait, disons, plus ou moins bien, cela changeait souvent… Moi j’étais plutôt une mamy “libérale”, alors que lui préconisait une éducation plus stricte. Le pire, cela a été après la mort de Léo. Comment vous expliquer ? Il a été odieux, proprement odieux, insultant ; ça a duré longtemps, et depuis quelques mois il avait changé. Je n’ai pas vraiment compris pourquoi, il est devenu plus gentil avec moi, plus prévenant. Il acceptait, même si c’était à contrecœur, que je laisse un peu la bride sur le cou à Monia. Mais on ne parlait jamais de Léo, et jamais de Marjory, sauf pour des détails domestiques, des repas, des besoins de nounou, des choses comme ça. Les derniers temps, le changement était encore plus net. Quand je les voyais tous les trois ensemble, à l’occasion d’un événement ou d’une fête quelconque, ils donnaient de nouveau l’impression d’une famille unie, heureuse. Au moins en apparence…
— Pour ménager la petite, ou cela vous semblait sincère ?
— Personnellement, comme je vous l’ai déjà dit, j’avais souvent l’impression qu’ils faisaient semblant, pour Monia… Je me trompe peut-être. Quant à leur comportement dans l’intimité, je n’ai aucune idée de leurs relations réelles. Et je n’ai jamais cherché à savoir d’ailleurs.
Laure jette un bref coup d’œil à l’enveloppe, décachetée, raison de sa venue dans le Léon.
— Une toute dernière question, Madame, avant de regarder ce qu’il y a là-dedans de si intrigant pour vous et pour Ann. Malheureusement, malgré tout ce que vous venez de m’expliquer sur l’état psychique de votre fille, il paraît plus que vraisemblable qu’elle s’est jetée dans le vide. Si vous, vous croyez que c’est impossible, vous pensez donc qu’elle aurait pu tomber accidentellement ?
Thérèse Fitzpatrick fixe le visage de LSD. Une curieuse réaction de surprise, comme si elle venait d’apercevoir, pour la première fois, le sillon profond et rougeâtre qui creuse sa joue droite. Un court instant d’égarement oculaire, accompagné d’une moue de dégoût discrète, précède sa réponse.
— Je vais être très sincère avec vous. Avec mon mari, nous sommes arrivés à Saint-Pol il y a seulement dix ans. On connaît bien, évidemment, la ville et la région, mais c’est surtout parce qu’on les a visitées quand on venait en vacances ici, avec les enfants, avant de nous installer. Je n’ai pas dû remonter en haut du Kreisker depuis au moins quinze ans, donc je ne me rappelle plus vraiment à quoi cela ressemble. La plate-forme est ceinturée d’une rambarde de granite, c’est sûr. Quelle est sa hauteur, là, je ne me souviens plus… Peut-être ont-ils ajouté un grillage au-dessus, pour renforcer la sécurité ? Je n’en sais rien.
— Je présume que si les visites sont autorisées, cela veut dire que le danger d’accident est infime.
— Sans doute. Mais je n’en sais pas plus. Un accident me paraît peu vraisemblable, c’est vrai, mais je n’arrive pas à croire au suicide. Elle avait retrouvé sa gaieté, elle avait des projets… Je ne l’imagine pas enjamber le garde-fou. Je ne peux pas. C’est impossible ! Et comme aucune autre hypothèse n’est envisagée par les gendarmes…
Les sanglots reviennent, vite essuyés.
— Je vérifierai pour les risques d’accident. Et cette lettre remise par Marjory, vous n’avez pas regardé ce qu’il y a dedans ?
— J’ai failli. Je l’ai juste ouverte. Avant d’aller plus loin, j’ai préféré en parler avec Ann, et elle m’a dit qu’elle vous contacterait, que vous vous occuperiez de tout. Alors je n’y ai plus touché. Je crois qu’au fond de moi, j’avais peur de ce que je pouvais découvrir…